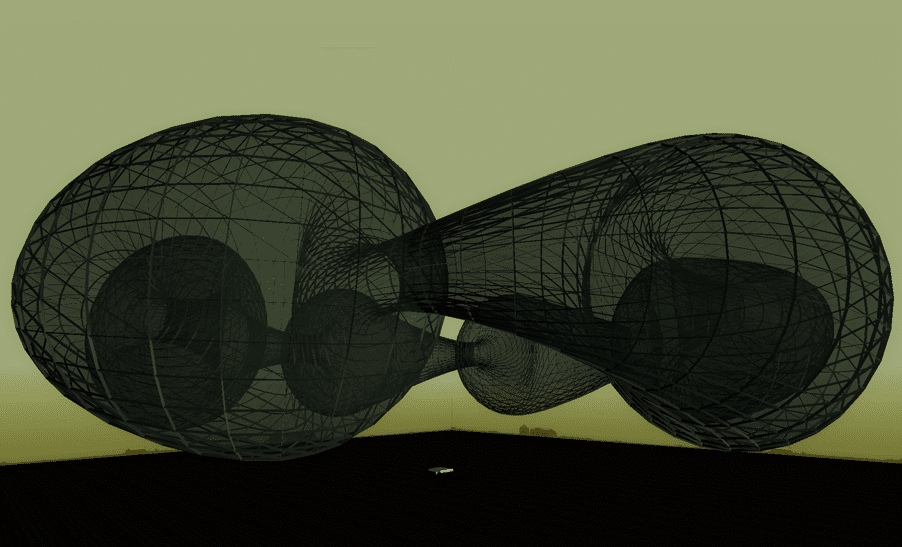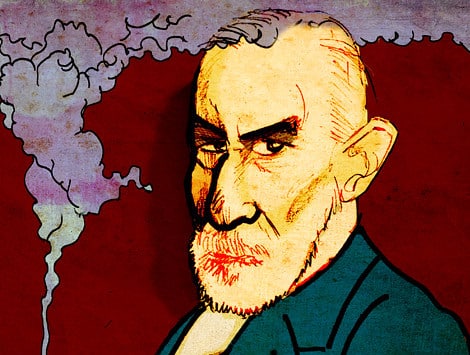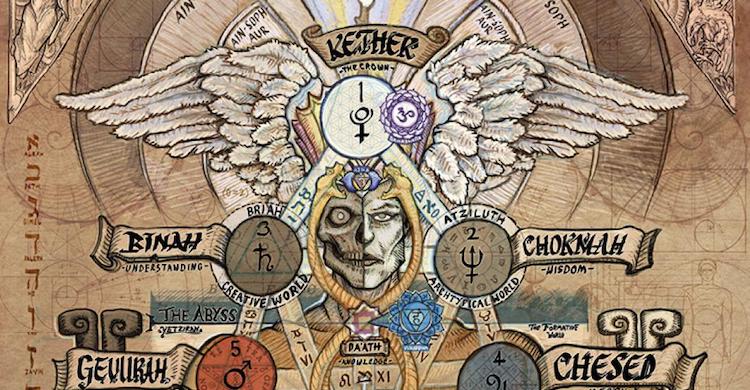Quand il raconte sa pratique, Samuel Dock ne s’exclut pas : en 2019, dans son Éloge indocile de la psychanalyse (Philippe Rey), le psychanalyste et écrivain avait pris le risque de raconter comment, à vingt ans, à la mort d’un de ses proches amis, il s’effondra, ce qui finit par le conduire en analyse. Dans Les chemins de la thérapie, il mêle son propos très armé sur le plan théorique de fragments personnels et de récits de cas de patients.
Samuel Dock, Les chemins de la thérapie. Flammarion, 320 p., 18 €
Il y a quelques nuits, obombrée par les images des bombardements du théâtre de Marioupol, quittant le chemin droit du travail et le lit défait de mes habitudes, je me trouvai dans la forêt rose obscure d’Instagram sur une application m’enjoignant, entre une sixième vague de covid et la guerre en Ukraine, de me reconnecter à mon enfant intérieur en allant faire un câlin à un arbre. Quand je ressortis de ce petit enfer, à l’aube, il m’apparut que décidément, comme dirait Thomas Bernhard, « les perturbations générales n’épargnent nulle vie, d’un déséquilibre qui partout fait pénétrer la violence et la nuit ». Et la câlinothérapie sylvicole est, comme toute méthode qui érige la violence de la bienveillance béate et sans ombre non plus en possibilité mais en certitude, un symptôme de ce déséquilibre. Car les vagues de nos embarras, les lames de fond de nos souffrances psychiques, entre épidémie et guerre, les vents contraires de notre contrainte féroce à assumer librement nos actes sans vaciller tout comme notre difficulté à rester sur le pont quand tout prend l’eau, peuvent être pensés de façon bien plus profonde.

Samuel Dock © Astrid di Crollalanza/Flammarion
On se souvient, il y a un an, de l’étonnant succès rencontré par la série En thérapie, dans laquelle un psychanalyste reçoit, au lendemain des attentats du Bataclan, cinq patients dont on suit, semaine après semaine, la traversée dans les forêts obscures de leurs contradictions. Le succès de cette série avait montré que, si dans l’affliction et la souffrance on est seul, on n’est pas le seul. Car ce que signifie pour nous qu’il existe des gens comme les personnages de cette fiction signifie, par identification, qu’il se peut qu’il existe des personnes comme nous, avec des doutes, des conflits entre haine et amour comme entre désir et amour, des hontes secrètes, et des peines d’enfant qui continuent de nous fracasser à bas bruit. Et qu’il est sans doute bien plus intelligent et bien moins urticant (certains bois et lichens contiennent des substances hautement allergisantes, sachez-le avant de les étreindre) d’admettre, non seulement qu’en nous et dans le monde les ténèbres sont à l’œuvre en permanence et qu’il nous faut faire avec cette part obscure, mais aussi qu’il y a un privilège de l’ombre. Ce privilège de l’ombre est précisément au cœur du nouvel essai de Samuel Dock, Les chemins de la thérapie, qui, hasard bienheureux du calendrier, sort au moment même où l’on s’apprête à découvrir la saison 2 d’En thérapie. De là à dire que le livre est le miroir de l’objet télévisuel, il y a un pas que nous ne franchirons point. Il l’excède de beaucoup, par son ambition et sa complexité ; et, à un moment où la question de la santé mentale et de la prise en charge est si brûlante, il questionne aussi bien les composantes politiques qu’intimes du soin.
Ce qui frappe d’emblée dans le livre de Samuel Dock, c’est l’opération de contention véritablement littéraire qui l’a conduit, page après page, à trouver une langue claire, affutée, précise, qui permette d’expliquer aussi vastement et simplement que possible des concepts d’ordinaire aussi opaques, pour qui n’a pas pris option lacanien en seconde langue, que « le symptôme », « l’objet a », « la castration symbolique ». Parler de soin mais sans céder ni sur la clinique ni sur la pratique ni sur le style n’est pas pour un clinicien chose aisée. Et, si bien des médecins, des psychanalystes ou des psychothérapeutes anglo-saxons (Irvin Yalom, Oliver Sacks, Christopher Bollas…) sont attentifs à ce trait concret, pratique et clinique, il existe peut-être parfois chez nous un péché d’orgueil qui consiste à croire que, dès qu’il s’agit de psychopathologie, de clinique et de thérapie, si l’on veut paraître intelligent il faut écrire de façon inintelligible.
Est-ce dû à son passé de praticien hospitalier ? Samuel Dock fait le choix de revenir à une technê plutôt qu’à une épistemê de la psychanalyse et de la psychothérapie d’inspiration analytique. Docteur en psychanalyse et en psychopathologie, il rappelle en préambule que « le soin est bien la première vocation de la psychothérapie » et que « toute psychanalyse induit une dimension thérapeutique et toute pratique thérapeutique mobilise un certain degré d’analyse ». De même, il croit à un dialogue fécond entre la psychanalyse et les neurosciences, tout comme il croit au dialogue entre les générations. Dans deux de ses précédents ouvrages, Le nouveau choc des générations, lecture contemporaine du Fossé des civilisations publié en 1969 par l’anthropologue Margaret Mead, puis Le nouveau malaise dans la civilisation, Samuel Dock s’était associé à Marie-France Castarède, l’une de ses anciennes enseignantes, pour penser les questions identitaires, le retour des fondamentalismes religieux, la crise écologique, les addictions technologiques et nos addictions à la satisfaction immédiate.
Freud n’en avait pas fait mystère : c’est à la mort de son père, Jacob, et aux rêves qu’il fit ensuite, qu’il doit l’écriture de L’interprétation du rêve. Le psychanalyste britannique W. R. Bion, reconnu comme l’auteur de théorisations d’une sophistication inouïe sur la psychose, le rêve, l’idée de contenant, le groupe et le traumatisme, a écrit en toutes lettres : « je suis mort le 8 août 1918 ». Il est tout jeune homme quand, pendant la Première Guerre mondiale, il se retrouve brutalement propulsé dans une peur mêlée d’hébétude qui le fait soudain devenir indifférent à l’idée de tuer comme de se faire tuer. André Green a plusieurs fois raconté comment les dépressions mélancoliques successives de sa mère, qui, à chaque crise, disparaissait dans des lieux de soin d’où elle revenait bien plus tard, lui ont permis de forger le concept de « mère morte », soit cette expérience que peut traverser un enfant quand sa mère, naguère aimante, joyeuse, tendre et vivante, devient tout à coup froide, pétrifiée, atone. Dans Les chemins de la thérapie, le fil des motifs de la consultation (du dérisoire au fracas), du choix du thérapeute, du cadre, de l’usage des nouvelles technologies, des séances manquées, du transfert dans tous ses états, de la nécessité diagnostique, se noue à celui de l’exposé de vies accidentées, d’autres que celle de Samuel Dock, comme, de temps en temps, et toujours brièvement, au fil de la sienne.

© Jean-Luc Bertini
Montrer ce qui se trame dans une cure, séance après séance, c’est évoquer de quoi elle est tissée, dans « l’ici et le maintenant de la thérapie comme dans son après-coup ». Grâce aux talents de conteur de Samuel Dock, les histoires de Samia et de son anorexie, du jeune Timothé et de son homosexualité honteuse, de Charlotte et son absentéisme scolaire, de Geoffrey, si perclus de doutes, qui ne sait « qu’hésiter à la folie », d’Helena, qui pour se protéger parle toujours de sa vie comme « d’une photographie dont elle serait absente », de Denise, violente avec sa fille mais qui eut un père violent, se lisent comme des romans mais s’arpentent aussi comme un labyrinthe de voix contemporaines qui racontent tout ce qui, ces dernières années, entrava notre liberté comme ce qui donne à l’existence humaine sa saveur.
Le propos se fait volontiers politique. On comprend que pour l’auteur « l’hémorragie du sens appelle plus que le sparadrap » du développement personnel. Le terme « clinique », rappelle-t-il, signifie étymologiquement « au chevet du malade ». C’est donc au chevet de ce qui se joue dans l’esprit et du patient et du thérapeute que se rend ce livre, avec une thèse : « Le soin mental n’est pas plus sacré qu’un autre, chaque patient a le droit de savoir comment se déroule la thérapie qu’il vit, et chaque clinicien a le devoir de communiquer sur sa pratique à son patient. Ce qui ne serait jamais toléré concernant un cancer ou un rhume ne devrait pas l’être parce que l’affection est de nature psychique. » Exit, donc, l’attitude de surplomb du sujet supposé savoir.
Pourtant, l’originalité de Samuel Dock consiste en ce que jamais son propos ne se confond avec l’intersubjectivité à l’américaine. Pour un intersubjectiviste, le langage en lui-même importe peu. Les phénomènes cliniques ne sont jamais compréhensibles en dehors de leur contexte intersubjectif, l’analyste et le patient formant un système psychologique indissoluble et l’empathie et l’introspection étant les seules sources de savoir de l’analyste. Chez Samuel Dock, fidèle en cela à l’héritage freudien et lacanien, l’importance accordée au langage du patient est fondamentale. Seulement, la question n’est pas tant de savoir si c’est encore de l’analyse ou de la thérapie de soutien ou plutôt, finalement, de l’analyse ou de la thérapie de soutien ; les effets thérapeutiques réels sur le patient ne sont-ils pas le plus important ?
Faire cas des séances avec les patients est un exercice périlleux. Certains le dégradent dangereusement en réduisant une histoire à une vignette qui, comme des cubes qui rentreraient instantanément dans les bonnes cases, illustre toujours parfaitement la théorie qu’on veut démontrer. D’autres fictionnent un rêve de patient ou condensent les histoires de plusieurs patients, moyennant quoi les adversaires des cliniciens leur reprocheront qu’il n’y a à cela rien de scientifique, parfois même pas grand-chose de littéraire. D’autres enfin s’y refusent au motif que, si l’analyste veut faire cas du patient un tant soit peu sérieusement, il doit nécessairement déplier ce par quoi on a dû soi-même en passer et donc exhiber quelque chose de sa jouissance. Samuel Dock choisit un tout autre biais. Il pose le postulat que, pour se faire une idée très nette de ce qui se passe en thérapie, il convient non seulement de faire entendre les voix des patients mais aussi celle de l’analyste. « La première chose que je remarque chez Samia vingt ans, c’est sa maigreur. Son corps ne la trahira pas, elle l’a recouvert d’un épais manteau de sport qu’elle refuse de retirer en dépit des températures estivales. Son visage, très émacié, pointe par-dessus cette armature rembourrée et je discerne sans mal le relief des os du crane, prêts à crever sa chair. Ma sœur a souffert d’anorexie mentale et c’est une épreuve pour moi de me tenir devant cette fille-brindille tant ses traits me rappellent ce masque de mort dont Salomé s’était parée pour clamer au monde que cette existence que nous nous entêtons tous à vivre, elle prétendait ne pas la désirer » : la perte de quelque chose ou de quelqu’un est bien ce qui conditionne le devenir écrivain comme le devenir psychanalyste. Et il n’est pas indécent que cette perte se dépose, une bonne fois pour toutes, à l’ombre portée de pages où conversent tant d’idéaux, se dissolvent bien des fantômes, pour qu’ensuite s’écrive tout autre chose.