Le dernier roman de l’auteur turc Orhan Pamuk se présente comme l’œuvre d’une historienne contemporaine, séduite par les lettres que la princesse sultane Pakizê a écrites à sa sœur aînée alors qu’elle résidait pour six mois dans l’île de Mingher frappée par une épidémie de peste, en 1901. Cette narratrice, désireuse dans un premier temps d’éditer les lettres, se persuade qu’il serait judicieux, en s’en inspirant, d’écrire l’histoire de ce lieu fascinant pendant l’épidémie. Ainsi, littérature et archives semblent, au départ, ne pas s’opposer mais s’enrichir mutuellement en contribuant à l’élaboration d’un roman homogène et bien documenté, sous l’égide de Guerre et Paix. Précisons, toutefois, que l’île n’a jamais existé et que l’ouvrage a été commencé avant la pandémie.
Orhan Pamuk, Les nuits de la peste. Trad. du turc par Julien Lapeyre de Cabanes. Gallimard, 688 p., 25 €
Le début du dernier roman d’Orhan Pamuk ne peut être « reçu » par le lecteur sans que s’impose le rapprochement avec le covid. Bruits et rumeurs, dénis, entêtements, complotisme, opinions infondées circulent à propos de la maladie et de sa diffusion. Les malheureux médecins, dont l’un se convainc de l’utilité du masque, sont même accusés d’avoir apporté la peste ! Et la nuit (d’où le titre du livre) les actions humaines sont encore plus délictueuses et secrètes. Une chose est sûre : la pandémie mine la cohabitation entre chrétiens et musulmans. La méfiance s’accroissant, les orthodoxes grecs accusent les musulmans d’être arriérés, ignorants et de favoriser la contamination, en se croyant protégés par des amulettes. Les Turcs accusent les Grecs de fuir provisoirement l’île dans l’intention de revenir une fois que la population aura été décimée.

Orhan Pamuk © Jean-Luc Bertini
Le très long roman de Pamuk installe le lecteur dans cette île contaminée. Elle est magnifique avec ses pierres colorées et ses roses parfumées mais la peste fait rage, et la narratrice ne nous épargne pas, à l’instar de Giono et de Camus, les descriptions de la maladie et de ses conséquences sur les corps. Des scènes atroces se produisent lorsque de jeunes enfants assistent à l’agonie de leur mère qui, jadis tendre et douce, se transforme « en une espèce de fauve égoïste, désespéré et impuissant ». L’indiscipline, la négligence, la volonté de fuir, le fatalisme, le désespoir et les rituels entravent les précautions sanitaires. L’écrivain n’est pas tendre, en particulier, avec les musulmans bigots et réfractaires des puissants « couvents » – il y en a vingt-huit – qui mènent l’île à la catastrophe. Faut-il y voir une critique contemporaine de l’électorat islamo-nationaliste du président Erdoğan ? Il est difficile de ne pas y penser.
En dépit de la gravité de la situation, il se trouve – et cela n’étonnera pas les lecteurs de Pamuk – que les trois protagonistes de l’ouvrage sont amoureux. Trois couples, en effet, vivent un amour parfait que la pandémie n’émousse pas. La princesse, qui fut enfermée toute son existence dans un palais, connaît une idylle très physique avec Nuri, son mari médecin ; le major Kâmil, soldat à la carrière médiocre, trouve la passion dans un mariage arrangé par sa mère. Le gouverneur, harassé de problèmes, reprend force et joie de vivre avec sa maîtresse qui sait le réconforter. Si les femmes n’apparaissent guère dans le déroulement social des événements, elles jouent un rôle important dans la mesure où les trois personnages masculins sont portés par un sentiment amoureux. Ajoutons qu’elles font montre d’un vrai courage en ne craignant pas la redoutable maladie.
Au mitan de l’ouvrage, un événement important survient, qui est le tournant du roman : la marche vers l’indépendance de l’île. Il faut préciser que la Crète vient tout juste d’être perdue par l’Empire ottoman. Le major Kâmil, garde du corps du docteur Nuri, et natif de l’île, enclenche un processus par quelques actions et déclarations (arrêt du télégraphe et discours en turc et en français : « Vive Minguère, vive les Minguériens ! Liberté, Égalité, Fraternité ! »). Toutefois, la narratrice souligne à quel point l’Histoire ne « s’accomplit » pas mais se fraie un sentier étroit en fonction d’événements casuels : ainsi, à la suite d’un malentendu, l’enseigne publicitaire d’un pharmacien devient le drapeau national ! Les notables qui assistent au discours du major pensent qu’il s’agit d’une simple mise en scène ourdie par le gouverneur. De plus, l’interprétation complétement biaisée des événements par les journaux français, grecs et anglais qui servent leurs intérêts nationaux contribue également à orienter l’Histoire dans un sens révolutionnaire. Ainsi, l’indépendance s’effectue par la force des choses, par l’intermédiaire de responsables politiques qui, hormis le major, ne la souhaitent pas. On entend même un cri : « À bas Abdülhamid ! » mais on ignore qui a clamé ce slogan blasphématoire ; et on ne sait si on l’a vraiment entendu.
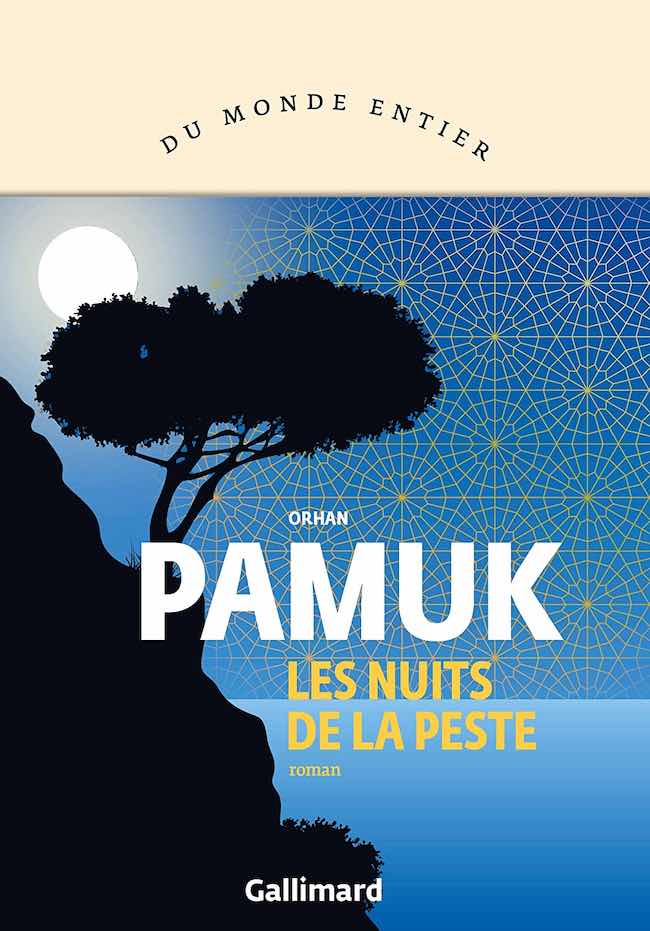
La narratrice contemporaine n’épargne pas l’Histoire officielle, qu’elle analyse comme une fabrication a posteriori, à base de récits pour manuels scolaires, de chansons, de statues, de timbres et de commémorations. La langue, le minghérien, totalement fétichisée alors qu’elle est succincte et que très peu de gens la maîtrisent, joue aussi un rôle identitaire stupéfiant. S’opposent donc, à plusieurs reprises, le roman humain, sensible et nuancé, qui montre bien la fragilité des circonstances, et le roman national catégorique, factice et convenu. D’autant que l’on enjoint à un honnête archéologue de s’abstenir d’évoquer les origines asiatiques de la nation minghérienne qui se situeraient au bord de la mer d’Aral. Le major Kâmil lui explique que « dans les contes de mon enfance, il n’y a ni lac de ce genre, ni asiatiques ». Il ajoute : « Je vous prie de ne pas nous dire que nous sommes “arrivés après” sur cette île ». En effet, dans la région, antériorité vaut toujours primauté.
Orhan Pamuk, écrivain doté d’une fibre historique sérieuse – il a demandé à Edhem Eldem, professeur d’histoire turque et ottomane au Collège de France, de se pencher sur son ouvrage – balise son récit de repères qui décrivent l’émiettement inexorable de l’empire. La narratrice montre toute l’ambiguïté d’un sultan paranoïaque, Abdülhamid II, qui se voit contraint d’adopter des réformes sous la pression occidentale, tout en se rêvant chef du monde musulman. De fait, Mingher subit le blocus d’une flotte étrangère, et « les puissances » espèrent voir l’île se détacher de l’empire. La vie politique locale en révolution est toutefois malmenée par la maladie qui, sans égards, frappe le major Kâmil, héros de l’indépendance, et sa compagne. Un moment, la princesse Pakizë devient reine ; puis, naturellement, le responsable des services secrets, modeste et obséquieux fonctionnaire qui manœuvre dans l’ombre, se retrouve président d’une république aux geôles et aux camps de travail bien pourvus.
Ce n’est sans doute pas un hasard si les arcanes de la politique croisent les raisonnements d’un roman policier, façon Sherlock Holmes… En effet, le docteur Nuri est également chargé par Abdülhamid II, lui-même admirateur de Conan Doyle (qu’il décorera quand celui-ci visitera Istanbul !), de faire la lumière sur l’assassinat du chimiste Bonkowski. Ce sultan névrotiquement inquiet était tout particulièrement intéressé par les empoisonnements qui ne laissent pas de traces. Sherlock Holmes et la princesse Pakisê ont d’ailleurs un point commun qui fait honneur aux écrivains. Le détective élucide les intrigues sans guère sortir de son bureau ; la fille du sultan, recluse dans sa chambre d’hôtel, parvient à restituer la vie complexe de l’île.

Le sultan Abdulhamid II en Une du supplément illustré du « Petit journal » (21 février 1897) © Gallica/BnF
Pamuk a la qualité du conteur oriental qui sait prendre son temps, sans chercher à créer des tensions à la manière des feuilletonistes. Il atténue même de possibles effets de surprise en nous faisant part à l’avance d’événements ou de la mort de tel personnage. Le lecteur le suit dans l’élaboration de l’ambiance qui se crée dans une petite île qui lui devient familière. Il peut même s’aider d’une carte de la capitale de l’île de Mingher, Arkaz, présentée au début du roman avec tous ses édifices, dans une facture qui rappelle le Guide du routard !
Pamuk, qui se dit pourtant « romantique », se tient à distance. Ses personnages principaux, peu dessinés psychologiquement et physiquement, sont néanmoins attachants, et surtout ils peuvent surprendre par des réactions inattendues. L’écrivain ne sacrifie pas aux stéréotypes. Par exemple, Sami Pacha, le gouverneur de l’île – dont on s’attend au début à ce qu’il soit un bureaucrate conformiste, manœuvrier et cruel –, gagne en épaisseur et en humanité. La philosophie amère de l’ouvrage tient sans doute dans cette phrase : « Et l’Histoire nous enseigne que les hommes qui jettent le premier pas sur la voie menant aux pires désordres, aux révolutions et aux massacres, avancent généralement sans peur, animés par l’intime conviction de faire exactement le contraire de ce qu’ils sont en train de faire ». Ainsi, la maladie ne rend pas plus raisonnable, au contraire, et l’Histoire demeure immaîtrisable. Ce ne sont pas les jours que nous vivons qui pourraient donner tort à Pamuk.












