Les Mémoires de Bao Tianxiao, journaliste dans la Chine du XXe siècle, entre révolutions, guerres et occupations ; un court drame social d’un romancier né l’année de la prise du pouvoir par Deng Xiaoping ; une nouvelle traduction par René de Ceccaty d’un récit quasi-autobiographique de Natsumé Sôseki : trois livres venus de Chine et du Japon pour écouter les voix diverses de l’Orient lointain.
Bao Tianxiao, Souvenirs de la chambre de l’ombre du bracelet. Traduction du chinois, notes et postface de Joachim Boittout. Préface de Sebastian Veg. Rue d’Ulm, 366 p., 21 €
Ren Xiaowen, Sur le balcon. Trad. du chinois par Brigitte Duzan. L’Asiathèque, 110 p., 7,90 €
Natsumé Sôseki, Petit maître. Trad. du japonais par René de Ceccatty. Points, 265 p., 8,60 €
Le livre de Bao Tianxiao, malgré un de ces titres poétiques dont les Chinois abusent, n’a aucun des caractères de la poésie. C’est un choix, fort bien opéré par le traducteur Joachim Boittout, également auteur de notes indispensables et de la postface, dans les Mémoires d’un journaliste, écrivain et éditeur qui a fait une exceptionnelle carrière, notamment à Shanghai, avant de se fixer à Taïwan puis à Hong-Kong.
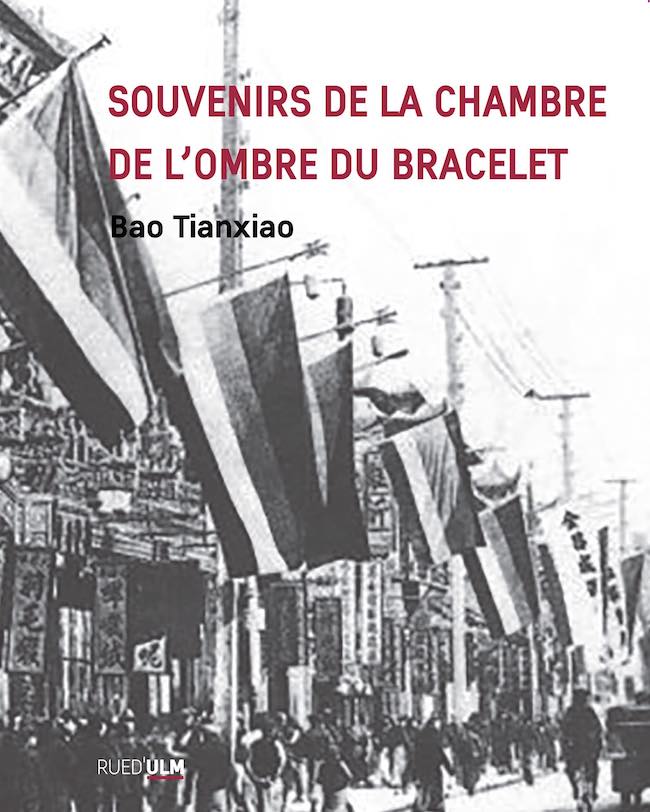
Une très longue vie (1876-1973) a permis à cet entrepreneur actif et jovial de traverser toute l’histoire de la Chine moderne, à partir de la fin de l’empire Qing et presque jusqu’à celle du maoïsme. Le moins qu’on puisse dire est qu’il ne s’agit pas d’un long fleuve tranquille. De bonne famille aisée mais non pas riche, Bao entame une carrière de fonctionnaire traditionnel en passant les premiers des interminables et fastidieux examens mandarinaux, qui ne seront abolis qu’en 1905 quand le dernier empereur mandchou fait une tentative de modernisation aussi vaine que sera l’essai d’une république en 1911, d’une dictature sous Yuan Shi Kaï, d’un nationalisme qui n’empêcha pas l’invasion japonaise, avant qu’en 1949 une nouvelle république, dite populaire, n’installe le totalitarisme de Mao.
Ces péripéties meurtrières, Bao, avant de s’exiler de la Chine continentale, les surmonte habilement. Il réussit à Shanghai à devenir un journaliste vedette et un éditeur de nombreux auteurs occidentaux, philosophes et théoriciens politiques notamment. Que retenir surtout des extraits de ses Mémoires, rédigés dans un style facile et souvent plaisant ? D’abord, me semble-t-il, que l’ouverture à la modernité d’une Chine archaïque a reposé en grande partie sur la traduction non des originaux occidentaux mais de leurs éditions japonaises.

Des habitants de Hankou fuient vers Pékin pendant la Révolution chinoise (1911) © Gallica/BnF
À l’origine de sa trajectoire culturelle, le Japon avait emprunté son savoir à la Chine via la Corée. Au début du XXe siècle, c’est la Chine qui dépend du Japon déjà « ouvert » depuis Meiji (1868). On retiendra ensuite qu’un intellectuel astucieux et non spécialisé peut parvenir à passer à travers les gouttes d’époques globalement atroces sans y sombrer, en suivant sans doute les courants les moins violemment subversifs du goût nouveau, mais en prenant tout de même certains risques, celui de défendre, par exemple, une discrète évolution de la condition féminine en publiant comme romancier à la mode le conte Un fil de lin, en 1909, dans Eastern Times Romanesque, qui nous est donné in extenso aux pages 195-205 de ce livre.
C’est un texte terriblement sentimental et qui passerait aisément pour édifiant, dans le genre Veillées des chaumières, si sa fin conformiste (la mal mariée qui a dû sacrifier son véritable amour est soignée tendrement de la diphtérie par « son benêt de mari » ; elle guérit mais le contamine et il meurt ; pleine de remords, elle lui restera fidèle) ne dissimulait pas le caractère « révolutionnaire » de la critique initiale du mariage arrangé.
On comparera avec amusement ce conte de 1909 à la « novella » chinoise Sur le balcon, publiée en 2011, soit un siècle plus tard. Aucun rapport apparent : de jeunes gars à la limite de la délinquance, dans un quartier pauvre, qui rêvent d’argent et de filles. Mais là aussi une conclusion curieusement édifiante et sentimentale et une littérature populaire pas désagréable, un peu attendue. On se rappelle alors l’immense succès en Chine de la traduction de La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils par Lin Shu en 1899. La tradition du drame social doté d’une fin morale n’est donc pas morte en Chine.

Il y a évidemment un abîme entre ces auteurs intéressants d’un point de vue sociologique – surtout le premier – et un écrivain original aussi important que Sôseki. Mais on peut tout de même aussi utiliser Petit maître, retraduit et présenté superbement par René de Ceccatty, pour souligner une différence fondamentale dans l’appréhension générale du monde entre Chinois et Japonais, et cela d’autant plus facilement que le roman de Sôseki a paru en 1906, une époque où déjà le Japon, à la différence de la Chine, était entré de plain-pied dans la modernité.
Le conte de Bao Tianxiao comme celui de Ren Xiaomen (né en 1978) et, ajouterai-je, par exemple comme les romans du Prix Nobel Mo Yan, ne s’intéresse pas à autre chose qu’à la société. La chronique d’un groupe, d’une communauté, d’un village, d’un quartier, d’un ensemble, voilà ce qui motive cette littérature, quels que soient par ailleurs ses prétentions esthétiques ou son niveau d’écriture. Il n’y a guère d’individu dans ces textes qui ne soit relié à cent autres, notamment par ses alliances familiales ou villageoises. La Chine, c’est le nombre. Tout personnage s’y définit par ses contacts, sa proximité, son rapport à d’autres.
C’est pourquoi le Sôseki de 1906, comme plus tard Tanizaki, ou Kawabata, ou Murakami, nous paraît d’emblée « moderne », c’est-à-dire occidental. Il n’écrit que sur l’individu séparé, souvent hostile au groupe, et cet individu, le plus souvent, c’est lui-même. Petit maître est le récit quasi autobiographique de l’aventure tragicomique d’un garçon sans qualité marquante, sauf peut-être une intégrité ingénue qui touche à la niaiserie. Exilé de Tôkyô dans le Shikoku, l’île la plus pauvre et paysanne du Japon, il exerce les fonctions modestes de professeur de mathématiques dans un collège et comprend mal les manigances de collègues médiocres, vaniteux, malveillants, en même temps qu’il se met à dos les élèves indisciplinés qui acceptent mal sa rigueur et ses manières urbaines. D’où une série souvent tordante de déconvenues qui n’en constitue pas moins en profondeur un sérieux apprentissage de la réalité, celle de la vie en société faite de sournoiserie, de coups bas, et aussi de découvertes inattendues (les véritables ennemis ne sont pas ceux qu’on croit, le gueulard insupportable se révèle un ami précieux).

Natsumé Sôseki (1914)
Mené à la perfection, le récit aboutit à un constat : il faut s’arracher à l’emprise étouffante des autres et vivre pour soi avec le moins possible de compromissions. Cette leçon a d’autant plus de force qu’elle est appliquée, ici, au cas d’un enseignant ordinaire qui n’est en rien, à la différence de Sôseki, un intellectuel.
Après des débuts de professeur frustré, l’auteur de Petit maître passera quelques années de formation en Angleterre et en Écosse, puis mènera au Japon une existence de lettré, de poète (en japonais et en chinois). Romancier à succès et maître à penser des jeunes générations, il est pessimiste, comme tous les plus grands écrivains nippons, sans illusion sur ses semblables, et incarne à merveille un individualisme qui nous parle directement, à nous autres de l’Extrême-Occident, sans aucun filtre exotique. Son authentique puissance subversive, jamais violente, repose, entre autres éminentes qualités littéraires, sur un humour coruscant, riche en non-dits, auquel l’excellente traduction de René de Ceccatty fait un sort.












