Le nouveau livre de Ludmila Oulitskaïa, Le corps de l’âme, a comme sous-titre Nouveaux récits. La première partie s’intitule « Les amies » et la deuxième porte le titre du recueil. On y retrouve ce regard si particulier que l’écrivaine russe pose sur le réel au fil de ses livres. Ludmila Oulitskaïa a accepté de répondre aux questions d’En attendant Nadeau, par l’intermédiaire de sa traductrice, Sophie Benech, que nous avons également interrogée sur son travail.
Ludmila Oulitskaïa, Le corps de l’âme. Nouveaux récits. Trad. du russe par Sophie Benech. Gallimard, 208 p., 18,50 €
Alors que « nous en savons beaucoup plus sur le corps que sur l’âme », Ludmila Oulitskaïa a décidé d’approcher au plus près la frontière entre l’âme et le corps, zone physique dans laquelle résonnent de « telles vibrations », qui comporte des « détails si subtils », qu’il est « presque impossible d’en parler dans notre langage magnifique, mais limité ». C’est pourtant ce que parvient à faire l’écrivaine dans Le corps de l’âme : nous faire nous tenir au bord de cette « zone frontalière », ce lieu improbable qui exerce une fascination prenant toujours plus d’ampleur à mesure que la vie s’écoule, inexorablement.
La question de la mort est elle aussi omniprésente. Naturelle ou accidentelle, elle interroge systématiquement les liens possibles entre différents mondes, différents espaces que Ludmila Oulitskaïa fait surgir dans chacun de ses récits, tous d’une justesse saisissante. L’écrivaine décline ses représentations, n’omettant jamais sa part poétique et merveilleuse. Pas un mot de trop dans ces onze histoires qui composent le recueil et font la part belle aux corps, ces chemins vers l’âme que parvient à emprunter par exemple Tolik, cet « homme dans un paysage de montagnes ».
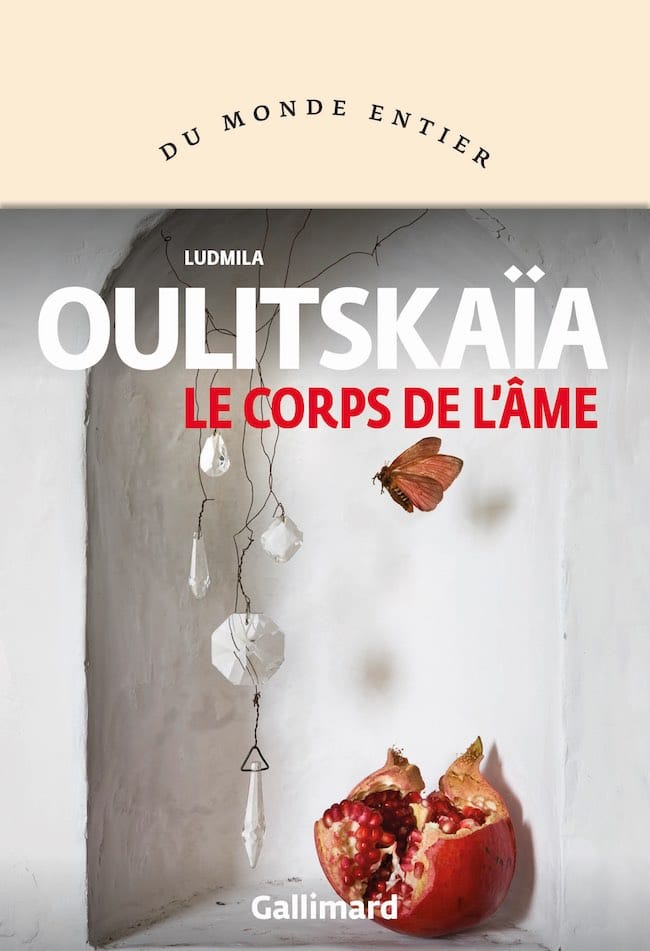
Les relations entre les personnages, entre les mères et les filles, les fils, les sœurs, les amies, les fiancés, se déploient dans une langue aux variations riches et subtiles, un tissu d’images toujours surprenantes et marquantes. La prose de Ludmila Oulitskaïa est peut-être encore plus visuelle que dans ses précédents livres. Elle fait sentir grâce à une écriture parfaitement maîtrisée, sous laquelle couve une puissante énergie vitale, les moindres « vibrations » de ce « corps de l’âme ». Elle réussit à nous émouvoir tout en nous faisant rire, parce qu’elle possède cet humour si particulier qui advient lorsqu’on ne l’attend pas, qui n’est jamais sarcasme mais qui met au jour des incohérences intimes parfois, des situations historiques misérables souvent – des détails pouvant sembler cocasses mais qui accompagnent une vie pénible, parfois dangereuse, à l’époque soviétique. Ludmila Oulitskaïa joue quelquefois du quiproquo et décrit des imbroglios intérieurs, parfois tragiques, parfois comiques, mais le plus souvent tragicomiques.
C’est cet entrelacement si serré des différents sentiments chez ses personnages que l’autrice rend perceptible à ses lecteurs, en recourant à des images, à des situations qui oscillent entre cocasserie, poésie, merveilleux, tragédie et réalisme, pour aller puiser au plus profond de la condition humaine. Pas de grand discours : ce sont les situations singulières, anecdotiques même, qui en disent plus long que tous les développements théoriques, qui émeuvent et réjouissent par leur finesse et leur limpidité. Elle sait en quelques lignes rendre compte de l’intensité et de la richesse des émotions éprouvées par ses personnages, comme ces deux sœurs enfin réconciliées après la mort de leur mère : « Dans l’avion, elles relevèrent l’accoudoir qui séparait leurs fauteuils, Nina nicha son épaule chétive et son visage de moineau au creux de la grosse poitrine molle de sa sœur. Et elles s’endormirent toutes les deux. Elles étaient délivrées de la solitude. »
Les femmes, les mères, sont très présentes dans Le corps de l’âme, comme dans toute l’œuvre d’Oulitskaïa. On se souvient par exemple de la somptueuse Médée dans Médée et ses enfants. Dans Le corps de l’âme, elles font encore et toujours face au réel, s’aiment, se soutiennent, sont parfois très pragmatiques, et toujours puissantes. Elles sont des sœurs, des amies, mais aussi des femmes amoureuses, ou des femmes qui choisissent une solitude atteignant des seuils quasi métaphysiques. Le récit « Acqua allegoria » est une vraie merveille. On y voit combien le corps est le lieu d’origine où tout revient, mais aucunement dans une perspective matérialiste.
Proches du conte à certains égards, les récits nous transportent non sans une certaine légèreté par leur poésie qui est celle de l’existence, parce que le regard de Ludmila Oulitskaïa perçoit la poésie de chaque instant, de chaque corps, de chaque situation. On se réjouit, à la lecture de chacun de ces récits, transporté en quelques lignes dans un univers singulier où l’on ne se sent pourtant jamais un intrus, et ce malgré la légère étrangeté qui teinte toujours plus ou moins l’écriture. Lire Ludmila Oulitskaïa, c’est palper le corps de la poésie grâce aux mots et aux images, c’est recueillir chaque « vibration » de cette « zone frontalière », vivre quelques instants dans le « corps de l’âme ».

Ludmila Oulitskaïa © Francesca Mantovani/Gallimard
Votre nouveau livre traduit en français, Le corps de l’âme, est un recueil de récits. Qu’est-ce qui détermine pour vous le choix d’un recueil de nouvelles, de récits, plutôt que des romans assez volumineux (Le chapiteau vert, L’échelle de Jacob) ?
Il me semble que je n’écrirai plus de romans. Je pense qu’à notre époque le genre de la nouvelle a pris le pas sur la forme romanesque. Tout est très concentré de nos jours, les gens ont peu de temps pour lire, et tout le monde a envie de recevoir des communications, y compris littéraires, sous une forme plus brève. Moi-même, j’ai envie de m’exprimer de façon plus laconique.
Dans Le corps de l’âme, vous faites en avant-propos un éloge vibrant des amitiés féminines qui se termine ainsi : « J’ai besoin de vous telles que vous êtes – d’ailleurs je suis bien votre pareille. » Les femmes sont présentes dès le début de votre œuvre, avec Sonietchka. Les recueils Un si bel amour ou Mensonges de femmes sont autant de manières de les décrire. Le chapiteau vert prend comme point de départ l’amitié entre trois garçons mais les femmes y occupent aussi une place extraordinaire. Médée est peut-être le personnage féminin le plus marquant de votre œuvre. Pourquoi cette importance accordée aux femmes dans votre œuvre qui s’attache à décrire l’histoire du XXe siècle russe ?
Ce que je vais dire va peut-être sembler vexant aux hommes russes. Mais je suis depuis longtemps d’avis qu’en Russie les femmes sont de bien meilleure qualité que les hommes. Pour de nombreuses raisons, mais la raison profonde, la principale, c’est que la femme, en produisant et en élevant la descendance, est responsable de l’avenir, alors que le rôle de l’homme en tant que soutien de famille a été fortement ébranlé à l’époque soviétique. En Russie, c’est la femme qui, au prix d’immenses efforts, réussit à assurer l’éducation des enfants tout en leur procurant le nécessaire pour vivre, et très souvent, malheureusement, sans l’aide des hommes. Il y a à cela de nombreuses raisons, y compris purement démographiques. La prédominance des femmes dans la population est due à trois facteurs : les guerres, petites et grandes, qui coûtent la vie surtout aux hommes ; la prison, dans laquelle se trouvent un grand nombre d’hommes en âge de procréer ; et l’alcoolisme, qui ne favorise pas non plus la reproduction. Si bien que les femmes se retrouvent en charge des fonctions qui étaient autrefois celles des hommes.
Comment est né le personnage de Médée ? Comment explorez-vous ses liens avec sa terre, la Crimée, et avec l’histoire russe ?
J’ai rencontré des femmes de cette trempe, je n’ai pas inventé mon personnage. Le lien des gens avec leur lieu de naissance a toujours été très fort, et chaque être humain porte la trace de son origine. Pour les uns, ce lien peut être désagréable, associé à des traumatismes de l’enfance, tandis que pour d’autres c’est une source de force et de sens moral. Je viens d’une famille de gens dignes d’estime, j’admire énormément ma grand-mère Eléna et mon grand-père Jacob, ils sont pour moi de magnifiques exemples de fermeté, de courage et d’intégrité. La femme qui a servi de modèle à Médée était l’une des personnes remarquables de son époque, et j’avais envie que sa mémoire reste vivante dans le personnage de Médée.
Pourquoi accordez-vous une place si importante à l’enfance dans votre œuvre ?
Ce n’est pas seulement dans mes livres que l’enfance tient une grande place, mais dans la vie de chaque personne. On peut s’en rendre compte comme ne pas y réfléchir mais, tous, nous sommes « natifs de notre enfance ».
Vous conjuguez poésie des corps et poésie des paysages. Les territoires et les corps sont-ils toujours liés ? En quoi ces liens entre corps, espace et, évidemment, politique sont-ils importants dans votre œuvre ?
Vous me posez une question compliquée qui ne m’avait jamais été posée… D’après de nombreux paramètres, l’être humain, en dépit de l’immense chemin accompli au cours de son évolution, reste toujours un animal. La science moderne en sait beaucoup sur le lien entre un être humain et son lieu de naissance, ne serait-ce que par la composition des micro-éléments de son milieu et du corps de l’homme lui-même. Mais, pour l’être humain, je pense que les aptitudes héritées de ses parents, ainsi que l’éducation et l’instruction qu’il a reçues, sont bien plus importantes que l’emplacement géographique où il est né.
Pour ce qui est de la politique, je ne peux rien en dire, elle m’intéresse peu en tant que telle, je suis beaucoup plus intéressée par l’homme lui-même, par la façon dont il réagit dans différentes circonstances de la vie, y compris politiques. Il existe des systèmes politiques qui favorisent la manifestation de divers traits de la nature humaine : dans certains cas, la bassesse, dans d’autres de magnifiques qualités. Nous le savons bien par notre expérience personnelle. Je ne me suis pas fixé pour tâche d’étudier les liens dont vous parlez, c’est plutôt la tâche des sociologues, des politologues, des démographes. Sans doute me suis-je parfois retrouvée sur ce terrain, mais je n’écris pas des essais scientifiques, j’écris des œuvres littéraires, qui parlent avant tout de l’être humain et de ses problèmes, et non des questions sociales, lesquelles sont étudiées par des scientifiques.
Le merveilleux surgit dans certains récits, dans vos romans, le recours à la magie, à la sorcellerie. D’où vient-il ? En quoi est-il important alors que vous puisez aussi dans l’histoire ? Est-ce une manière de rendre sensible la poésie de toutes les existences que vous racontez ?
Le merveilleux et la magie existent dans la vie des hommes, du moins pour ceux qui y sont sensibles. La culture humaine ne pourrait pas exister si l’homme était uniquement occupé à se nourrir et à se reproduire. Tous ces phénomènes auxquels vous faites allusion témoignent d’un mouvement très ancien qui porte l’homme vers un principe supérieur, vers la prise de conscience qu’il y a dans l’ordre du monde Quelque Chose qui n’a pas été inventé par l’homme, et qui exige des efforts pour être compris. Pour ce qui est de « poétiser » la vie, là, je ne peux rien dire. Il me semble que la vie n’a pas besoin de cela.
Quelle place occupent dans votre vie les rêves et les phénomènes surnaturels ?
Je suis très attentive à mes rêves, j’essaie de m’en souvenir, j’ai même un cahier dans lequel je les note. Aujourd’hui, j’ai rêvé que je me trouvais au bord d’un trottoir avec un monceau d’affaires que j’avais du mal à porter, j’attendais une voiture qui surgissait au coin de la rue. Mais elle n’arrivait pas jusqu’à moi, elle tournait avant. Je devinais que c’était dans la rue Perepelinaïa [une rue de Moscou]. Ce rêve n’a rien de surnaturel. Je pense que c’est un rêve typique d’émigrant. Quant aux phénomènes surnaturels, la vie ne m’a pas gâtée dans ce domaine.
Dans Le chapiteau vert, la littérature occupe une place primordiale comme moyen de résister au pouvoir, de respirer autrement, ailleurs. Aujourd’hui, la littérature possède-t-elle encore cette force politique ?
Je pense que oui. Mais je me trompe peut-être.
Vous êtes l’auteure russe la plus lue aujourd’hui. À qui voulez-vous vous adresser avant tout lorsque vous écrivez ?
Pour être franche, je suis tout à fait satisfaite des lecteurs que j’ai. Ils sont comme moi, ils ont le même niveau de culture, les mêmes intérêts. D’ailleurs, au fond, chaque auteur a pour lecteurs des gens qui ont la même conception du monde que lui.
Sophie Benech, quelle relation entretenez-vous avec l’œuvre de Ludmila Oulitskaïa ?
Sophie Benech : J’ai traduit tous les livres de Ludmila Oulitskaïa, à l’exception du premier. Nous avons pour ainsi dire débuté ensemble, au début des années 1990, elle dans sa carrière d’écrivain et moi dans ma carrière de traductrice. Je me sens très proche d’elle en tant que personne, et nous partageons sur beaucoup de points la même perception du monde. Ce qui est bien sûr d’une grande aide pour la traduire. J’essaie de rendre son intonation, sa voix, ce mélange de poésie et d’humour qui la caractérise, et ce n’est pas toujours facile. Certaines images, chez elle, sont parfois assez ardues à traduire. J’ai le souvenir d’avoir passé des heures sur certains passages. J’admire son extraordinaire sens de l’observation, le regard à la fois acéré et tendre qu’elle porte sur les gens, son art de bâtir des histoires à partir de ce qu’elle rencontre et vit, en donnant à tout ce qu’elle décrit une coloration très personnelle, en révélant des dimensions cachées dans chaque destin qu’elle raconte, parfois en quelques mots. J’admire son discernement, son goût du concret allié à un sens du merveilleux et du mystère, son art d’être à la fois profonde et drôle. Comme tous les auteurs que j’ai traduits, elle tient une grande place dans ma vie et elle a contribué à l’enrichir.
Que pensez-vous des appels depuis le début de la guerre en Ukraine à écarter aujourd’hui la culture russe, les artistes russes ?
Sophie Benech : Pour ce qui est de la culture russe en général (Tchaïkovski, Dostoïevski…), je trouve bien sûr cela parfaitement absurde et même stupide. Quant aux artistes russes d’aujourd’hui, dans leur grande majorité ils sont plutôt opposés à cette guerre ; rares sont ceux qui soutiennent officiellement et à haute voix les agissements du pouvoir. Je pense qu’il faut soutenir les artistes et non leur faire payer ce dont ils ne sont pas responsables. On se rend mal compte, ici, de ce que c’est que vivre sous un régime de terreur dans lequel on n’a aucun droit… Dans des périodes comme celle que nous vivons, l’art et la culture sont peut-être les derniers ponts qui restent entre des gens qui se dressent (que l’on dresse) les uns contre les autres, et ces ponts-là, il ne faut surtout pas les faire sauter !
Propos recueillis par Gabrielle Napoli












