Au cœur de La stupeur, dernier roman écrit par Aharon Appelfeld (mort en 2018), il y a Iréna. C’est une jeune femme qui fuit son village, son mari brutal, et veut, animée d’une foi nouvelle, échapper à l’effroi et à la honte. En même temps que ce roman, est réédité L’héritage nu, une série de trois conférences données aux États-Unis ; Valérie Zenatti a pris appui sur le manuscrit original en hébreu pour enrichir cette version. Frédéric Worms éclaire en philosophe l’œuvre du romancier israélien.
Aharon Appelfeld, La stupeur. Trad. de l’hébreu par Valérie Zenatti. L’Olivier, 256 p., 22 €
L’héritage nu. Trad. de l’anglais par Michel Gribinski. Postface de Frédéric Worms. L’Olivier, coll. « Les feux », 120 p., 10,90 €
Tout commence par le moment du réveil. Iréna éprouve un sentiment de soulagement. Elle n’a pas eu à subir la brutalité d’Anton, son mari. Il est sorti travailler, elle est seule. Mais ce qu’elle voit de sa fenêtre est plus que pénible, effrayant : les Katz, ses voisins, sont alignés devant l’épicerie familiale. Ilitch, un vieux gendarme, les surveille. Il respecte « les ordres ». Lesquels viennent des Allemands, « des êtres responsables et cultivés ». Au bout de quelques jours, le couple et ses deux filles auront creusé une fosse avant d’être exécutés. On est en Ukraine, vers 1942.

Aharon Appelfeld © Patrice Normand
Le narrateur du roman d’Aharon Appelfeld ne donne pas de dates. Il cite deux noms de villes, Kimpolung (aujourd’hui Câmpulung Moldovenesc) et Czernowitz, la seconde servant fréquemment de cadre aux romans de l’auteur. Deux lieux, simples décors pour rappeler une époque, l’avant-guerre, quand la capitale de la Bucovine se rêvait en petite Vienne et lisait Zweig. Maintenant, c’est un autre temps, et Iréna accomplit un autre parcours dans la campagne, à travers les forêts, au bord de la rivière Pruth qui fait la frontière avec la Roumanie, ou d’auberge en auberge. C’est là que, dans bien des romans européens, on se rencontre, on parle et on raconte.
Des retours en arrière font connaitre cette jeune femme craintive, soumise à son mari. Des maux de tête la protègent de ses pressions, plus proches du viol que de la tendresse amoureuse. Ils n’ont pas d’enfant, il le lui reproche. Le seul lien auquel tient la jeune femme l’unit à sa tante Yanka, qui vit isolée dans la montagne. Iréna fuira chez elle, d’abord, et comprendra pourquoi cette tante a pris ses distances.
Iréna s’en veut d’avoir laissé Ilitch assassiner les Katz. Pourtant, elle entretenait avec eux, et avec Adéla en particulier, des rapports teintés de méfiance et d’envie : Adéla a son âge, elle est depuis toujours la bonne élève. Ses parents lui paient des études d’infirmière. Iréna a travaillé chez les Katz et n’a pu tout à fait échapper à ce que ses parents colportaient sur les Juifs. Les clichés antisémites habituels. Mais, quand elle a vu les villageois du coin piller l’épicerie et la maison, fouiller dans le jardin pour trouver une caisse remplie d’or, elle a éprouvé de la honte, s’est sentie coupable de ce qu’elle avait pu fugitivement éprouver. L’errance qui constitue l’essentiel du roman est la quête d’une réparation et d’une rédemption. Iréna, qui n’a pas appris à prier et ne connaît l’Histoire sainte qu’à travers quelques images naïves, sent que la souffrance de Jésus reste présente. À des paysans qui l’insultent, elle répond : « Jésus était juif. Son père et sa mère étaient juifs. Les Juifs assassinés sont la chair de notre chair. »
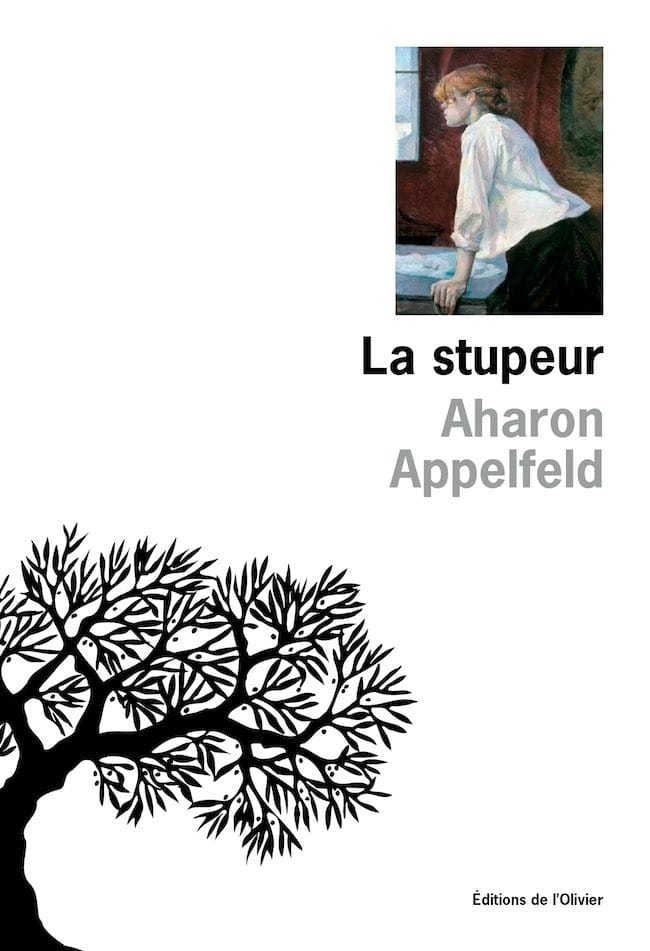
Les lieux qu’elle traverse prennent une autre dimension : la rivière Pruth ressemble au Jourdain ; une représentation de saint Jean-Baptiste, dans une église, lui rappelle que l’eau purifie. Les Carpates et la Galilée se confondent. Parfois, Iréna reçoit des pierres, est traitée de sorcière. Souvent des femmes l’approchent, disent leur effroi ou leur douleur devant le crime commis, et la jeune errante les rassure et les réconforte. Elle incarne un message et, jusqu’au bout, elle marche et parle.
L’œuvre d’Appelfeld est riche en portraits de femmes. De Tsili, la fillette qui fuit dans les forêts, à Mariana, la prostituée qui cache un jeune garçon dans La chambre de Mariana, en passant par les « femmes distinguées » et fragiles qui ne voient pas venir la catastrophe, toutes impressionnent, émeuvent, bouleversent. On ajoutera à cette galerie la mère de l’écrivain, dont il évoque le mysticisme et l’hypersensibilité dans Mon père et ma mère. Elle fréquentait les monastères, pleurait en écoutant Bach. Iréna et sa tante Yanka lui ressemblent. Mais tout fait écho chez le romancier israélien. Frédéric Worms, dans sa postface à L’héritage nu, montre comment l’écrivain a eu besoin de s’éloigner, par l’écriture de Tsili, de son expérience personnelle, pour y revenir dans Histoire d’une vie et dans ses romans.
Si Iréna est la présence qui domine dans La stupeur, ce terme de stupeur s’applique d’abord à Blanka Katz, sœur cadette d’Adéla. Elle souffre d’un retard, elle ne parle guère et fait l’objet de moqueries, d’insultes et autres humiliations. Sa mère la tient à l’écart. Elle aide à l’épicerie, sans contact avec la clientèle. Son « idiotie », au sens où, par exemple, Benjy l’incarne dans Le bruit et la fureur, joue comme révélateur de la vraie bêtise : celle liée à l’ignorance, à cet antisémitisme au quotidien qui sévissait dans la Hongrie que décrit Edith Bruck dans Le pain perdu, dans la Pologne rurale ou ailleurs en Europe centrale.

Mais Blanka est aussi la « porte-parole » d’Appelfeld. Il était « le garçon qui ne voulait pas dormir », il était aussi l’enfant mutique et presque sauvage qui traverse ses romans. Et un autre personnage se tait dans La stupeur. C’est Katz, l’épicier qui a eu le typhus. Il n’est pas que taciturne ; il n’écoute pas Iréna quand elle lui conseille de faire fuir ses filles du village vers la forêt. Le silence d’Appelfeld, on le retrouve dans ses phrases, dans leur économie stricte, dans ce qu’elles taisent plus qu’elles ne disent. Oh non, pas ce « style » qui consiste à utiliser le présent et un parler qui se croit moderne, non, une précision que trois adjectifs permettent de cerner. Ainsi des parents d’Iréna, « charnus, méfiants et amers », ou du silence, « estival, épais, étal ». Jamais de point d’exclamation, un minimum d’« expression ».
Comme dans les contes, comme chez Kafka dont Appelfeld était un grand lecteur, tout peut s’incarner en un mot et se déployer. La forêt, le chemin, la rivière, existent. Les auberges sont des havres, des refuges, et l’on y dit sa peur, on s’y confie, comme le fait la prostituée mélancolique qui a aimé Max, un homme respectueux, différent de tous les autres. Entre les femmes qui peuplent ce beau roman, il n’y a pas de hiérarchie, pas de différence. Toutes à leur manière sauvent ce qui reste d’humanité.






![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)





