 Cinq poétesses et poètes, cinq titres, cinq paragraphes, cinq signatures ; mais quatrième épisode de notre chronique « À l’écoute », consacrée aux voix de la poésie contemporaine.
Cinq poétesses et poètes, cinq titres, cinq paragraphes, cinq signatures ; mais quatrième épisode de notre chronique « À l’écoute », consacrée aux voix de la poésie contemporaine.
Thierry Metz, Terre. Peintures de Véronique Gentil. Pierre Mainard, 64 p., 15 €
 « Je ne vis qu’en ce que j’ai à écrire », nous dit Thierry Metz (1956-1997) dès la première page. Il ne vit donc pas pour écrire mais pour le dedans de l’écriture, toutes ces choses que les mots désignent et qui constituent sa vie quotidienne, l’herbe, le nuage, l’oiseau, l’arbre, le pain, la table, la sauge et surtout la main… En les liant, il en fait une corde, puis un chemin entre lui et « l’inachevé ». Ce qu’il tente de nommer par le poème, dans une sorte de balbutiement (« comme on écrit sur une table bancale ») est ce qu’il y a d’irréductible dans la réalité, sa part énigmatique qui renvoie à l’énigme de toute parole comme de toute vie. Pour créer le déclic, il suffit d’un rien : « C’est le jour, c’est le ciel, c’est le bonjour d’un passant qui a servi d’appât ». Le concret n’est jamais occulté chez ce poète qui a vécu « en maçon de sa langue », « entre l’encre et la chaux », mais il en révèle une verticalité en « suivant le sol et le ciel ». Et, avec Thierry Metz, il y a toujours « un peu de terre en haut de l’arbre ». Alain Roussel
« Je ne vis qu’en ce que j’ai à écrire », nous dit Thierry Metz (1956-1997) dès la première page. Il ne vit donc pas pour écrire mais pour le dedans de l’écriture, toutes ces choses que les mots désignent et qui constituent sa vie quotidienne, l’herbe, le nuage, l’oiseau, l’arbre, le pain, la table, la sauge et surtout la main… En les liant, il en fait une corde, puis un chemin entre lui et « l’inachevé ». Ce qu’il tente de nommer par le poème, dans une sorte de balbutiement (« comme on écrit sur une table bancale ») est ce qu’il y a d’irréductible dans la réalité, sa part énigmatique qui renvoie à l’énigme de toute parole comme de toute vie. Pour créer le déclic, il suffit d’un rien : « C’est le jour, c’est le ciel, c’est le bonjour d’un passant qui a servi d’appât ». Le concret n’est jamais occulté chez ce poète qui a vécu « en maçon de sa langue », « entre l’encre et la chaux », mais il en révèle une verticalité en « suivant le sol et le ciel ». Et, avec Thierry Metz, il y a toujours « un peu de terre en haut de l’arbre ». Alain Roussel
Sophia de Mello Breyner Andresen, La nudité de la vie. Trad. du portugais par Michel Chandeigne. Chandeigne, 176 p., 19 €
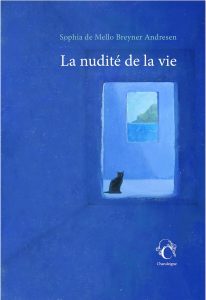 La poésie de Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004), telle qu’elle s’offre à nous dans La nudité de la vie, anthologie aujourd’hui republiée par les éditions Chandeigne, est aussi dense et ramifiée que son nom prête au rêve et à la beauté : « Je me suis perdue dans la sordidité d’un monde / Je me suis sauvée dans la limpidité de la terre ». Ses vers viennent s’inscrire dans notre mémoire éblouie comme un dessin de sable en attente de la houle, entre lumières et ténèbres. « Terreur de t’aimer dans un site aussi fragile que le monde ». Jamais sa poésie ne hausse le ton : sa pudeur a des réserves de bonté et de grâce, sa discrétion a des patiences de Pénélope et des mailles d’envoûtement. C’est dans une adresse à Pessoa que nous trouvons le résumé le plus pur de son art (si jamais art se résume) et le visage nimbé de silence de son éthique humaniste, faite de tendresse et d’effacement lent : « Avec une précision méticuleuse tu dessinas les cartes / Des multiples navigations de ton absence ». Louis Paillloux
La poésie de Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004), telle qu’elle s’offre à nous dans La nudité de la vie, anthologie aujourd’hui republiée par les éditions Chandeigne, est aussi dense et ramifiée que son nom prête au rêve et à la beauté : « Je me suis perdue dans la sordidité d’un monde / Je me suis sauvée dans la limpidité de la terre ». Ses vers viennent s’inscrire dans notre mémoire éblouie comme un dessin de sable en attente de la houle, entre lumières et ténèbres. « Terreur de t’aimer dans un site aussi fragile que le monde ». Jamais sa poésie ne hausse le ton : sa pudeur a des réserves de bonté et de grâce, sa discrétion a des patiences de Pénélope et des mailles d’envoûtement. C’est dans une adresse à Pessoa que nous trouvons le résumé le plus pur de son art (si jamais art se résume) et le visage nimbé de silence de son éthique humaniste, faite de tendresse et d’effacement lent : « Avec une précision méticuleuse tu dessinas les cartes / Des multiples navigations de ton absence ». Louis Paillloux
Yvon Le Men, À perte de ciel. Bayard, 196 p., 16,90 €
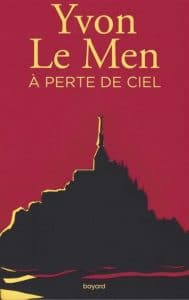 Il y a des poètes aujourd’hui qui n’ont pas froid aux yeux et pour lesquels aucun sujet n’est tabou. Il y a des poètes qui font le choix d’écrire dans une langue simple, avec des mots justes, et qui souhaitent être lus par le plus grand nombre possible de lecteurs. Il y a, enfin, des poètes qui chaque jour font une déclaration d’amour à notre langue, la langue française. Yvon Le Men, Goncourt de la poésie 2019, est de ceux-là. Dans À perte de ciel, l’un de ses plus récents ouvrages, il a choisi d’évoquer le Mont-Saint-Michel sous la forme d’un livre « poème » d’environ deux cents pages. Un chant, presque, ou un récit, avec des chapitres, et des titres pour chacun de ces chapitres : « Sauf en rêve », « Dimanche en majuscule », « Causes communes »… Le projet est à la fois ambitieux et généreux, puisqu’il s’agit ici de relater l’histoire des civilisations à travers celle d’un lieu de pèlerinage éternel, unique, le Mont-Saint-Michel lui-même. Par endroits, des fulgurances et des respirations en même temps. « Au plus haut va ta prière / du plus bas elle naît ». Yvon Le Men sait parler à toutes nos humanités. Thierry Renard
Il y a des poètes aujourd’hui qui n’ont pas froid aux yeux et pour lesquels aucun sujet n’est tabou. Il y a des poètes qui font le choix d’écrire dans une langue simple, avec des mots justes, et qui souhaitent être lus par le plus grand nombre possible de lecteurs. Il y a, enfin, des poètes qui chaque jour font une déclaration d’amour à notre langue, la langue française. Yvon Le Men, Goncourt de la poésie 2019, est de ceux-là. Dans À perte de ciel, l’un de ses plus récents ouvrages, il a choisi d’évoquer le Mont-Saint-Michel sous la forme d’un livre « poème » d’environ deux cents pages. Un chant, presque, ou un récit, avec des chapitres, et des titres pour chacun de ces chapitres : « Sauf en rêve », « Dimanche en majuscule », « Causes communes »… Le projet est à la fois ambitieux et généreux, puisqu’il s’agit ici de relater l’histoire des civilisations à travers celle d’un lieu de pèlerinage éternel, unique, le Mont-Saint-Michel lui-même. Par endroits, des fulgurances et des respirations en même temps. « Au plus haut va ta prière / du plus bas elle naît ». Yvon Le Men sait parler à toutes nos humanités. Thierry Renard
Lorrie Jean-Louis, La femme cent couleurs. Mémoire d’encrier, 104 p., 12 €
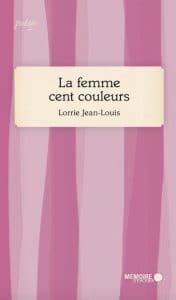 Elle a « le cœur boréal / en océan indien / un souffle d’aigle / un pas d’outarde ». Elle « chante en créole / bifurque en espagnol ». Elle existe multiple, n’existe pas : « Forme sans voix / je ne suis pas l’auteure de mon nom / je ne suis pas / mirage ». On la voit partout nulle part : « Je figure / je suis figurante / ma couleur parle pour moi » Elle est d’ici là-bas : « J’habite / je déshabite / je recommence ». La femme cent couleurs de Lorrie Jean-Louis est un petit livre comme il s’en lit rarement aujourd’hui. Il ne tient qu’à un fil et ce fil le tient tout au long de ce qui pourrait s’appeler un poème-rivière (comme il y a des romans-fleuves !). Phrase ductile et fragile, sujet qui suit le cours d’une géographie personnelle et universelle, langue qui prend la couleur de celle qui parle : « tous les tons sortent de mes lèvres », épouse les contours d’une autre langue, de toutes les langues, traverse ou renverse l’Histoire, c’est selon. À la fin, elle devient sa propre boussole, manière de flotter, envers et contre tout : « J’ai perdu le nord / il faudra inventer un nouveau point cardinal ». Roger-Yves Roche
Elle a « le cœur boréal / en océan indien / un souffle d’aigle / un pas d’outarde ». Elle « chante en créole / bifurque en espagnol ». Elle existe multiple, n’existe pas : « Forme sans voix / je ne suis pas l’auteure de mon nom / je ne suis pas / mirage ». On la voit partout nulle part : « Je figure / je suis figurante / ma couleur parle pour moi » Elle est d’ici là-bas : « J’habite / je déshabite / je recommence ». La femme cent couleurs de Lorrie Jean-Louis est un petit livre comme il s’en lit rarement aujourd’hui. Il ne tient qu’à un fil et ce fil le tient tout au long de ce qui pourrait s’appeler un poème-rivière (comme il y a des romans-fleuves !). Phrase ductile et fragile, sujet qui suit le cours d’une géographie personnelle et universelle, langue qui prend la couleur de celle qui parle : « tous les tons sortent de mes lèvres », épouse les contours d’une autre langue, de toutes les langues, traverse ou renverse l’Histoire, c’est selon. À la fin, elle devient sa propre boussole, manière de flotter, envers et contre tout : « J’ai perdu le nord / il faudra inventer un nouveau point cardinal ». Roger-Yves Roche
Sophie Loizeau, Les épines rouges suivi de Feue et Mes cahiers de Malte. Le Castor Astral, 136 p., 12 €
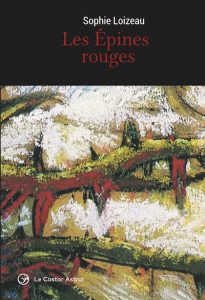 Sophie Loizeau construit une œuvre depuis plus de vingt ans. Les épines rouges est un livre de souffrance et de deuil qui, plus que les précédents peut-être, confie au lecteur les clés de l’univers de la poète. En couverture, un détail du pastel du même nom d’Odilon Redon donne un ton. Le pastel dans son entier représente une femme dont le corsage est pénétré par les épines. Disparition des parents et plus particulièrement du père, le recueil débute par une description des ronces, précise, presque botanique. Les vers libres (parfois un mot) dont la césure, le rythme comme syncopé, permettent une lecture à souffle d’œil – comme si le texte se jouait du format de la page. L’écriture est prolongement du moi, déclaration à la nature. Un bestiaire et une palette chromatique complètent le voyage onirique. Diane chasseresse est là, jamais loin dans l’œuvre de Sophie Loizeau. Tous les poèmes sont portés par l’adieu à la maison d’enfance, la maison d’écriture. Le livre fermé, le mystère essentiel demeure, qui ouvre sur les relectures. Catherine Champolion
Sophie Loizeau construit une œuvre depuis plus de vingt ans. Les épines rouges est un livre de souffrance et de deuil qui, plus que les précédents peut-être, confie au lecteur les clés de l’univers de la poète. En couverture, un détail du pastel du même nom d’Odilon Redon donne un ton. Le pastel dans son entier représente une femme dont le corsage est pénétré par les épines. Disparition des parents et plus particulièrement du père, le recueil débute par une description des ronces, précise, presque botanique. Les vers libres (parfois un mot) dont la césure, le rythme comme syncopé, permettent une lecture à souffle d’œil – comme si le texte se jouait du format de la page. L’écriture est prolongement du moi, déclaration à la nature. Un bestiaire et une palette chromatique complètent le voyage onirique. Diane chasseresse est là, jamais loin dans l’œuvre de Sophie Loizeau. Tous les poèmes sont portés par l’adieu à la maison d’enfance, la maison d’écriture. Le livre fermé, le mystère essentiel demeure, qui ouvre sur les relectures. Catherine Champolion












