Reprenant au formalisme russe la définition de « l’art comme procédé », l’historien italien Carlo Ginzburg a souligné la fécondité de la méthode de « l’estrangement » en histoire et en littérature ; il relève alors deux caractéristiques des pages de Victor Chklovski, le critique et écrivain russe dont il reprend le concept : leur « pouvoir de fascination » et leur « insolence juvénile ». Deux attributs qui caractérisent le chef-d’œuvre de Sholem-Aleikhem (1859-1916), Motl, fils du chantre, récemment paru aux éditions de L’Antilope dans la brillante traduction de Nadia Déhan-Rotschild et Evelyne Grumberg, tandem de traductrices du yiddish rodé de longue date à l’humour tendre et acerbe de l’auteur juif ukrainien.
Sholem-Aleikhem, Motl, fils du chantre. Trad. du yiddish par Nadia Déhan-Rotschild et Evelyne Grumberg. L’Antilope, 282 p., 22 €
Si l’art est, selon Chklovski, une « désautomatisation » du réel et de sa perception, il est par-dessus tout le « moyen de voir quelque chose devenir ; ce qui a réellement été n’a aucune importance ». Cette affirmation, loin de nier le poids de la réalité documentaire, établit plutôt l’autonomie de la vision artistique, redessinée comme procédé « expressément soustrait au monde de la perception automatisée ». Utilisant la forme du monologue et le facteur d’étrangéisation que constitue la voix d’un enfant, Sholem-Aleikhem convoque à la fois la généralité du mythe et le dépassement de l’expérience collective de l’émigration pour dessiner, dans sa toute dernière œuvre, l’utopie vibrante de la jeunesse contre les limitations plus ou moins atroces du réel à l’œuvre dans l’histoire, celle des Juifs en particulier. Car, s’il a lui-même partagé cette page tragique de l’histoire russe des pogromes et de la tentative d’acclimatation à la vie américaine, l’intention de l’auteur, comme à son habitude, est bien de transmuer le témoignage factuel sur la misère de la bourgade juive en archétype de la résistance humaine (et juive de l’Est, en particulier) à l’adversité par le biais du langage artistique.

Sholem-Aleykhem (vers 1907)
Le choix de Motl comme narrateur de cette histoire de pauvreté et d’exil est d’une grande importance. Il implique la disparition de la persona habituelle de l’écrivain qui, sous le pseudonyme traditionnel de Sholem-Aleikhem, apparaissait dans bon nombre de cycles de nouvelles et de monologues antérieurs. Composé entre 1907, à son premier retour d’Amérique, et 1916, date de sa mort à New York lors d’un second exil causé par la guerre mondiale, publié sous forme d’abord de feuilleton dans différents journaux yiddish puis dans une traduction russe en 1910 saluée par Gorki, avant de paraitre en volume en yiddish en 1911 pour la première partie et de façon posthume pour la seconde, le chant du cygne de l’auteur, alors gravement atteint de tuberculose, semble remonter aux sources vives de l’enfance et de la nature ukrainienne pour mieux faire apparaitre les traits grinçants de la réalité du monde contemporain. Pour reprendre les termes de Ginzburg, « comprendre moins, être ingénu, rester stupéfait sont des réactions qui peuvent nous aider à voir davantage, à saisir une réalité plus profonde ».
Une incertitude plane d’emblée sur l’âge de l’enfant : cinq ou six ans, comme dans la version traduite ici, ou huit neuf ans, comme dans d’autres parutions en feuilleton. Dans les deux cas, ressort l’ambiguïté de l’acte même de la vision par le biais du jeune personnage : à la fois innocente, étonnée, curieuse de tout, et en même temps comme inadéquate à un âge particulier, travaillée de l’intérieur par un savoir clandestin, celui d’un narrateur ironique et ventriloque, au langage à la fois si familier et si difficile à cerner, dans sa puissance expressive et symbolique réimaginée par l’art.
Car quelle fonction attribuer à ce narrateur enfantin qui semble rejeter loin de lui, en toute naïveté, la pesanteur et la morale étriquée de la vie au shtetl, sinon celle du dévoilement des apparences par le biais de l’éternelle énergie de la vie, contre les structures figées du monde social ? Comme si l’enfant était à la fois infans, figure libre encore de tout dressage coutumier et « malin génie », esprit de questionnement et de contestation ludique par rapport aux évidences acceptées passivement par le monde adulte. Loin des compromissions avec la réalité économique d’un Menahem Mendel, le Luftmensch, ou de la résignation forcée à la modernité d’un Tévié le laitier, ferraillant contre le malheur à coups de citations bibliques contrefaites, Motl, la dernière grande création de son auteur, se dresse de toute la force de sa jeune vigueur contre les puissances d’airain de l’histoire, de la maladie et de la mort, en route pour un monde en devenir que son auteur ne connaitra pas, laissant inachevées les aventures de son personnage, enfin parvenu en Amérique après de multiples épreuves.
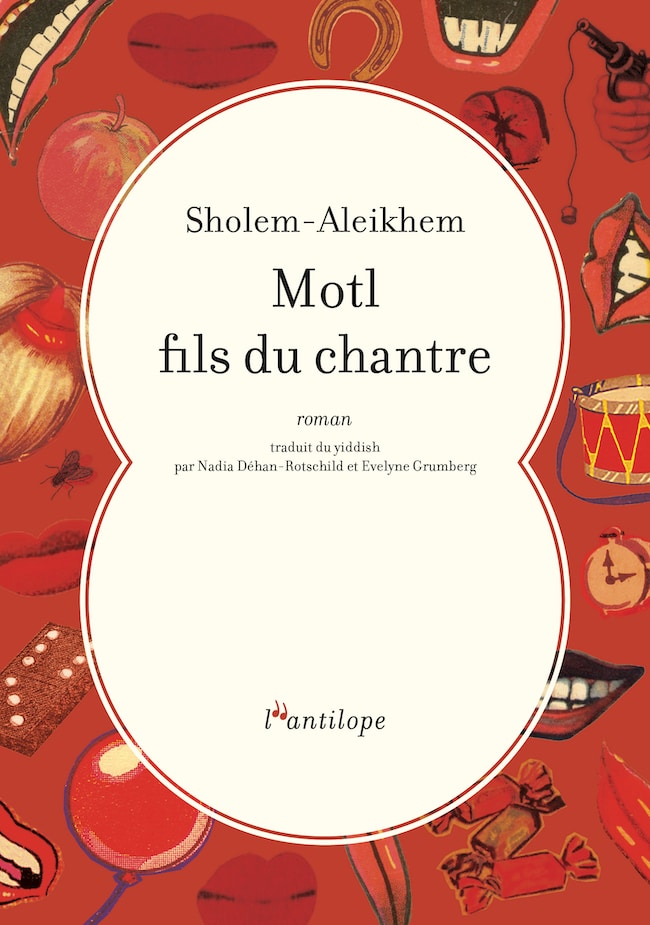
Le critique Dan Miron a reconnu dans cette œuvre ultime une indéniable parenté avec le mythe, soulignant l’atmosphère d’éternel été, la luminosité et l’impression de jouvence caractérisant les premiers épisodes retraçant l’enfance au shtetl, avant le périple qui conduit la famille sur les routes de l’émigration. Le récit, raconté à la première personne par l’enfant lui-même, débute le lendemain de Pessah par une sorte de cantique profane, une ode à la beauté de la création, et culmine avec l’épisode de la mort du père, le chantre de la communauté, le premier jour de Shavouot, fête de la renaissance printanière et du don de la Torah. La silhouette de l’enfant s’y dessine avec toute sa mobilité, sa grâce primesautière, son refus des conventions rythmant la vie collective. On l’imagine en mouvement, dévalant la colline, les pans de son maillot de prière battant au vent, lorsque son frère ainé se marie et adjoint à la famille une belle-sœur ronchonneuse et sermonneuse toujours prête à gronder Motl.
L’un des morceaux de bravoure de ces premiers épisodes est l’évocation du « paradis », un verger aux fruits tentateurs qui excite les appétits sensuels du petit garçon et l’oblige à déployer son ingéniosité pour s’emparer des objets de sa convoitise. Un peu plus tard, nous voici au plein cœur de l’été, le moment où pastèques et melons sont mûrs à point, juste avant les Jours d’affliction, la période commémorant la destruction du Temple, que l’enfant n’aime pas parce que, dit-il, « j’aime mieux quand on est joyeux ». De même lors du voyage vers l’Amérique lorsque les récits de pogromes sont récurrents chez les émigrants juifs, Motl se détourne de ces histoires de malheur, refusant de comprendre la description qu’en fait un garçon plus âgé qui les a vécues.
Loin cependant de masquer la réalité, de produire de la méconnaissance historique, ce mythe de la jeunesse jette une lumière tranchante sur la dégradation des conditions de la vie collective. C’est bien la « vie nue » qui apparait dès lors en transparence de ce bain de jouvence représenté par le regard et le discours enfantins. Par le biais d’un montage systématiquement ironique et déceptif, l’enthousiasme de la découverte du monde est renvoyé à un large panoptique de la misère et du déclin du shtetl. La maison familiale vidée progressivement de ses meubles et de ses maigres possessions pour financer le traitement (inutile au demeurant) de la tuberculose du père, les expédients déployés par le frère ainé, Elyè, pour nourrir la famille à coups de recettes tirées d’un livre enseignant comment gagner de l’argent à peu de frais, aux résultats immanquablement désastreux, la stricte hiérarchie sociale régnant à l’intérieur d’une société globalement paupérisée bientôt forcée à l’émigration de masse, les multiples attaques du monde chrétien lors du périple vers l’Amérique, les arnaques, violences et autres vicissitudes qui font du passage des frontières de véritables traquenards, et enfin, au bout du parcours, l’hypocrisie moralisante des sociétés d’aide aux émigrants, y compris à l’intérieur des structures de la philanthropie juive : toutes les déclinaisons des déplacements contraints de la société ashkénaze sont déroulées au fil du récit de Motl, lui-même exultant de bonheur de prendre la route et de quitter le shtetl.
Les choix narratifs, chez Sholem-Aleikhem, outre leur fonction carnavalesque et leur dialogisme intrinsèque, s’apparentent à une stratégie de combat minoritaire contre tous les pouvoirs régissant avec cruauté ces existences dénudées jusqu’à l’os. À l’aune des valeurs de l’enfant, tout gain, même minime, apparait ironiquement comme « miraculeux », tel ce summum du plaisir que sont pour lui les fruits (pêche et melon) consommés avec du pain, et qui rappellent les « ciboules », mets favori de l’enfant dans l’autobiographie d’Itzkhok Leybush Peretz, ou les brioches au beurre, comble du désir chez un Bontchè le silencieux (du même Peretz), autre antihéros canonique de la fiction yiddish. Motl goûte aussi les plaisirs de la nature et de la liberté, la proximité avec les animaux, tenus généralement à l’écart de la vie juive : le veau, son compagnon de jeu favori (qui finira à la boucherie), les poulains, avec lesquels il partage les courses sans frein dans la prairie, et même la chatte des voisins, à laquelle les enfants juifs infligent généralement toutes sortes de misères mais qu’il chérit malgré tout en tant que « créature » de Dieu.

Les funérailles de Sholem-Aleykhem à New York, le 15 mai 1916
La peinture archétypique d’une enfance juive dépourvue de tout mais qui transgresse comme « naturellement » les limites et les interdits reviendra sous d’autres plumes dans l’univers de la littérature yiddish, en particulier chez Israël Joshua Singer, pour qui l’enfant, comme chez Sholem-Aleikhem (mais aussi, avant lui, Mendele Moykher Sforim), est l’étalon d’une position quasi philosophique, renvoyant aux Lumières naturelles dans leur combat contre la bigoterie et l’esprit de clocher. Face à ces revendications instinctives, auxquelles fait écho, mais de façon beaucoup plus parodique, le désir d’affranchissement des jeunes adultes, le frère ainé (Elyè) et son ami Pinyè, qui ont besoin avant tout de « respirer » et de trouver à employer leurs capacités, se dessine, telle une « comédie humaine » en miniature, le « théâtre » de la vie du shtetl, image récurrente utilisée par l’observateur au regard perspicace et naturellement droit qu’est Motl. Nul besoin d’autre divertissement, en effet, que celui alimenté par la curiosité et l’esprit de facétie propres à l’enfance, rehaussés par le talent mimétique instinctif qui est celui du héros, double en cela, malgré la distance et le déguisement fictionnel, de son créateur.
Car Motl « imite », d’abord avec les gestes et les mots, ces postures élémentaires qui le poussent à « singer » les adultes, puis par le dessin et l’art de la caricature, qui n’en comportent pas moins une vocation réaliste et témoignent d’un intérêt pour l’humain en général, comme ces portraits d’émigrants, ses compagnons d’aventures, égrenant la découverte picaresque et truculente du monde, qu’il peint avec de pauvres moyens matériels et de mauvais supports, enfreignant de surcroit l’interdit juif de représentation qui entache de soupçon toute vocation illustrative de l’image. Dans ce combat de la littérature pour un rapport « éclairé » et militant à la réalité, le langage est pour l’écrivain yiddish un instrument à forger à neuf en même temps que s’élabore la fiction.
Celui de l’auteur atteint ici le point extrême de symbiose entre stylisation ludique de la langue des bourgades et conscience critique acérée de l’intellectuel des Lumières. Tout y évoque la « présence », la fiction d’une audience attentive au récit de l’enfant, applaudissant à ses tours et attrapes, suspendue au fil de ses histoires et de ses interminables digressions. Cette « fiction de présence », pour reprendre l’heureuse expression de Sophie Rabau (Honoré Champion, 2000), inscrit l’oralité dans le déroulement d’une épopée romanesque aux multiples rebondissements, dont la langue littéraire et la constitution d’un « roman national » en miniature, adapté à la minorité en devenir qu’est la vie ashkénaze, sont les véritables gains, portés par une voix d’enfant qu’on n’est pas près d’oublier : « La belle affaire ! Vous croyez que je n’y arrive pas ? Le seul ennui, c’est que je n’ai pas de tabac ! Alors je fume du papier, je fume de la paille, je fume le diable sait quoi. Mon frère Elyè s’en est aperçu. Qu’est-ce qu’il m’a passé ! Lui, il a le droit, pas moi ! Sous prétexte que je n’ai pas encore six ans. Et alors, c’est ma faute ? Je lui ai donné ma parole, j’ai juré sur la Torah que fini, je ne fumerai plus. Combien de temps croyez-vous que j’ai tenu parole ? Mais enfin, dites-moi, qui ne fume pas de nos jours ? »












