Couronné en Inde par le Hindu Prize for Fiction en 2019, Dr K est le troisième roman de Mirza Waheed, le premier à être traduit en français. En attendant Nadeau a pu rencontrer son auteur, né à Srinagar, la capitale du Kashmir, ancien journaliste (pour la BBC, The Guardian, The New York Times ou Al Jazeera English) dont les deux premiers romans ont été largement salués par la critique britannique.
Mirza Waheed, Dr K. Traduit de l’anglais (Inde) par Anatole Pons-Reumaux. Actes Sud, 272 p., 22,50 €
Le narrateur de Dr K, Kaiser Shah, a grandi au Kashmir avant de partir pour le Royaume-Uni, puis a choisi d’aller travailler dans un pays du Moyen-Orient. À la retraite, il s’établit à Londres et décide de renouer le dialogue avec sa fille, Sara, qu’il a envoyée aux États-Unis après la mort de son épouse, Atiya. La narration navigue entre plusieurs époques et plusieurs lieux et l’on perçoit quelque chose de trouble (et de troublant) sous la surface, un peu comme dans le récit de Marlow dans Au cœur des ténèbres de Conrad. Le monologue de cet homme vieillissant qui tente de justifier ses choix alterne dans la deuxième moitié du roman de Mirza Waheed avec des lettres de Sara à son père, voix secondaire qui donne un nouvel élan à l’œuvre et emmène le lecteur jusqu’aux ultimes révélations.

Mirza Waheed © Actes Sud/D. R.
Pourquoi le titre du roman paru en France est-il Dr K alors que le titre anglais est Tell Her Everything ?
Dr K a été un des titres que j’ai envisagés avant que mon agent suggère Tell Her Everything, titre qui m’a convaincu.
Pouvez-vous nous parler de la genèse du livre ?
Mes deux premiers romans se déroulent au Kashmir, mais je ne suis pas seulement un écrivain du Kashmir. J’y ai passé toute ma jeunesse, mais j’ai aussi vécu huit ans à Delhi et cela fait une vingtaine d’années que je suis à Londres.
Au moment de la naissance de ma fille, on a évoqué en ma présence le sujet de médecins amenés à exécuter des tâches qui sont en dehors de leurs attributions habituelles, même quand cela ne leur plaît pas. Ce genre de situations est lié à des questions de système politique, de gouvernement, de culture, donc à l’histoire de la migration. On oublie trop souvent que la migration n’a rien de nouveau. Pour quels emplois fait-on appel aux immigrants ? Pour ceux que personne ne sait ou ne veut faire. Le docteur de mon roman vient d’une famille aux moyens limités, il a vu son père se priver toute sa vie et il veut une vie confortable, pour lui et sa famille. Il reflète la classe moyenne d’origine indienne et son éthique de dur labeur, de concentration, de discipline et de sacrifice.
Comment le projet et le personnage ont-ils évolué ?
J’avais en germe l’idée d’un personnage qui passe dans l’obscur. Je me suis dit que, grâce au caractère malléable du roman, ça pourrait prendre la forme d’une conversation imaginée : qu’est-ce qu’il imagine, qu’est-ce qu’il risque de tenir pour acquis, y compris dans les réactions de sa fille ? C’est un personnage moralement épuisé, au-delà de la honte, mais qui au fond est comme tout le monde. Dans son grand âge, il vit confortablement mais dans la solitude.
Pendant trois ans, quand ma fille était toute petite, j’ai écrit par bribes. Le personnage et l’intrigue me restaient en tête, et quand c’est comme ça on finit par entendre quelque chose comme une voix. Ce n’est pas facile d’écrire sur la culpabilité et la honte. Le roman a un aspect rétrospectif parce qu’il faut du temps pour que les choses fassent sens. Quelle sorte de personne est-il, ce médecin ? Se définit-il par son travail ? Il se justifie en posant des questions, mais qui sont de vraies questions : ce n’est pas uniquement pour se justifier.
N’est-ce pas l’art du roman que de poser des questions sans apporter de réponses ? Dans ce roman, j’explore une hypothèse, ce qui est intéressant pour un écrivain : comment rendre réel le monde de cette hypothèse ? Comment parler d’un pays qu’on ne connaît pas ? Je n’ai jamais vécu au Moyen-Orient. Il s’agit de créer peu à peu un monde qui se tient. La vie de Kaiser au Moyen-Orient est centrée sur l’hôpital : il sort peu, le climat très chaud ne favorise pas les sorties ; tout cela permet de circonscrire l’univers du personnage. Le romancier explore la façon de penser du personnage, son âme. Ici, c’est un homme qui aime profondément sa fille mais l’éloigne malgré ce que ça lui coûte.

La Cleveland Clinic d’Abu Dhabi © CC4.0/Wikiemirati
On sent effectivement qu’il y a un secret qui pèse sur la vie de cet homme et on découvre au fil du roman qu’il a supervisé puis réalisé lui-même des amputations punitives. Et, d’une certaine façon, il ampute aussi sa propre existence en maintenant sa fille à distance. Dans votre premier roman, The Collector, qui se passe au Kashmir, le personnage principal doit récupérer des pièces d’identité sur des cadavres laissés sur des champs de bataille. Cette thématique de l’amputation, au propre comme au figuré, m’a fait penser à d’autres romans récents dont les auteurs, comme vous, ont connu des territoires en guerre : l’Ougandaise Jennifer Makumbi dans Kintu et l’Irakien Ahmed Saadawi dans Frankenstein in Baghdad.
Oui, j’ai lu Frankenstein in Baghdad où la ville elle-même est comme une créature rapiécée pleine de cicatrices, c’est une image très forte. J’ai grandi en temps de guerre ; quand les combats ont lieu dans votre quartier, vous êtes évidemment aux premières loges. Au Kashmir, région qui a été partagée entre l’Inde et le Pakistan au moment de l’indépendance, les tensions sont encore vives. Je viens d’une région magnifique, mon père travaillait dans le tourisme et nous emmenait voir des endroits comme on en voit sur les cartes postales. Mais la guerre est arrivée, avec son lot de massacres, d’assassinats, de tortures. Ce sont des choses qui restent en vous.
En quoi l’histoire de Kaiser Shah reflète-t-elle l’expérience de la migration ?
Kaiser est heureux en Angleterre, mais ne se sent pas tout à fait lui-même. Il a l’impression d’être un docteur parmi d’autres, un rouage dans une grande machine, alors qu’en Inde il était le premier de sa promo. Son statut de migrant ne le quitte jamais. Il a l’impression de devoir sans cesse faire ses preuves, ce qui affecte son amour-propre, étant donné son éducation. Se retrouver avec un job lambda au National Health Service ne le satisfait pas, et puis il y a tout l’héritage historique de l’Empire britannique. Alors il choisit la solution de facilité : un emploi dans un pays musulman au Moyen-Orient, un pays où la religion est le dénominateur commun, mais où il se retrouve en fin de compte plus isolé qu’en Angleterre. Il travaille pour un système très impersonnel qui ne s’embarrasse pas de questions morales. Ce n’est que plus tard qu’il s’interroge sur sa fonction.
Le système judiciaire y est violent, mais est-ce qu’il y a des degrés dans l’horreur ? Est-ce qu’un peloton d’exécution est moins horrible que la chaise électrique ou qu’une injection létale ? Il finit par se poser ce genre de questions, d’autant que sa fille vit dans un pays, les États-Unis, où la peine de mort est une réalité.
La relation père-fille est effectivement au cœur du roman. Le fait d’avoir une fille plutôt qu’un fils n’a d’ailleurs pas été facile pour la mère, Atiya ; elle le raconte dans un passage particulièrement prenant.
Sara aime son père, mais il y a ce moment terrible à la morgue où il l’emmène voir le corps de sa mère. Elle était encore une petite fille et cette image ne l’a jamais quittée. Si le décès avait eu lieu en Inde, il y aurait eu tout le réseau des oncles et tantes pour l’entourer, mais en l’occurrence le choc a été retentissant, sans rien pour l’amortir. C’est une manière pour moi d’évoquer ce qui se passe pour des migrants privés de véritable ancrage dans la société, ce que cela leur coûte dans tous les domaines, du plus dérisoire au plus important. Et malgré tout, Sara se construit une existence aux États-Unis et s’y fait une place.
Quant à la prééminence du fils, c’est la tradition en Inde (pas seulement en Inde, d’ailleurs) mais les choses évoluent et s’améliorent. Atiya raconte l’attitude désapprobatrice de la famille, des femmes en particulier, quand elle donne naissance à une fille – mais c’était bien pire dans le passé. De nos jours, de plus en plus de filles vont à l’école. Certes, les conceptions traditionnelles sont si profondément ancrées qu’on les envoie parfois dans des écoles moins prestigieuses que les garçons, mais il y a un vrai progrès. La famille d’Atiya vient de la noblesse et certains membres conservent des idées rétrogrades, celles du système de castes. Kaiser lui-même a subi cette pression, l’attente qu’il réussisse sa carrière pour pouvoir subvenir aux besoins de ses parents dans leur grand âge. En réalité, ce n’est plus vraiment le cas ; dans ma famille, par exemple, c’est ma sœur aînée qui s’est occupée de mon père quand il a eu le covid.

Munnar, dans le Kerala © CC4.0/Shivamsp182
Malgré sa solitude, Kaiser se lie avec un collègue anesthésiste, Biju Tharakan, venu d’Inde lui aussi, mais d’une région et d’un milieu très différents, et d’un tempérament opposé. J’ai lu une comparaison entre ces deux figures et celles de Don Quichotte et Sancho Panza. Qu’est-ce que cela vous inspire ?
Biju vient du Kerala (au sud de l’Inde), il est issu d’une famille aisée, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes pour lui. Il a l’habitude d’un certain train de vie et aime se faire plaisir, en allant au restaurant à Dubaï par exemple.
Dans Dr K, j’ai eu à cœur d’évoquer les migrants, les expatriés, les transnationaux, tout en montrant que chacun est différent. Quel que soit votre emploi, du plus précaire au plus prestigieux, en tant que travailleur étranger vous n’êtes jamais tout à fait un citoyen comme les autres. Au Royaume-Uni, on parle de « minorités », de « gens de couleur », on a même des sigles pour ça [POC pour « people of colour » et plus récemment BAME pour « Black, Asian and minority ethnic » ]. Comment une abréviation ou un sigle peuvent-ils représenter les gens ? On crée des étiquettes alors que la vie est bien plus complexe.
Quelles ont été vos influences littéraires ?
Dans mon adolescence, j’ai lu tous les romans de Thomas Hardy, j’étais fasciné par sa création de tout un univers, le Wessex. Pendant mes études, j’ai lu avec bonheur les classiques britanniques comme Dickens, mais aussi grecs, notamment Sophocle. Plus tard, je me suis intéressé à la littérature sud-africaine : je pense que Coetzee est un écrivain majeur et j’admire les romans de Damon Galgut. J’ai bien sûr lu aussi beaucoup d’auteurs indiens et pakistanais. Pankaj Mishra est pour moi l’un des meilleurs écrivains du monde. J’apprécie l’œuvre de Mohammed Hanif, qui ne ressemble à aucune autre, et celle de Kamila Shamsie. J’ai eu une phase Camus il y a une vingtaine d’années, j’ai lu toute son œuvre et plus récemment la réécriture de L’étranger par Kamel Daoud. Les autres noms qui me viennent à l’esprit sont Nadine Gordimer et Salman Rushdie.
J’ai grandi avec plusieurs langues : le kashmiri d’abord, mais on ne l’apprenait pas à l’école, si bien que je ne peux l’écrire qu’avec difficulté ; l’anglais, l’ourdou et l’hindi. Je lis l’arabe grâce à mon professeur d’études coraniques qui nous faisait lire le Coran dans la cour de sa maison où poussait un grenadier. Je le revois nous écouter déchiffrer en maniant l’aiguille, il brodait des motifs sur des tissus. Peut-être qu’un jour j’écrirai là-dessus.
Je suis heureuse que vous mentionniez Camus : le ton de Dr K, mi-dialogue mi-confidence (voire confession), m’a fait penser à La chute. C’est important à vos yeux de pouvoir lire plusieurs langues ?
Bien sûr. Mes enfants ne liront peut-être pas l’ourdou, mais mon fils apprend l’espagnol et ma fille va commencer le français. Nous vivons en Europe, c’est dans l’ordre des choses. L’anglais lui-même évolue, à Londres on entend cet anglais nourri de multiples influences, le MLE (Multicultural London English). Je vous conseille l’excellent article de Rebecca Mead paru à ce sujet dans le New Yorker. Londres est vraiment à part, différente du reste du Royaume-Uni.
On l’a d’ailleurs vu avec le Brexit. C’est pour moi une grande régression ; le Royaume-Uni que j’ai connu en arrivant il y a une vingtaine d’années était différent. J’ai l’impression que l’esprit et le cœur des Britanniques se sont rétrécis. Le Brexit n’est pas arrivé du jour au lendemain, cela dit ; le pays s’est refermé de plus en plus sur lui-même. Pourquoi tant de gens se tournent-ils vers l’extrême droite ? Au lieu de les insulter, il faut s’interroger ; certains sont dans des situations difficiles et se sentent manifestement négligés. Les démagogues au pouvoir attisent un nationalisme dangereux. Quand je pense à mon fils (il a treize ans), je me dis que ça risque de ne pas toujours être facile pour lui. Ne parlons pas de la politique migratoire, qui est aujourd’hui catastrophique, d’une abominable cruauté. Des gens frappent à votre porte pour trouver un refuge et vous les envoyez au Rwanda ? En voilà un message ! Dans le contexte de la crise ukrainienne, le Royaume-Uni s’en sortirait mieux s’il était avec l’Europe.
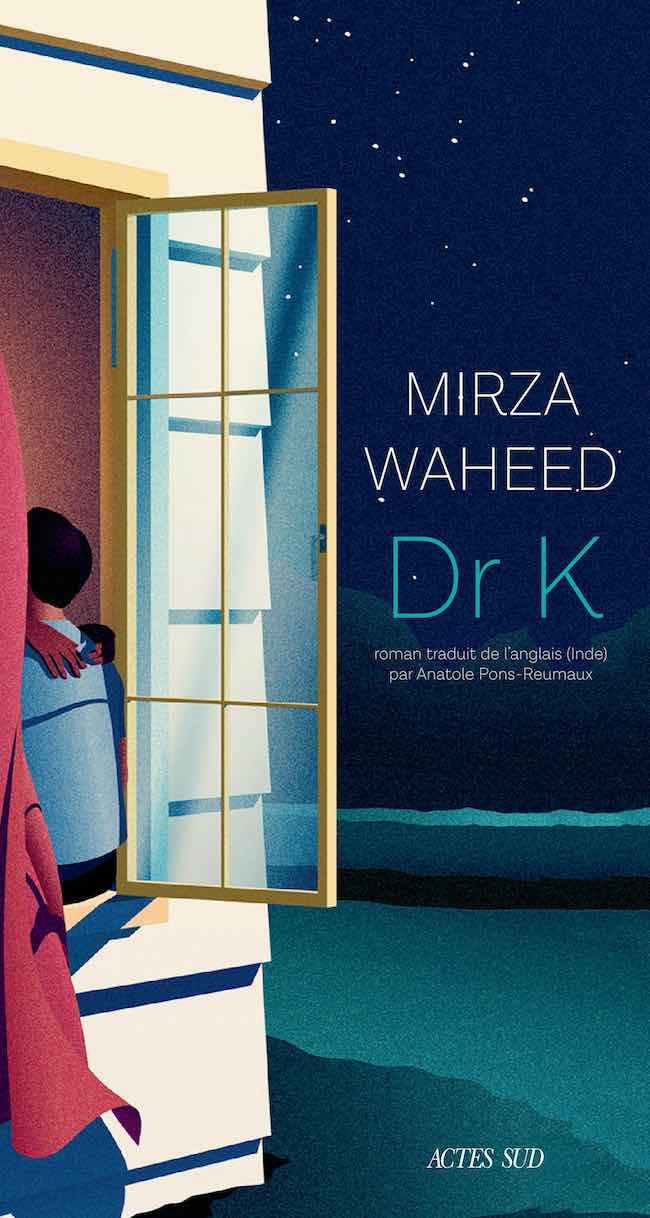
Dans le roman, Dr K choisit le Moyen-Orient plutôt que l’Occident, avant de s’établir à Londres pour sa retraite. Est-ce le signe que l’Occident est moins attirant de nos jours ?
Kaiser se retrouve dans un système dont il peut faire partie, mais il veut plus que cela, il veut bien gagner sa vie et s’impatiente dans un Royaume-Uni qui ne l’intègre pas vraiment dans la société. Il est attiré par le Moyen-Orient, un endroit où sa religion est valorisée – même si, en réalité, la culture de ce pays lui est aussi étrangère que la culture britannique. Il découvre qu’il se fait peu à peu aspirer dans un système qui ne le voit que comme un exécutant, au point qu’il n’est plus défini que par son travail.
J’ai un ami qui vit en Arabie saoudite ; avant, il vivait dans une ville occidentale, mais sa femme ne s’y plaisait pas et vivre sa foi dans un pays qui donne une grande place à l’islam lui convient davantage. Est-ce que c’est un système opprimant ? Tout dépend de votre conception de la liberté. Je n’ai jamais compris la crispation autour du voile en France… Peut-être parce que ma grand-mère, chez nous en Inde, a toujours fait ce qu’elle voulait, porter le voile comme fumer.
Avez-vous un nouveau projet de livre ?
Je travaille sur un livre où les enfants sont élevés au milieu des arbres et des animaux par un petit groupe de personnes, trois femmes et un homme, les Aînés, qui ont quitté la ville pour aller vivre dans les montagnes. Ma fille a sept ans, elle adore dessiner et me parle déjà de mettre ses dessins dans ce livre… Je pense que les questions climatiques nous interpellent tous, toutes générations confondues.
Propos recueillis par Sophie Ehrsam



![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)








