La minceur de ce recueil de poèmes de João Cabral de Melo Neto, le fait que sa publication soit soutenue par le ministère des Affaires étrangères de Bolsonaro, ne font pas croire en son importance. En commençant au hasard la lecture par les « Études pour une danseuse andalouse », on change immédiatement d’avis.
João Cabral de Melo Neto, Poèmes choisis. Trad. du portugais (Brésil) par Mathieu Dosse. Gallimard, 112 p., 12,50 €
« On dirait, lorsqu’elle surgit, / dansant des siguiriyas, / qu’elle s’identifie entièrement / à l’image du feu. » Les quarante-huit quatrains répartis en six séquences, dont la première sert de fil rouge à cet article, manifestent une telle singularité qu’on retourne à la préface pour en savoir un peu plus… Vingt-huit poèmes plus loin, la conclusion est de taille ! Si les dix-neuf livres qu’il a publiés entre 1947 et 1999 sont de ce niveau, leur auteur, João Cabral de Melo Neto (1920-1999), est l’égal d’un Carlos Drummond de Andrade et de ceux qui, en Amérique du Sud, ont marqué la littérature de la fin du XXe siècle.

João Cabral de Melo Neto (1970) © Domaine public/Archives nationales du Brésil
Tous les gestes du feu,
elle les possède alors, dirait-on :
les gestes des feuilles du feu,
de ses cheveux, de sa langue ;
les gestes du corpàs du feu,
de sa chair au supplice,
chair de feu, qui n’est que nerfs,
chair tout entière chair à vif.
Né dans une famille riche, attentif à la condition des habitants pauvres du Brésil, diplomate longtemps en poste en Espagne (d’où la danseuse andalouse), cet ami de Miró a su utiliser ses contradictions, son sens de l’observation, ses connaissances en matière d’architecture et son goût du baroque pour élaborer une poétique qui s’est démarquée des courants dominants de son pays (le sentimentalisme, le confessionnalisme et la « poésie dite profonde »). Populaire mais savante, critique de la réalité sociale mais sans recouvrement de la parole par le politique, mise en chanson mais sans rien céder de ses exigences, elle a vite rayonné dans le monde lusophone où elle a été couronnée par le prix Camões.
Alors, le caractère du feu
se devine aussi en elle :
le même goût pour les extrêmes,
d’une nature affamée,
le goût de voir finir
tout ce qui s’approche de lui,
le goût de se voir finir,
de parvenir à sa propre cendre.
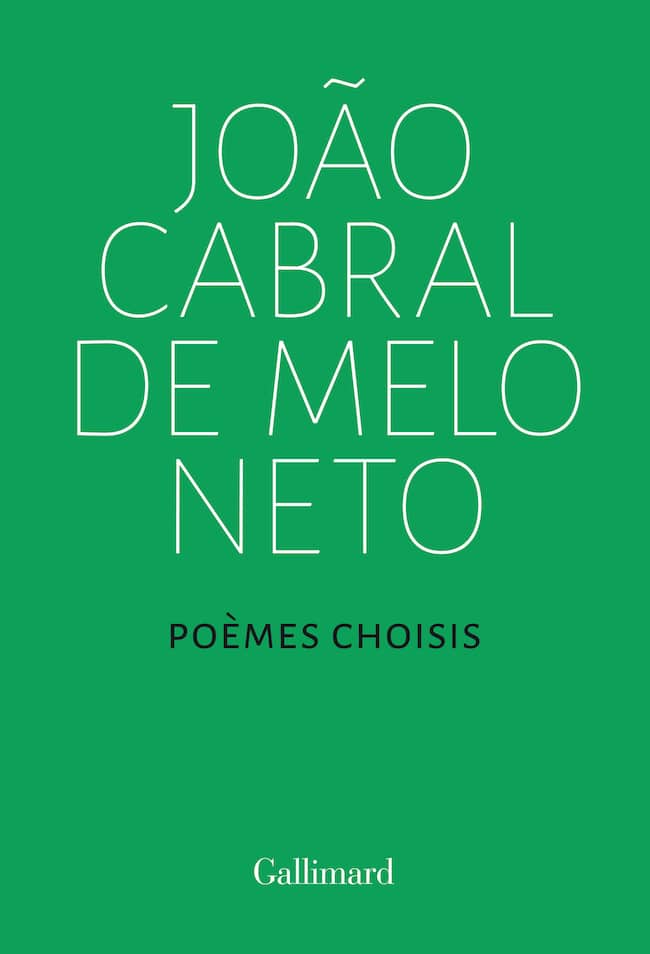
Pour le lecteur de poésie français, il y a un véritable intérêt à voir comment Cabral apporte une autre idée de la composition des images. Là où, depuis le surréalisme, régnait le comme du « stupéfiant image » qui rapproche à la vitesse de l’éclair deux réalités éloignées, il les éloigne et les relie. À grand renfort de répétitions servies par les sonorités du portugais, mais aussi en ciselant son texte, en utilisant le blanc des coupes et les signes de ponctuation, il déplie les possibles de chacun des deux pôles. Il n’est dès lors pas étonnant qu’on ait pu le qualifier de poète architecte.
Pourtant, l’image du feu
est en un point démentie :
car le feu n’est pas capable
comme elle l’est, dans les siguiriyas,
de s’arracher de soi-même
dans une première étincelle,
celle qui, lorsqu’elle le veut,
vient l’allumer fibre après fibre,
car elle seule est capable
de s’allumer en étant froide,
de s’incendier à partir de rien,
de s’incendier toute seule.
Si les livres encore à traduire sont du niveau de ce choix qui, par définition, fait l’impasse sur leurs architectures, il y a de fortes chances pour que cette œuvre parle avec force à ceux qu’indiffèrent la religiosité sans foi, le retour à une nature inexistante, les redites dadaïstes et les rimes d’une restauration dissimulant son nom. On espère donc la prochaine publication d’un volume réunissant plusieurs titres et, quitte à émettre des souhaits, en bilingue.
Trois questions à Mathieu Dosse

Mathieu Dosse © D.R.
Mathieu Dosse (né en 1978) est traducteur littéraire depuis 2013. Grand Prix de la traduction d’Arles et prix Gulbekian-Books pour sa traduction de Mon oncle le jaguar & autres histoires de João Guimarães Rosa, il a également traduit Graciliano Ramos (Vies arides, Chandeigne, 2013), Geovani Martins (Le soleil sur ma tête, Gallimard, 2019) et Augusto Boal (Miracle au Brésil, Chandeigne, 2020).
Depuis 2013, on vous doit la traduction d’auteurs tels que João Guimarães Rosa, Graciliano Ramos ou Augusto Boal… Cette fois, vous avez eu une lourde charge : donner envie de lire pour la première fois un poète disparu depuis plus de vingt ans.
Pour le présent volume, afin de respecter le cahier des charges, cent pages maximum, j’ai dû faire des choix terribles qui m’ont causé bien des nuits d’insomnie. L’attention portée aux recueils (et parfois même aux recueils de recueils) fait qu’il est souvent délicat de séparer un poème de l’ensemble dans lequel il se trouve. J’ai malgré tout choisi de présenter un choix de poèmes sans date ni référence aux recueils, afin que le lecteur français puisse, d’une certaine manière, se perdre dans cette poésie si originale et si émouvante. Mais j’ai gardé l’ordre chronologique : le lecteur pourra ainsi suivre le parcours poétique de Cabral, depuis ses premiers vers d’inspiration surréaliste jusqu’aux derniers poèmes d’une grande originalité. Cabral est le poète du dénuement, de la mort, de la dureté (« poème(s) de la chèvre » est évocateur) ; ce n’est pas le poète de la luxure, du faste. Il emploie des mots simples, des mots quotidiens, des mots réputés « non poétiques » ; pour autant, il sait aussi être un poète sensuel, presque érotique. J’ai essayé de montrer ces différents aspects avec ce recueil.
Cabral a été chanté par Chico Buarque et cela explique pour une part sa popularité au Brésil. Mais on ne trouve pas trace dans ses poèmes d’une quelconque attirance pour la chanson.
Bien qu’il ait été mis en chansons, Cabral était connu pour ne pas aimer la musique (à l’exception du flamenco, qui le fascinait). Pourtant, il y a d’évidence, dans sa poésie, une grande attention portée au rythme et aux sonorités. Dans le recueil Duas águas (Deux eaux), il sépare ses poèmes faits pour être dits à voix haute et ceux faits pour être lus en silence. La répétition, surtout, est très présente dans plusieurs vers. Pour un poète qui n’aimait pas la musique, ses vers sont très musicaux.
Peut-on penser qu’une traduction plus complète de l’œuvre accentuera sa dimension sociale ?
Cabral est issu d’un milieu favorisé, il vient d’une famille de sucriers du Nordeste. Lorsqu’il est envoyé en Europe après avoir passé le concours de l’Itamaraty (équivalent du Quai d’Orsay), il s’intéresse au marxisme. Il découvre que la mortalité dans l’État du Pernambouc, où il était né, est plus élevée qu’en Inde. Imprudemment, il écrit des lettres à ses amis où il défend ses nouvelles idées. Accusé de communisme dans les années 1950, il doit revenir à Rio de Janeiro. Après un procès, Cabral et d’autres diplomates sont expulsés de l’Itamaraty. Il devient alors un temps journaliste, traducteur… La dimension sociale est évidemment présente dans plusieurs poèmes de Cabral (par exemple dans « Chien sans plumes », qui évoque la vie misérable des « hommes-crabes » le long du fleuve Capibaribe, mais également dans d’autres poèmes qui évoquent le Sertão). Une anecdote résume bien cela : lorsqu’il était enfant, Cabral rencontrait en secret, le soir, les employés analphabètes de ses parents pour leur lire des histoires. Lorsque son père le découvrit, il lui interdit formellement de continuer.
Propos recueillis par Gérard Noiret











