Esquif Poésie (10)
Elles sont femmes et poètes, elles sont grandes par leur talent, l’une est québécoise, l’autre est argentine. Le dixième épisode d’Esquif Poésie lit ensemble L’angle noir de la joie de Denise Desautels et les Œuvres d’Alejandra Pizarnik.
Denise Desautels, L’angle noir de la joie suivi de D’où surgit parfois un bras d’horizon. Préface de Louise Dupré. Gallimard, coll. « Poésie/Gallimard », 304 p., 10,80 €
Alejandra Pizarnik, Œuvres. Trad. de l’espagnol (Argentine) par Jacques Ancet. Ypsilon, 352 p., 20 €
Denise Desautels est connue depuis longtemps au Québec. En France aussi, au moins autant que peuvent l’être les poètes qui, de plus, sont des femmes. La voici couronnée par la parution d’extraits de son œuvre dans la collection « Poésie/Gallimard ». Réjouissons-nous. D’abord parce que la collection comporte encore trop peu de femmes contemporaines et ensuite parce que Denise Desautels est absolument remarquable.
Le titre du volume, L’angle noir de la joie, est déjà, à lui seul, éblouissant. Contradiction entre les mots, association inattendue, ambiguïté (on lit presque « l’aigle » au lieu de « l’angle », ce dernier n’étant pas « poétique » au sens où on l’entend généralement). Une probité dans le refus des larmes, de l’émotion, celle-ci présente pourtant partout.

On apprend peu de choses sur la vie de l’autrice. Louise Dupré nous informe, dans sa préface, que certains de ses textes explorent « la douleur d’une enfance sans père [mort quand elle avait cinq ans] sous l’emprise d’une mère dévorante, durant la Grande Noirceur, période d’obscurantisme s’étendant de 1944 à 1960, année qui marque l’avènement de la Révolution tranquille à la suite du premier ministre Duplessis » ; qu’elle a beaucoup travaillé avec des plasticiens, qu’elle a connu des deuils nombreux et qu’elle est une des figures majeures du renouveau de la poésie féminine au Québec dans les années 1980.
S’il y a une poésie qui possède des qualités qu’on attribue en général plutôt aux hommes et à laquelle il est impossible d’attribuer un genre, c’est bien celle-là. Elle est grande, tout simplement. Énergique. Provocante. Et altière. Donnons-en quelques preuves, pour convaincre, et emporter, avec la nôtre, l’adhésion du lecteur.
Dans son texte introductif à L’angle noir de la joie, Denise Desautels déclare qu’elle écrit « comme on fait des fouilles, en archéologue de l’intime, tâtonnant dans l’ombre touffue d’une mémoire […], tiraillée entre détresse et utopie. Sous de multiples couches de protection, l’obscurité d’un monde à déminer, à nettoyer, puis à disséquer ». Pour cela, il lui faut user d’intelligence. Sa poésie est donc (d’abord ?) de la pensée et du raisonnement. Il faut tenter de nettoyer ce qui se passe au cœur des cœurs, des vies intimes, car c’est là « que ça se démène, ça lutte, ça pleure, ça crie, ça se donne bonne conscience, ça court à sa perte ». Pas seulement à cet endroit secret, pas seulement aujourd’hui après hier, également dans « le monde, la mémoire et les mots » car « il y a tant de résistance jusqu’à l’histoire vraie ».
Salutaire, estimable entreprise, qui donne des poésies qu’on peut dire en vers libres et des textes de prose, fulgurants : « De grands oiseaux d’ombre volent vieux et lents sur un horizon de contreplaqué. La vie ce qu’il en reste l’élan. Laissons sa cage s’ouvrir large volubile. Comme s’il s’agissait d’un visage. » Ce poème, ainsi que tous ceux qui composent La forêt ne tient plus, est complété par une citation en bas de page, ce qui change de l’usage. Ici, d’Alejandra Pizarnik : « CHERCHER. — Ce n’est pas un verbe mais un vertige. »
Variété des formes. Celles nommées ci-dessus. Et d’autres, comme ces poèmes en vers et caractères romains, suivis, sur la même page, d’un poème en vers mais en italique. Ou bien l’italique survient à l’intérieur du texte, par surprise, parce qu’il cite, s’approprie le vers d’un autre. Toujours les mots paraissent libres, dénués de pathos : « il y a des jours comme ça / sans poignard », « un énième chagrin – dont on ne nous a pas prévenus / s’attaque à notre joie ».
Ils affirment un courage hautain :
« surtout ne rien perdre de vue
ni ma voix ni son air de grande ressuscitée
ici, je suis désormais sans adieu »
(« Quai Rimbaud »)
Le volume s’achève par cette phrase relevée dans « Octobre », décisive, à la mesure du livre entier : « Penser haut et libre ».
Contrairement à L’angle noir de la joie, le volume publié par les éditions Ypsilon a l’ambition de restituer l’œuvre complète d’Alejandra Pizarnik. Mais à lire l’introduction aux Journaux 1959-1971, publiés dans la collection « Ibériques » des éditions José Corti, traduits de l’espagnol par Anne Picard, dans l’édition établie et présentée par Silvia Baron Supervielle, on s’aperçoit que ce n’est pas si simple. Car les journaux, comme les poèmes, ont été publiés du vivant d’Alejandra Pizarnik avec des suppressions, des corrections voulues par les éditeurs. Comment alors reconnaître, rétablir, la volonté première de l’autrice ? L’éditeur est confronté à des choix, plus ou moins explicités par Silvia Baron Supervielle, mais restés secrets chez Ypsilon.
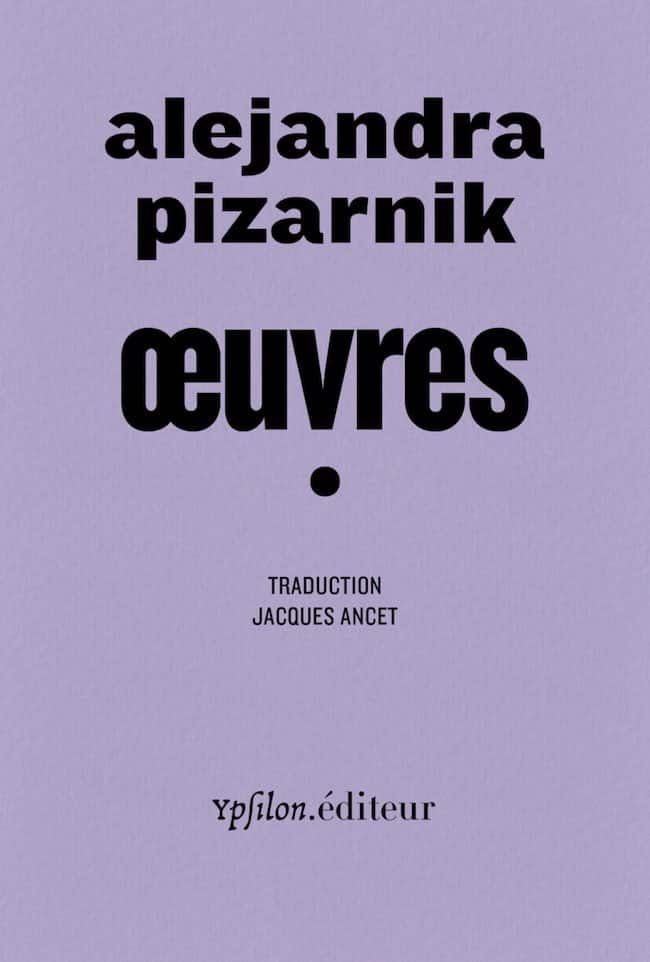
Et ce n’est pas le « Portrait approximatif » qu’en livre Liliane Giraudon à la fin du volume qui nous en apprendra beaucoup plus à ce sujet. En revanche, le lecteur peut y glaner quelques informations biographiques : Alejandra Pizarnik nait dans une famille juive très récemment émigrée de Galicie. Elle dévore, jeune, Dostoïevski, Artaud, Pierre Jean Jouve, Sade et Proust. Dessine, avec sous les yeux Jérôme Bosch, Paul Klee et Max Ernst ; a l’obsession de la prose et de l’admiration pour Virginia Woolf, Katherine Mansfield, Cesare Pavese ; mange trop et grossit ; boit trop et se le reproche ; fréquente les Argentins et traduit les Français de son époque, etc.
Même si Alejandra, contrairement à la légende, ne se serait pas donné la mort, mais serait décédée sur le chemin de l’hôpital d’une embolie pulmonaire, il paraît difficile de ne pas voir en elle une suicidée de la société, une Artaud femelle moins prolixe et moins martyrisée mais tout aussi désespérée, scandaleuse, obsédée par la mort. Son versant ténébreux n’est pas escamoté, c’est lui qui apparaît, qui resplendit ou qui fatigue. Cela dépend du goût qu’on a pour la souffrance, pour ceux et celles qui s’en éprennent. De l’usage qu’ils ou elles en font. Ainsi, quel intérêt, quel but ont les supplices longuement détaillés de La comtesse sanglante sinon de satisfaire un masochisme et un sadisme prédominants ?
Il n’empêche, certains textes sont superbes. Langage désertifié,
« alejandra alejandra
je suis dessous
alejandra » ;
mots posés sur un fil, oiseaux prêts au départ,
« Dehors, du soleil.
Ce n’est qu’un soleil
mais les hommes le regardent
et ensuite ils chantent.
Je ne sais rien du soleil.
je sais la mélodie de l’ange
et le sermon brûlant
du dernier vent.
Je sais crier jusqu’à l’aube
quand la mort se pose nue
sur mon ombre. » ;
provocations d’un caractère exceptionnel chez une femme : elle ne craint pas de poser nue, de nommer crûment caca ses défécations, d’admettre une solitude sexuelle compensée par la masturbation. Ça reste fort et dérangeant de nos jours, qui pourtant ne connaissent que l’excès.
Cependant, on peut la préférer plus allusive : « je veux l’oiseau savant en amour » ; plus mystique : « je crois que ma solitude devrait avoir des ailes » ; moins morbide : « nous prenons la vie par la taille / et donnons en douce des coups de pied à la mort ».
Desautels, Pizarnik. Pour elles, qui fréquentent les oiseaux, l’envol serait possible. Par la littérature.











