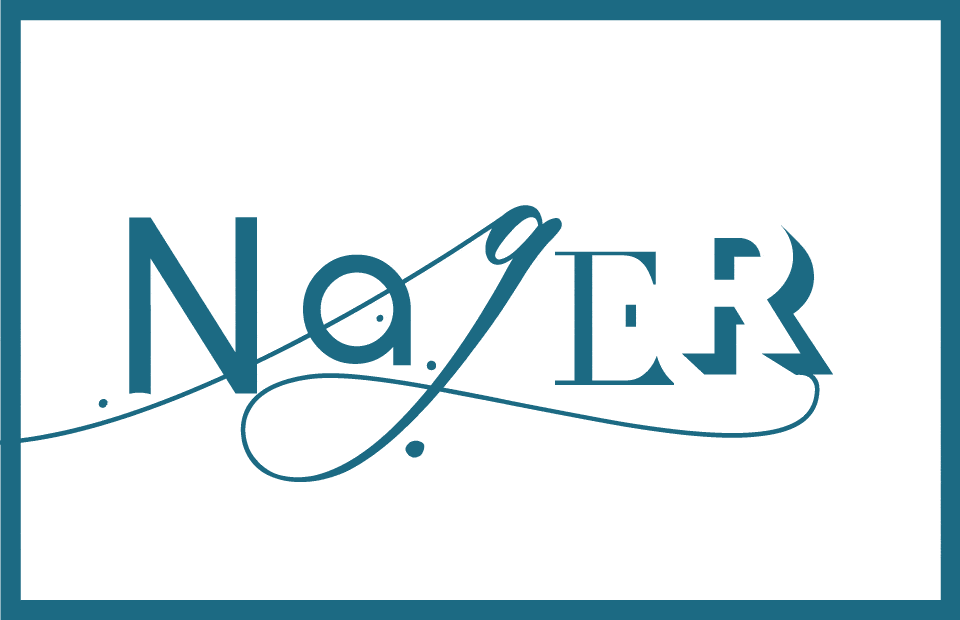 Jean Lacoste propose une lecture de la ballade tragique de Friedrich Schiller « Le plongeur », mise en musique par Franz Schubert.
Jean Lacoste propose une lecture de la ballade tragique de Friedrich Schiller « Le plongeur », mise en musique par Franz Schubert.
Nager, peut-être, avec prudence, sans perdre pied, ou plonger intrépidement à la poursuite de quelque trésor sous-marin, dans un nuage d’écume, c’est l’alternative que semble proposer une ballade particulièrement célèbre de Schiller, devenue proverbiale, publiée dans l’Almanach des muses de 1798, à savoir « Le plongeur » (der Taucher). Une ballade mise en musique par Schubert vers 1815, un lied dont on garde longtemps le souvenir, surtout quand il est chanté tout en nuances – si l’on peut exprimer une préférence – par le baryton Hermann Prey, au plus près du rythme imposé par les 27 strophes d’iambes et d’anapestes, un rythme de ressac éternel. Quelle leçon Schiller nous invite-t-il à tirer de ce geste du « plongeur » ? Sottise et nécessité de l’hubris, folie du courage et beauté de la témérité, curiosité de l’explorateur des abysses ?

« Baigneurs s’apprêtant à plonger » de Gustave Caillebotte (1878)
Le décor ? Plutôt médiéval, avec un roi, des chevaliers et un jeune page (Edelknecht) mais on apprendra qu’il est question de Charybde. La légende veut qu’il s’agisse d’un monstre aquatique du détroit de Messine qui engloutit navires et marins : il relève de la mythologie grecque, de l’Odyssée comme son compagnon Scylla, mais Schiller en fait un simple gouffre (Schlund) d’eau tourbillonnante, une faille dans les rochers, d’autant plus dangereuse. Comme un manager moderne qui motive « ses équipes » par des sauts en élastique, le roi jette une « coupe d’or » du haut d’une falaise dans la « bouche noire » des flots : qui veut y aller ? qui veut relever le challenge ? Celui qui la récupèrera pourra la dire sienne. Fine notation de Schiller : tous, chevaliers et pages, regardent sans rien dire, sans oser rien dire devant ce tyran dont les motivations sont obscures. Pourquoi ce désir d’humilier chez les autocrates ? Tiennent-ils les hommes par la cupidité (l’or), la lâcheté, la peur des monstres inconnus ? À l’inverse, c’est par désespoir d’amour que le « roi de Thulé » de la ballade de Johann Wolfgang von Goethe (dans Faust) jette lui aussi une coupe d’or dans l’abime.
À trois reprises, le roi sicilien, lui, insiste, formule son défi, en vain. Les hommes ne seraient-ils plus fascinés par l’or ? Mais, stupeur, un jeune homme se détache, enlève ses vêtements, sous les yeux de la cour restée muette, s’avance prudemment le long des rochers, s’approche du monstre qui avale et recrache l’eau. C’est dans cette gueule liquide qu’il faut entrer, dans un vacarme terrible : Schiller s’emploie en virtuose à le rendre sensible : de la poésie imitative à sa plus grande intensité (« Und es wallet und siedet und brauset und zischt »), « le monstre siffle, mugit, écume et bouillonne », comme lorsque l’eau et le feu se rencontrent. Un moment cependant une accalmie s’annonce, une faille s’ouvre comme une belle vague dans un spot de surf, et le jeune homme, qualifié de « hardi nageur » (der kühne Schwimmer), se recommande à Dieu, aux dieux, et… déjà l’eau l’emporte dans son tourbillon mystérieux. Chacun plaint le beau jeune homme ; les courtisans critiquent implicitement le roi : « quand tu jetterais dans cet abime la couronne, en disant “celui qui la rapportera sera roi”, je ne voudrais pas tenter de l’acquérir ».
Et pourtant voici revenir le jeune homme qui nage avec vigueur et qui, triomphant, brandit la coupe en or qu’il offre au roi, avec ces mots : « Heureux ceux qui respirent cet air libre ! L’abime est épouvantable. L’homme ne doit point tenter les dieux et chercher à connaitre ce qu’ils ont, dans leur clémence, caché sous le voile de la nuit ».
Le poème aurait pu s’achever sur cette scène, sur cette leçon de réserve, de « résignation » toute kantienne (ou épicurienne). Mais, comme Ulysse naufragé vu par Jean Giono, le jeune homme ne déteste pas faire le récit de sa dangereuse plongée ; c’est par miracle que le « vase d’or » est resté accroché à des branches de corail. Des monstres aux formes inconnues sont arrivés de toutes parts, des « animaux hideux », comme « le terrifiant requin, l’hyène des mers ». La solitude du jeune homme est extrême. Il se sent – phrase proverbiale – « le seul être sentant au milieu des larves ».

« Le plongeur », détail du couvercle de la Fresque de la tombe du plongeur © CC2.0/Dave & Margie Hill / Kleerup/Musée de Paestum
Un profond et imprévu mouvement ascendant, toutefois, le rend à l’univers des hommes. Le roi s’étonne, donne la coupe en or promise et interroge celui qui est revenu de cette incursion dans « le fond le plus profond de la mer » sur la vie qu’il a entrevue. On sent bien que, loin de se satisfaire de ces quelques visions sous-marines, le roi est animé par le désir de voir ce monde souterrain des mers que le jésuite Athanasius Kircher avait décrit dans son encyclopédie sur le Mundus subterraneus de 1665 et que révèlera Jules Verne aux jeunes lecteurs dans Vingt mille lieues sous les mers…
« Cessons ce jeu cruel », dit seulement la fille du roi, « ce jeune homme a osé ce que personne n’avait osé avant lui. Il est revenu d’un lieu d’où nul être vivant n’était encore revenu ». À ces mots, le roi reprend la coupe, la jette de nouveau dans les flots et promet au nageur audacieux la main de sa fille et la couronne s’il accepte de replonger dans l’onde. Les motivations du roi, quand il fait cette proposition absurde et même criminelle, ne sont pas claires ; pourquoi ce geste si soudain, irréfléchi ? pour faire plaisir à sa fille ? ou au contraire pour dissiper l’aura qui entoure le nouveau héros en quelque sorte olympique ?
Ce dernier ne peut échapper au piège, son courage s’éveille comme malgré lui ; il obéit comme un soldat ; il pense aussi à « l’adorable récompense » – la fille du roi, selon les mœurs de l’époque – qu’on lui promet désormais. Le nageur va braver une nouvelle fois la mort. Il se jette à l’eau, la vague monte et descend, monte encore mais « rien ne ramène le jeune homme ». Le dernier vers dans sa concision est un lied à lui seul : « den Jüngling bringt keines wieder ». Les mots qu’on se redit quand on apprend le décès d’un adolescent, d’un jeune homme qui a voulu aller plus loin, plus vite, plus haut.
En tout cas, les vues sous-marines fascinantes de beauté et de laideur, sublimes en un mot, qu’évoque le poème de Schiller auraient pu figurer dans l’histoire de la notion de sublime que le philosophe italien Remo Bodei a retracée avec beaucoup de science et de brio dans un essai récent, Paysages sublimes. Les hommes face à la nature sauvage. Il pose notamment la question de l’avenir du sublime qu’il voit dans la conquête spatiale. Plus question de nager, alors.












