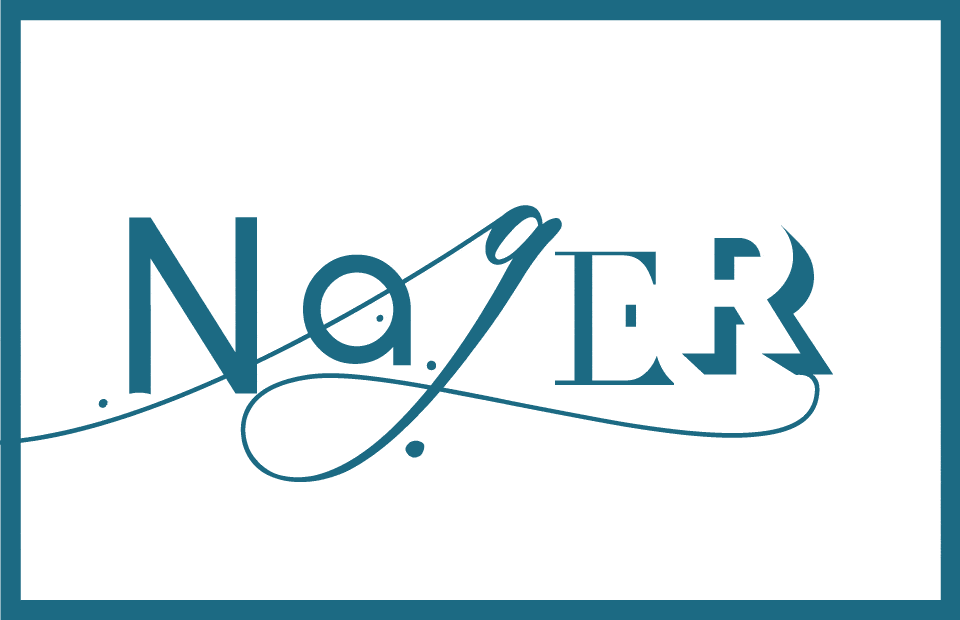 Quoi de moins aristocratique et de moins romanesque que la nage en piscine municipale ? D’abord, il y manque l’épopée, l’affreuse tempête où l’on craint pour la survie d’êtres de fiction. Enfin, quand bien même la météo serait au beau, il y manque la nature, la communion-connexion avec le vivant. Aux piscines et aux longueurs monotones manquent donc le terrestre mais aussi, bien souvent, les souvenirs d’enfance en milieu salin. Et puis, la piscine entraine une faillite spirituelle : c’est le temps et l’espace débités en unités de mesure démocratiques, le sport after ou before work, l’eau pour tout-e-s. Fini le temps des traversées houleuses et à contre-courant, fini le temps des héros nageurs : place aux bébés. Et pourtant, l’écriture de Constance Debré – nous relisons ici Play Boy, mais aussi Love Me Tender et Nom – fait de la piscine l’un des lieux où le « je » autofictionnel éprouve son rapport au monde, et, implicitement, trouve son écriture.
Quoi de moins aristocratique et de moins romanesque que la nage en piscine municipale ? D’abord, il y manque l’épopée, l’affreuse tempête où l’on craint pour la survie d’êtres de fiction. Enfin, quand bien même la météo serait au beau, il y manque la nature, la communion-connexion avec le vivant. Aux piscines et aux longueurs monotones manquent donc le terrestre mais aussi, bien souvent, les souvenirs d’enfance en milieu salin. Et puis, la piscine entraine une faillite spirituelle : c’est le temps et l’espace débités en unités de mesure démocratiques, le sport after ou before work, l’eau pour tout-e-s. Fini le temps des traversées houleuses et à contre-courant, fini le temps des héros nageurs : place aux bébés. Et pourtant, l’écriture de Constance Debré – nous relisons ici Play Boy, mais aussi Love Me Tender et Nom – fait de la piscine l’un des lieux où le « je » autofictionnel éprouve son rapport au monde, et, implicitement, trouve son écriture.
Thématiquement, la piscine fonctionne comme une obsession, voire une addiction du personnage autofictionnel : la narratrice n’a plus de maison à elle, ne souhaite pas en avoir, vit chez les uns chez les autres, mais elle ne cesse d’aller à la piscine la plus proche. La piscine forme l’un de ses points d’attache, non parce qu’elle est fixe, enracinée, comme le serait une maison d’enfance, mais au contraire parce qu’elle permet de prendre le contre-pied de cet imaginaire territorial. La piscine existe en différentes versions affectivement plus ou moins interchangeables, on y croise des inconnu-e-s au corps plus ou moins bien fait, et cela convient à la narratrice qui – en particulier dans Nom – cherche à liquider le poids symbolique des notions d’héritage ou d’enfance.

La Piscine Saint-Georges de Rennes (2019) © CC4.0/Pymouss
Dans Play Boy, le plus lyrique de ces trois récits, nager en piscine s’écrit comme une suite de gestes : « Une main qui plonge loin, qui accélère sous l’eau le long du corps, l’autre relâchée, sans effort, sous le coude haut qui la ramène, les jambes qui posent l’allongement et l’appui, les yeux vers l’intérieur bleu des choses. Je nage, l’apesanteur, l’eau, le silence, le plaisir de l’adresse, cette chose très simple du sport, cet usage de soi ». Il y a quelque chose de musical dans cette description. On peut également y lire des références à Michel Foucault, dont les tomes 2 et 3 d’Histoire de la sexualité ont respectivement pour sous-titres : « L’usage des plaisirs » et « Le souci de soi ». Du reste, en maint autre endroit, Constance Debré présente sa pratique de la natation comme une « discipline », au même titre que l’écriture, et, puisque cette discipline d’écrire (ou encore « règle de vie ») l’a amenée à changer de vie et notamment à vivre pauvrement, on y entend quelque écho des disciplines et règles de vie monastiques. Est-ce à dire qu’il faille, pour lire l’usage de la natation par Constance Debré, connaitre bien et Foucault et les écrits de stoïciens antiques ou de théologiens médiévaux ? Non pas. Mais on peut reconnaitre que ces références, un peu aléatoires, à mi-mot, participent à la fabrique légèrement héroïsante du « je » autofictionnel : la mémoire au moins estudiantine ou scolaire des lecteurs est incitée à le parer du prestige d’ouvrages philosophiques récents ou anciens, parfois bien connus, certes, mais souvent par ouï-dire – et d’autant plus imposants.
Mais continuons à lire la nage selon Constance Debré. Elle y est autre chose en effet qu’un simple « usage de soi » tourné vers « l’intérieur bleu des choses » – même si nous y reviendrons. Elle est aussi le lieu d’une double transformation. Physique et volontaire d’abord, puisque la narratrice, dans Play Boy, s’y fabrique un corps musclé, qu’elle juge beau et fort, qui la distingue de celles qu’elle appelle les femmes et la range plutôt, elle, du côté des « pédés » « chics », « minces » et sportifs qu’elle admire. « J’ai piqué l’idée à Emmanuel. C’est une des premières choses que j’ai sues de lui, qu’il nageait tous les matins à la piscine de Pontoise. C’était simple et sérieux, je trouvais ça très fort. Comme il est grand, mince, toujours chic et qu’en plus il est pédé, ça m’avait fait envie. Je m’étais dit que je serais quelqu’un d’autre si j’étais capable de ça. J’ai commencé au retour de Rome. Avant je faisais de l’escrime. Mais je voulais du neuf. Une discipline aussi. Quelque chose qui me rénove. » Il y a la performance gay et son dandysme misogyne – explicite ailleurs. La pratique de la natation permet alors de se distinguer, de se styler, hors du rang des veules, et de rejoindre le camp des beaux, forts et désirables.
Si de tels passages séduisent malgré leurs effets d’exclusion affichés, c’est pour de multiples raisons. Ils démultiplient les possibilités genrées ou dégenrées ; ils jouent la carte du style en contexte minoritaire – et interrogent implicitement les liens et tensions entre style et classe sociale. Enfin, ils jouent pleinement la carte de la franchise dans la narration de fantasmes identitaires, de façon directe, nécessairement outrancière, et font ainsi entendre, parfois avec drôlerie, la proximité entre vanité et sérieux. Être beau et stylé, ce n’est rien ; être beau et stylé, c’est une question de survie. On trouve dans de tels passages, par le style concis et le thème, de nets hommages à Guillaume Dustan, à qui Constance Debré a consacré un article dans Les Inrocks –, même si, dans son écriture à elle, la distinction produit des effets d’exclusion plus violents, plus cristallisés, car plus spécifiquement adressés, notamment à la sœur de la narratrice dans Nom ou à telle amante dans Play Boy.

La piscine de la Butte aux Cailles (1924) © Gallica/BnF
Or, il y a aussi, au cours de la nage, une autre transformation qui touche davantage à l’écriture de Constance Debré. En nageant, la narratrice éprouve la conviction que ne rien faire (d’autre que nager, écrire ou avoir des relations sexuelles) est, dans les différentes angoisses qu’elle traverse, la meilleure chose à faire. Ses angoisses, ou douleurs, touchent au devenir de sa relation amoureuse avec Albert, au délitement de sa relation avec son fils, à la mort de son père. La natation permet de les endurer, d’explorer une façon de laisser faire. « Quand j’entre dans l’eau je réfléchis à la façon dont je vais la quitter. Et puis je me calme. Je retrouve le calme. La certitude qu’il ne faut rien choisir », lit-on dans Play Boy. Et aussi : « Nager pour ne pas devenir dingue, ici, c’est nécessaire plus qu’ailleurs ». On retrouve peut-être, dans le choix de prendre patience et d’endurer, une vague résurgence stoïcienne, qui place le fait de pâtir et de reconnaitre son impuissance au cœur d’une relation au monde. On peut aussi y lire la reprise de la passion au sens chrétien – dans Love Me Tender, le fait d’attendre (verbe dans lequel on entend d’autres verbes, comme endurer, patienter, souffrir) est clairement associé à la passion christique, dans ce qu’elle peut avoir d’iconoclaste : « Mon boulot c’est d’attendre, de nager, de baiser les filles. Agnus Dei qui tollis peccata mundi ». Cependant, dans le vocabulaire stoïcien, il s’agit d’endurer la fortune ou le sort ; dans le vocabulaire chrétien, la méchanceté des hommes et l’amour de Dieu. Dans l’écriture de Constance Debré, outre la citation de l’évangile selon saint Jean, il est le plus souvent question d’endurer les « choses » : de « laisser les choses se faire » ou « regarder les choses se faire », de « choses à faire ». On y lit des expressions comme « les choses arrivent », « la mort des choses », ou « c’est quelque chose que je ne connaissais pas » pour évoquer une situation nouvelle, ou « il faut attendre, respecter l’ordre des choses, c’est ce que je leur disais ». C’est alors comme si l’écriture cherchait à se délester de l’histoire racontée, passait à une forme de déshistoricisation et d’anonymisation des événements, et trouvait dans le passage à la notion de choses qui arrivent ou qui se font une sorte d’apaisement.
La nage en piscine ne raccorde pas la narratrice à une nature, à un paysage, à du divin, ou à une mémoire d’enfance comme le ferait peut-être la nage en mer. Elle ne la raccorde pas non plus seulement à telle histoire en particulier, mais à une sorte d’économie passionnelle liée à la notion de choses en train de se faire, ou à faire. Le thème de la nage scande alors particulièrement bien une écriture attentive à des détails matériels, qui procède par listes, juxtapositions, inventaires slamés (stylés, donc), souvent pleine de colère – et qui évite au maximum les métaphores. Il y a dans cette écriture, très rythmée, très nominale, une volonté d’ascèse, de dépouillement, de rejet et de dureté : « quand ça déborde je jette, règle morale, règle esthétique », lit-on dans Nom. Mais les inventaires s’achèvent bien souvent par des indéterminés comme « n’importe où » ou « n’importe qui », sans que cela soit toujours l’effet de l’exaspération, mais comme s’il s’agissait de relever que les noms, avec leurs délimitations, ne suffisaient pas à dire les choses qu’il y a à dire. Alors on peut aussi voir dans ce dépouillement l’envie de se tenir du côté de l’indétermination, insistante, des choses.












