Exilé, le philosophe Carlos Pereda l’est depuis les années 1970. Il a de longue date deux pays et deux passeports. Uruguayen, il a dû s’établir au Mexique par temps de dictature militaire dans son pays, au terme de ses études de doctorat à l’université de Constance suivies d’un post-doctorat à Oxford. Exilé, donc, et philosophe ; exilé en philosophe – et en lecteur de poésie. Car si Carlos Pereda tire sans doute matière à réflexion de sa propre expérience, nulle référence autobiographique n’apparait dans son essai Les apprentissages de l’exil tandis que de nombreux poèmes y sont cités et commentés en tant que « méta-témoignages » de l’exil.
Carlos Pereda, Les apprentissages de l’exil. Trad. de l’espagnol (Mexique) par Gérard Malgat. Présentation de Julien Rabachou. Éliott, coll. « La part des choses », 184 p., 17 €
Le livre de Carlos Pereda éclaire exemplairement non seulement ce que son titre désigne, les apprentissages directs et indirects de l’exil, mais aussi, par le déroulement de son discours et par sa composition, la démarche voire la marche d’un raisonnement fondé sur l’argumentation. Procédant comme il recommande de le faire, il enseigne un art de penser. Tout art en cachant un autre, celui de penser repose sur « l’art de s’interrompre », comme le nomme Carlos Pereda, c’est-à-dire de faire fi ou de faire momentanément abstraction de ce qui nous tient attachés à nous-mêmes ou trop sûrs de notre raison : nos convictions ou nos croyances, nos désirs, nos émotions, nos traditions, notre exercice de la parole. À ne pas pratiquer cet art, on risque, nous explique l’auteur des Apprentissages de l’exil, de verser dans « la raison arrogante » ou raison austère, qui par son austérité même menace de vous conduire à la rationalisation, cette imposture de la raison. L’art de s’interrompre face à la parole du « tu », face, en l’occurrence, à celle de victimes ou d’exilés qui témoignent de leur douloureuse expérience, aurait pour effet très bénéfique que notre subjectivité retrouve son autorité de concert avec celle de la subjectivité d’autrui.

La condition première, donc, de la pensée sur quelque objet que ce soit, c’est de renoncer à ses réactions habituelles. Dans le cas de l’exil, c’est, se mettant à l’écoute du dire de l’exilé, d’accueillir ce dire. Mais Carlos Pereda explique clairement qu’il cherche à réélaborer « les vestiges des sagesses antiques sur l’exil », objet de lamentations ou paré de prestiges contradictoires, et, pour ce faire, parmi les discours actuels, l’un sera privilégié : la parole poétique ou parole singulière. Car les poèmes, ces artefacts, cherchent à valoir par eux-mêmes, s’autonomisant vis-à-vis du « je ». La lecture de ces « méta-témoignages » du XXe siècle, choisis parmi les œuvres de poètes espagnols exilés après la guerre civile tout autant que parmi celles de poètes latino-américains du Cône sud exilés durant les dictatures militaires des années 1960 et 1970, permet à Carlos Pereda de discerner trois modes d’expérience et d’expression de l’exil, dont chacun peut susciter un apprentissage. Ainsi l’exil comme perte donne-t-il lieu à des « poèmes testaments », tels ceux des Espagnols Pedro Garfias et José Moreno Villa, du Chilien Gonzalo Millán ; l’exil comme résistance, à des « poèmes proclamations » de l’Espagnol Rafael Alberti, l’Uruguayen Mario Benedetti, l’Argentin Juan Gelman ; l’exil comme orée ou comme seuil, à des « poèmes exorcisations » qui conjurent le sort : ceux des Espagnols Luis Cernuda et Juan Ramón Jiménez, du Chilien Gonzalo Rojas.
Dans ces postures ou ces expériences du XXe siècle, se retrouvent, pour la première, celles des Lamentations de prophètes bibliques ou des Tristes et des Pontiques d’Ovide ; pour la seconde, l’école de la résistance aux maux prônée par Jérémie ou par Ézéchiel ; pour la troisième, l’insolent refus de l’assignation identitaire chez Aristippe de Cyrène, les cyniques, certains stoïciens, ou encore l’appel de vie qu’est le consentement de l’exilé au renouveau. Or, pour que se produise tel ou tel apprentissage, aucune de ces expériences ne saurait s’excéder, s’abîmer en elle-même. Pour illustrer les périls de la stase dans l’exil comme perte, comme résistance ou comme orée, chacune des expressions poétiques de ces expériences se voit mise à l’épreuve d’une voix féminine : celles des Uruguayennes Ida Vitale et Cristina Peri Rossi, celle de l’Argentine Tamara Kamenszain. Jugeant que ces voix de femmes sont celles de la sagesse, le philosophe leur laisse avoir le dernier mot poétique avant de se livrer à des débats réflexifs et argumentatifs sur chaque expérience et chaque apprentissage de l’exil en conclusion du chapitre correspondant.
Lisant les poèmes qu’il a choisis comme méta-témoignages de l’exil, Carlos Pereda n’entreprend pas l’analyse de leur forme littéraire. Il se montre néanmoins fort sensible à leurs marques d’énonciation : à l’empreinte forte d’un « je » élégiaque en proie à sa douleur, à l’attention à l’autre qu’implique l’adresse à un « tu », à la mise à distance du sort propre qu’accomplit le recours à une troisième personne pour désigner le groupe auquel on appartient. Fidèle à ses propres propositions, il fait part de ses interrogations ou, s’il y a lieu, de ses incompréhensions, sans pour autant renoncer à son désir d’interpréter. Ainsi se confronte-t-il avec une courtoise et attentive perplexité à l’hermétique prose poétique d’« Espace » de Juan Ramón Jiménez.
Jusqu’ici, Carlos Pereda pense les apprentissages directs de l’exil, dont chaque aspect ou chaque étape examinés ouvrent sur des réflexions conclusives. Par exemple : « Il y a un temps pour saluer et même encourager l’expérience des discontinuités petites ou grandes et un temps pour persévérer selon des plans éprouvés avec des habitudes enracinées. » Car ces apprentissages sont en tension, voire, dans le cas de « l’exil comme orée », en conflit ouvert avec eux-mêmes.
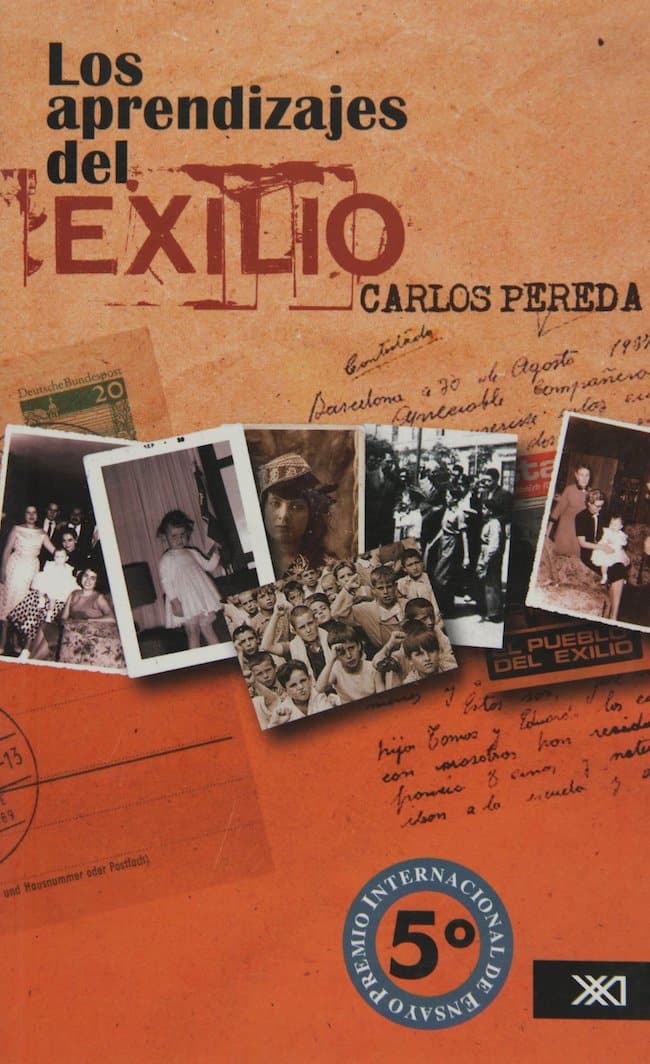
Couverture de l’édition originale de « Los aprendizajes del exilio » (2008) © Siglo XXI de España Editores
Audacieusement, Carlos Pereda pose ensuite que les expériences de l’exil s’offrent comme matériaux propres à reconstituer des perspectives pour des apprentissages indirects : elles contribueraient à une meilleure compréhension d’expériences fréquentes voire nécessaires de la vie. Elles permettraient ainsi d’envisager les altérités internes aux cultures, toutes, à divers degrés, empreintes de nomadisme, et dont les traditions ne connaissent pas de frontières. La réflexion fait ici écho à celle d’un interlocuteur privilégié du philosophe, l’anthropologue Néstor García Canclini, qui a théorisé les cultures comme processus en friction ou en négociation les uns avec les autres dans son essai Cultures hybrides. Stratégies pour entrer et sortir de la modernité. Relisant en exilé les Fondements de la métaphysique des mœurs de Kant tout en prenant l’exil comme perspective, Carlos Pereda fait l’éloge de ce dépouillement qui, face à un doute quant aux valeurs ou aux normes admises, consiste à suspendre pour un temps sa culture, sa nationalité, son prestige, son pouvoir. Il s’agit de devenir un quiconque afin de pouvoir mettre en œuvre des pratiques d’argumentation en gardant à l’esprit sa condition d’agent dans un espace démocratique, que celui-ci soit avéré ou supposé.
D’autres fécondes propositions distinguent entre morale pour enracinés et éthique pour déracinés. Si, en cas de conflit normatif, chaque personne doit et peut exercer sa capacité de jugement dans le cadre des méta-normes d’une éthique pour déracinés, il reste à examiner le concept de personne. Carlos Pereda propose de dissoudre le dilemme de la définition soit biologique soit sociale de la personne en jugeant que celle-ci se constitue en agissant à partir de concepts biologiques et sociaux tout en étant capable de raisonner en animal humain quelconque. Enfin, il réaffirme la valeur de la capacité de jugement et la vaillance que requiert son exercice, qui, à la « raison arrogante », n’oppose pas une raison humble ou pusillanime. Ce que sa réflexion dans Les apprentissages de l’exil illustre à chaque étape du chemin.







![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)



![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)
