Le temps passé à lire, ou plutôt à relire deux fois après une première lecture, ce gros volume prouve, en ce qui me concerne du moins, qu’il ne se lit pas comme un roman. En effet, contrairement au désir exprimé par son auteur, Günther Anders (1902-1992), ce n’en est pas un.
Günther Anders, La catacombe de Molussie. Trad. de l’allemand par Annika Ellenberger, Perrine Wilhelm et Christophe David. Postface de Gerhard Oberschlick. L’Échappée, 574 p., 24 €
Est-ce dû à la simplicité de l’intrigue (deux hommes enfermés dans un souterrain obscur discutent pendant 44 jours – ou ce qui en tient lieu puisqu’ils ne voient rien – de la révolution à venir, destinée à balayer la tyrannie qui les a emmurés vivants), une simplicité qui tend à l’absence pure et simple ? Non, car l’un, le vieux sage Olo, et l’autre, Yegussa, tout juste arrivé et qui mourra peu après son aîné et mentor, font suffisamment revivre la Molussie, leur patrie, au fil de longs échanges, pour que de nombreuses anecdotes restituent mouvements et personnages extérieurs à leur sépulcre.
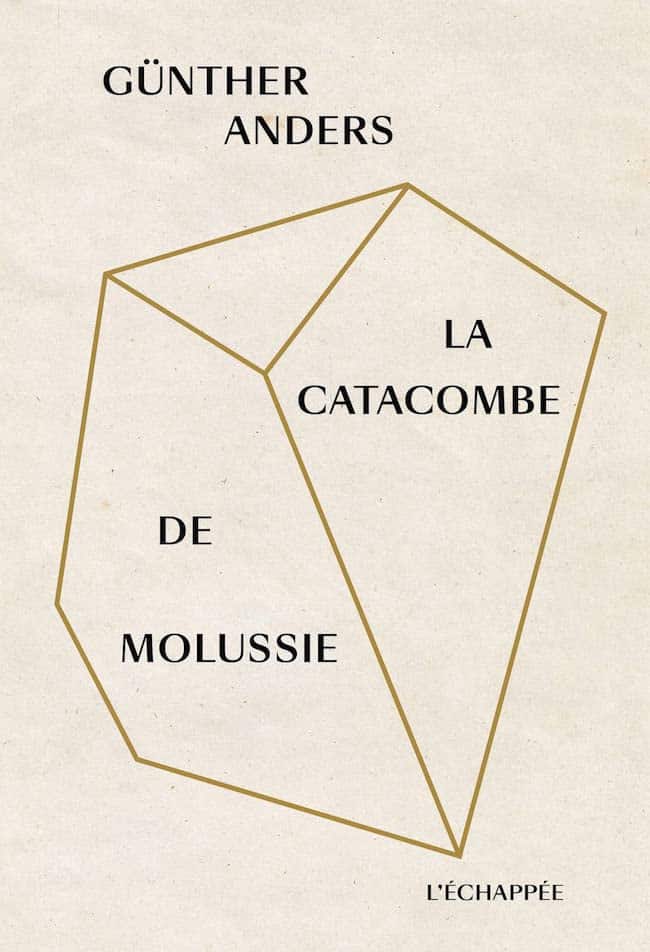
C’est la structure même de l’œuvre qui n’est pas romanesque. Une succession de scènes, elles-mêmes entrecoupées de contes, qui revêtent le plus souvent la forme de saynètes, crée une sorte de spectacle permanent, dont le but est l’initiation de Yegussa, ce qui entraine le lecteur du côté du théâtre, de la partition, voire – à cause de l’utilisation du poème récité, ou de la chanson populaire – du canevas pour une revue de music-hall très particulière.
Car le sujet ne prête pas spontanément à s’amuser. Il est extrêmement sérieux puisqu’il s’agit de tyrannie et de liberté, des conditions nécessaires pour que la seconde triomphe de la première au bout du compte, moyennant le sacrifice des vies de protagonistes qui ne sont que les derniers transmetteurs de certaines instructions de combat codées.
Olo a reçu lui-même de son prédécesseur immédiat nombre de récits courts, de légendes, de données historiques, qu’il transmet à son tour à Yegussa, lequel devrait poursuivre, à la mort naturelle d’Olo (qui intervient le quarante-troisième jour), ce travail de fourmi aveugle avant d’initier, sentant venir sa propre fin, un successeur inconnu. Ainsi vivrait pour un nombre de générations non définies le souvenir des luttes avortées et se conserverait l’espoir de leur réussite future.
Mais Yegussa brise volontairement la chaîne en signant une déclaration qui commande sa propre mort et celle d’une centaine de ses camarades restés actifs hors les murailles de la catacombe. Ainsi la révolution peut-elle s’enclencher et vaincre. Pourtant le livre s’arrête avant cette issue optimiste et restera inachevé malgré les efforts de son auteur.
Celui-ci, brillant philosophe juif, a commencé la rédaction de son texte dans l’Allemagne en voie de nazification accélérée des années 1930, puis l’a poursuivie en exil (France d’abord, États-Unis ensuite). Anders fait partie des intellectuels et artistes qui, antifascistes (la Molussie est peut-être au départ une évocation de l’Italie de Mussolini) et militants, ont réussi par miracle à fuir les camps de concentration d’abord installés en Allemagne même : né en 1902, proche de Brecht (né en 1898), il souligne lui-même que la préoccupation essentielle de sa vie d’écrivain a été la lutte contre le nazisme. La catacombe de Molussie est donc avant tout une œuvre de combat qui transpose de manière transparente l’Allemagne hitlérienne en entreprise esclavagiste sous le dictateur Burru, entouré de personnages qui lui servent de maîtres à penser comme Mee (Zarathoustra) ou de faux opposants parmi lesquels se distingue Régèdié, tout prêt à trahir la cause de la liberté pour se faire une place dans le régime. En cette dernière figure, cauteleuse et ignoble, le lecteur reconnaîtra sans surprise, mais avec une amère satisfaction, le sinistre Martin Heidegger, séducteur de sa belle étudiante Hannah Arendt… qui fut la première épouse d’Anders.

Dans la catacombe Saint-Paul, à Rabat (Malte) © CC4.0/Kritzolina
Donc un « roman » à clés et, au moins en ses premiers tableaux, une vision prémonitoire de la version la plus noire du fascisme. Même si Yanyan, autre nom d’Olo, sous le masque de qui se cache l’auteur du livre, est loin d’avoir tout deviné de l’horreur du nazisme. Dans la passionnante dernière partie du volume, un très long entretien qu’Anders eut à Vienne en 1990 avec Gerhard Oberschlick, son ultime confident, révèle que l’écrivain s’étonnait d’avoir compris dès le début que le sort des prisonniers des camps nazis serait la mort (à Silo, chez Anders, on y procède par noyade). Mais ce n’est que partiellement vrai. On se débarrasse à Silo des travailleurs surnuméraires pour des raisons purement économiques, non parce qu’ils appartiennent à une « race inférieure », et sans que leur assassinat soit précédé d’une lente agonie programmée. La réalité d’Auschwitz n’a pas du tout été imaginée, elle était inimaginable.
D’une manière générale, je croirais volontiers que l’absence de violence sadique dans La catacombe de Molussie explique en partie l’impossibilité pour Anders d’amender, de compléter, et de terminer son livre. On se rappelle la honte qu’a manifestée Chaplin d’avoir décrit en 1941 le camp d’extermination du Dictateur sous l’aspect d’une prison « humaine ». Le nazisme ne se laisse pas représenter, il n’est susceptible que d’être détruit.
Il existe donc aussi un décalage entre le ton presque guilleret, en tout cas marqué par un humour sous-jacent, de la plupart des contes et intermèdes chantés qui font le sel des récits d’Olo, riches en apologues et paraboles, parfois aussi énigmatiques que certaines séquences du Berlin Alexanderplatz (1929) d’Alfred Döblin (qui sortit un an après le triomphe de la fantaisie scénique de Brecht L’Opéra de quat’sous), et la sombre réalité de la « solution finale ».
Ce décalage n’enlève rien à la qualité profonde de l’œuvre, si sensible en maints morceaux de bravoure, qu’il s’agisse d’épisodes pince-sans-rire où Anders évoque les compromissions de la république de Weimar avec le régime totalitaire qui se met en place avant 1933 en s’appuyant sur les analyses erronées de ceux, politiques traditionnels, qui n’arrivent pas à appréhender la nature mafieuse du gang hitlérien, ou des mises au point remarquablement intelligentes d’Olo, instructeur d’Yegussa, sur l’usage massif du mensonge par les nazis (et la quasi-impossibilité, pour les révolutionnaires eux-mêmes, de ne pas mentir un peu, seul moyen de séduire « les masses »).
Inutile de souligner à quel point la lecture de ce monument littéraire s’impose en nos temps, qui ont adopté le système des fake news comme élément central de la persuasion en politique.












