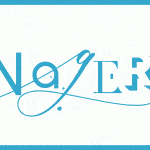 L’écrivain Christian Prigent propose ici des observations pré-natatoires mais immergées déjà dans une expérience du visible comme nage.
L’écrivain Christian Prigent propose ici des observations pré-natatoires mais immergées déjà dans une expérience du visible comme nage.
Pour Vanda, au bord de l’aber
Plage des Trois-Moutons, midi, assis sous les pins devant la plage vide.
Je vais aller nager.
J’attends cette joie.
Avant : n’être qu’œil, suivre le bougé des lumières rapides, violentes.
En bas, le ciel s’inverse dans les flaques : le monde, dont moi, bascule. Les mares grasses d’algues montent aux astres à travers les nimbus, les cathédrales de nuages descendent en flèche dans les sables. Le lointain est en haut, le proche s’enfonce en bas, c’est une peinture.

Vue de la plage de Lampaul-Ploudalmézeau © CC4.0/El Funcionario
Le beau (le joli) : triangles des voiles de windsurf, bombes des wingfoils. La netteté graphique des formes de la découpe industrielle et l’échantillonnage bariolé des couleurs fournies par la palette graphique.
Manque : la vitesse des glissements, la confusion, le brassé-coulé des unes aux autres, et des autres dans les unes, des lignes et des couleurs détachées des figures, libérées des limites, hors dessin.
Soit : manque le sublime. Celui de la forte houle, hors repères, dont ne me parvient, visible, pauvre écume de signes sur-imprimés au sens profond, que le moutonnement frisé, la guirlande torsadée, mouvante d’émotion, des crêtes de vagues.
Et même les îles au loin : suspendues, voltigeantes, ballottées, aspirées par la spirale des risées – quoi que la raison sache du poids de leur socle.
De cela je ne peux noter, intuitivement, que l’é-norme, l’im-mense, l’inaccessible aux codes (de représentation, de nomination, de figuration). En somme : le négatif – qui descelle de lui-même tout code et décèle, sans qu’il accède aux noms, aux figures, la puissance réelle, le soulèvement sans pause de l’existant, son constant passage à l’acte, inactualisable en données verbales ou graphiques pacifiées.
Ce descellement : Cézanne. Ce poudroiement halluciné des passages dans l’entre-deux des figures : Monet. Ce soulèvement en acte : Pollock.
Il faut maintenant clore les paupières pour voir ça : laisser, à travers elles, se fondre en une graisse rosâtre le sang des cieux du dedans et la lumière de ceux du dehors. Simon Hantaï : « le peintre doit se fermer les yeux ». La peinture n’est pas à l’œil.
La petite peinture assignée aux normes de la représentation n’est pas insignifiante parce que maladroite mais parce que fausse. Elle ignore l’ignorance du réel dans et par le code. Elle ne peint pas des paysages mais des idées de paysages. Marines, veduti, panoramas : décor mort de formes intellectualisées et de coloris catalogués. Elle n’est assignée qu’à la vue. Elle n’est pas plongée, ne sait pas nager, sous l’eau, sous la conscience, traversée d’infini – dans la sensualité du non-(sa)voir.
Du coup : pas de couleurs capables de « remuer le fond sensuel des hommes » (Matisse). Pas d’animation ravageante et voluptueuse des formes par l’informe qui, paradoxalement, pousse à tracer des formes – dans le désespoir sarcastique de toute possibilité de formation : face à cette impossibilité. Parce que ce ressenti est l’épreuve du réel en tant que tel.
triangles d’ailes, foils, focs, bombes de voiles !
ciao, les oiseaux ! à vous, meutes ! moutons !
oui au soulèvement vomissant des fonds !
à l’évidement des moelles !
aux gueuses
trempettes dans les tuyauteries osseuses !
à l’asticotement des becs et des crocs !
salut au monde beau
d’être épouvanté par la morgue
d’Éole à son pupitre d’orgue !



![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)








