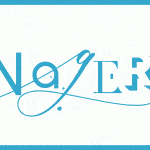 Après avoir montré que le nageur a peu de place dans la peinture moderne – comme si, entre baigneur et noyé, le temps de la nage n’existait pas -, Paul Bernard-Nouraud reprend la question sous un angle politique, et s’interroge sur les difficultés de l’art contemporain à représenter les naufrages de migrants et sur les vœux de mort qui pèsent sur leurs traversées.
Après avoir montré que le nageur a peu de place dans la peinture moderne – comme si, entre baigneur et noyé, le temps de la nage n’existait pas -, Paul Bernard-Nouraud reprend la question sous un angle politique, et s’interroge sur les difficultés de l’art contemporain à représenter les naufrages de migrants et sur les vœux de mort qui pèsent sur leurs traversées.
Les migrants ne savent pas nager. C’est le titre d’un documentaire réalisé en 2016 à bord de l’Aquarius par les journalistes Franck Dhelens et Jean-Paul Mari. Un an plus tôt, ce dernier avait publié le résultat de plusieurs années de reportage consacrées aux migrants dans Les bateaux ivres. L’odyssée des migrants en Méditerranée. Un livre non exempt de défauts (à commencer par son titre), pour ne pas dire rempli de clichés plus ou moins accablants sur des hommes aux « dents blanches d’ivoire mordant des lèvres charnues » et des « femmes roseaux ondulant avec grâce », mais un livre sincèrement effrayé par l’énormité de la situation, et où on lit cette remarque : « Aujourd’hui, vu le nombre de naufrages de migrants, il faudrait mobiliser une armée de peintres et tout un musée. »
De fait, les peintres – les artistes – se sont mobilisés, si bien que l’on pourrait facilement remplir un musée avec les œuvres qu’ils ont consacrées depuis une vingtaine d’années à ces naufrages. À condition toutefois d’y aménager de vastes salles, capables d’y accueillir de véritables bateaux : le boat-people cubain que Jean-Michel Othoniel a décoré comme une station de métro et qu’il a intitulé Le bateau de larmes (2004, galerie Emmanuel Perrotin), celui d’Adel Abdessemed (2011-2012, galerie David Zwirner), d’origine cubaine également, empli de sacs-poubelle moulés en résine qui font songer à des body bags malgré l’« espoir » sur lequel on les a entassés (Hope est le titre de l’installation et pourrait être le nom du bateau), des ballots qui évoquent ceux de wax hollandais qu’a accumulés quant à lui Barthélémy Toguo sur une barque en bois de palettes dans Road to Exile (2008, musée national de l’Histoire de l’Immigration), du même matériau que L’Épave construite en 2009 dans la mairie du Xe arrondissement de Paris par Marcos Avila Forero avec le concours des collectifs La Pieuvre et VRVE.
Il n’est pas certain, en revanche, que la pirogue sénégalaise qu’a dressée Philip Aguirre y Otegui en 2016 face à la mer à Nieuwpoort, en Belgique, ou que le chalutier où périrent, au large de la Libye, plus de huit cents personnes en 2015 qu’a déposé quatre ans après Christophe Büchel sur les quais de l’arsenal de Venise, et qu’il a laissé là quelques mois, y trouvent leur place aux côtés des canaux pneumatiques appendus à la façade du palazzo Strozzi de Florence par Ai Weiwei en 2016, ou auprès du gigantesque équivalent de plastique noir qu’il suspendit dans la nef de la Galerie nationale de Prague l’année suivante. Il n’est pas certain non plus que tous ces esquifs, même à l’état brut ou presque, fassent davantage droit à ceux qui y prennent place et, pour certains, y périssent qu’aux imaginaires historiques qu’ils convoquent : ceux de l’arche du déluge, de nouveau, de la nef des fous ou du radeau des naufragés.
Le corpus visuel qui, depuis une vingtaine d’années, se compose autour des migrants, tout en s’efforçant de répliquer à l’imagerie médiatique sur le sujet, s’inscrit en effet pour une bonne part dans le sillage d’une iconographie du naufrage amplement balisée. Au sein de celle-ci, Le radeau de La Méduse, de Théodore Géricault (1818-1819, musée du Louvre), occupe une place centrale que les artistes s’efforcent par conséquent de contourner tout en la citant. Avec Harragas, les damnés de la mer (collection particulière), Kader Attia en réalise dès 2009 une copie à partir d’une mosaïque de photographies de presse qui ne se discernent qu’en s’approchant là où il faut cette fois descendre sous l’eau pour découvrir Le radeau de Lampedusa qu’a immergé John deCaires Taylor en 2017 à Lanzarote pour le musée Atlantique de l’île.

Le siège de l’agence Fontex, à Varsovie (immeuble de gauche) © CC2.0/AGC Glass Europe
L’un des pochoirs peints à Calais en 2015 par Banksy reprenait déjà l’icône de Géricault, dont les naufragés s’agitaient cette fois en direction d’un yacht de luxe s’éloignant à toute vitesse. Cinq ans après, le célèbre artiste de rue rachète une vedette des douanes françaises qu’il repeint de blanc et de rose et rebaptise Louise Michel dans le but de sauver effectivement des naufragés. Ce qu’elle ne put faire que quelques semaines à l’été 2020 avant d’être saisie administrativement, et de nouveau autorisée à reprendre la mer en janvier dernier seulement. Aux difficultés que rencontrent les artistes pour inventer une nouvelle iconographie du naufrage s’ajoutent ainsi les obstacles mis à la visibilité des migrants qui se noient en Méditerranée.
L’enjeu, désormais, est donc moins de remplir un futur musée que de tenir les comptes présents des péris en mer. « Dénombrer vise à déchiffrer les effets d’une politique », écrivent en ce sens les membres du collectif Babels qui se sont intéressés à La mort aux frontières de l’Europe (Le Passager clandestin, 2017). Cette tâche, qui devrait revenir aux politiques ou à l’administration, incombe aujourd’hui aux chercheurs et aux artistes, parmi lesquels Banu Cennetoğlu qui a entrepris, en 2006, de nommer toutes celles et ceux qui ont perdu la vie en tâchant de rejoindre l’Europe depuis 1993. Nommer pour dénombrer pour déchiffrer, tel est aussi l’objectif de The List qui comptait 36 570 noms en 2019. Un chiffre à comparer aux 24 303 migrants disparus en Méditerranée depuis 2014, estimés par le Missing Migrants Project, patronné par l’Organisation internationale des migrations, mais un chiffre qui reste inférieur à ce qui est probable, puisque aujourd’hui les naufrages se produisent pour la plupart sans témoins dans la zone du globe pourtant la mieux surveillée. C’est ce qui explique que le collectif d’artistes et de chercheurs du Forensic Oceanography, qui enquête sur les circonstances exactes de ces drames, parle de morts par négligence, voire de « death by rescue ». Façon de contredire la rhétorique de la tragédie et les discours émus sur les destins malheureux – façon aussi de prévenir le poète qu’en écrivant « l’enfant endormi à jamais dans les sables » pour désigner un enfant mort noyé, il perd aussitôt tout droit de parler au nom de ses Frères migrants.
Car, si la situation peut bien se décrire par figures, elle ne souffre pas, en revanche, qu’on s’évertue à lui accommoder celles qui lui préexistent. Elle oblige, au contraire, à regarder en face le fait brut et massif que des hommes, des femmes, et des enfants, donc, disparaissent par centaines, par milliers, dans la mer Méditerranée, au large des Canaries et dans la Manche ; et à reconnaître qu’ils y disparaissent parce que les pays susceptibles de les accueillir les y ont précipités et ont entrepris, ces dernières années, d’empêcher autant que possible qu’ils soient sauvés et que leurs corps soient repêchés. La noyade est une politique lorsqu’on l’organise à pareille échelle.
De même que des particuliers et des ONG s’engagent à porter secours aux survivants, de même, de petites municipalités prennent à leurs frais d’enterrer dignement les cadavres que leurs habitants découvrent après qu’on les a laissés mourir indignement. Dans celle de Zarzis, en Tunisie, c’est là aussi un artiste, Rachid Koraïchi, qui, de sa propre initiative, a créé pour eux un cimetière et un mémorial. Lors de son inauguration, à l’été 2021, en présence de la directrice générale de l’UNESCO qui jugeait manifestement naturel d’y assister en cette qualité, Le Jardin d’Afrique (c’est son nom) comptait déjà 800 tombes et allait devoir s’agrandir ; Rachid Koraïchi envisagerait déjà d’en créer un second, cette fois aux Canaries, Le Jardin des îles.
Autant que les reportages, les statistiques de naufrages et les listes de noms, ces projets disent le caractère énorme et effrayant de la situation. Le choix de l’artiste d’enterrer les morts noyés plutôt que de les représenter dit cependant autre chose encore, quelque chose qui n’est pas sans rapport avec l’affrètement d’un navire de sauvetage par Banksy ou la déposition d’une épave par Christoph Büchel. Ces choix disent que peut-être la représentation n’est pas à la hauteur de la situation, et que l’art, du moins dans les limites qui lui sont traditionnellement imparties et reconnues, n’est pas en mesure de continuer à faire œuvre dans ces conditions. Ce qui précède fournit un indice de cette disjonction : du point de vue artistique, les noyades de migrants sont demeurées étrangères à celles de baigneurs de la première modernité, et elles n’ont pas rencontré non plus les figures de sommersi élaborées par la seconde ; comme s’il s’agissait, dans les deux cas, d’une autre histoire.
Que les migrants qui se noient ne puissent être comparés ni aux rares nageurs ni aux nombreux baigneurs qui parcourent l’histoire de l’art moderne est un phénomène qui se peut concevoir, ne serait-ce qu’afin d’empêcher, entre le réel et l’art, toute forme de réconciliation, fût-elle placée sous le sceau du déluge. Mais que leurs figures contemporaines échouent à s’associer à celles des sommersi est plus difficilement concevable. Certes, on comprend que pareille assimilation tendrait à les rapprocher d’un mal absolu sans commune mesure avec ce qui se déroule aujourd’hui, de même que les apparier aux baigneurs cézanniens les vouerait à un éden qui leur est précisément refusé ; comme si l’on observait du même œil les baigneurs sur la plage et ceux qui tentent, in extremis, de la rejoindre à la nage. Mais la raison profonde de cette divergence, qu’on estimerait anachronique pour peu qu’on la forçât, se situe ailleurs, ou, plus exactement, elle tient paradoxalement à une aporie liée à la chronologie elle-même.
Historiquement, les sommersi remontent des abîmes du passé, ils n’affleurent pas à la surface du présent ; en temps normal, ils reviennent des tréfonds, ils ne viennent pas de l’autre côté ; ils sont étranges, pas étrangers. Ce sont des spectres familiers au lieu que ceux-ci demeurent inconnus. Dire des migrants qu’ils ne savent pas nager, aussi bien que ne jamais les représenter en nageurs, apparaît, à cet égard, comme l’ultime obstacle, le dernier rempart dressé à leur survenue, qu’on se répète en clamant à toute force contre l’évidence, les lois et les coutumes, qu’ils doivent se noyer, et périr corps et biens, qu’il faut les laisser faire comme les passants laissèrent Pateh Sabally (qui avait vingt-deux ans) se noyer dans le Grand Canal de Venise le 21 janvier 2017, afin qu’aucune image d’eux – de lui –, rien du réel le plus présent, le plus pressant, ne vienne troubler l’imaginaire spectaculaire qui s’est formé avant eux et sans eux – croit-on. Li lasciamo annegare per negare, dit le dernier vers de Solo Andata (Aller simple), qu’Erri De Luca écrivit en 2014 après un naufrage : « Nous les laissons se noyer pour nier. »












