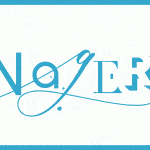 Que disent les étranges nageurs, acéphales le plus souvent, des tableaux de Leonardo Cremonini (1925-2010) ? Odile Hunoult interroge leur immersion dans une forme de silence.
Que disent les étranges nageurs, acéphales le plus souvent, des tableaux de Leonardo Cremonini (1925-2010) ? Odile Hunoult interroge leur immersion dans une forme de silence.
Leonardo Cremonini est né en 1925 à Bologne – la ville de Giorgio De Chirico. Dès les années 1960, il a construit son univers pictural, les éléments qui permettent de le reconnaitre entre mille. Un univers méditerranéen dans les différentes lumières des heures, bords de mer (qui sont probablement ses tableaux les plus connus, composés de quatre plans horizontaux superposés, remblai, plage, mer, ciel), rochers polis par les ressacs, plages d’été, rues vides des stations balnéaires… Mais aussi beaucoup d’intérieurs, très cloisonnés, avec des couloirs, des passages, des miroirs, des fenêtres ouvertes, fermées. Un univers silencieux : De Chirico, sans être clairement désigné, plane là-dessus.
Parfaitement intégrés dans cet univers, beaucoup de baigneurs sont là avec la même évidence calme que les rochers qui peuplent l’eau et auxquels ils ressemblent par leur forme, leur couleur souvent, le poli de leur peau. Quant aux nageurs, assez nombreux, ils sont différents des baigneurs en ce qu’ils sont peints à l’intérieur même de l’eau, tels des poissons d’aquarium. Pas de « dehors », l’air libre est hors du champ de vision, pas de ciel, pas d’horizon, le tableau est tout entier eau. Les nageurs, comme l’œil du peintre, partant son spectateur, sont complètement immergés.
Ces nageurs, il faut bien qu’ils respirent, ils sont donc réduits à leur corps : la tête n’étant pas immergée, elle est invisible, dans l’au-dehors du tableau (Yeux sans voix, 1971-1972 ; Les Corps dans l’eau, 1973 ; Composition pour les J.O., 1992, etc.). Le peintre ne nous montre que des corps décapités par la surface de l’eau.
Il y a bien entendu un jeu avec le spectateur, nécessairement désorienté. Par exemple, dans une sorte de renversement amusé, un autre Corps dans l’eau (1972) nous montre un demi-ballon rouge, censé être sa partie immergée, qui donne l’effet comique d’une demi-lune flottant dans le ciel. Un autre tableau (Plonger dans l’eau, 1963) également entièrement vu « sous l’eau » (d’une piscine, semble-t-il) montre une plongeuse vue par en dessous, visage indiscernable, comme fondu, et le corps lui-même presque dissous en fragments de lumières par le miroitement de l’eau.
Le parti pris de peindre sous l’eau, c’est l’extrême d’une constante chez Cremonini, et ces corps décapités radicalisent une particularité qui saute aux yeux : les personnages de Cremonini n’ont pas de regard. Cremonini refuse le regard, et par-dessus tout l’échange du regard (des personnages peints entre eux et des personnages avec le regardeur). Ces plages et ces intérieurs semblent paradoxalement déserts, alors que souvent ils ne le sont pas : ce qui amène aussi à s’interroger sur le silence très particulier à cette peinture. Serait-ce le regard qui parle dans un tableau ?

Leonardo Cremonini, « Les corps dans l’eau » (1973) © D. R. (avec l’aimable autorisation de Pietro Cremonini)
Cremonini ne peint pas le regard. Même, quand il peint un visage, il l’esquisse, le réduit à une sorte de pomme de terre ou de galet, proche des rochers lisses de ses paysages marins. Le plus souvent, il le dissimule. Qu’on pense à ces enfants qui jouent à colin-maillard, bandeau sur les yeux. Ou à ces personnages, nus souvent, vus par l’intermédiaire de miroirs : les corps sont reflétés mais la tête est à demi dévorée par le cadre du miroir, ou même carrément décapitée, comme nos nageurs. Des baigneurs, la tête émergée cette fois, sont munis de masques de plongée qui mettent le regard à distance et le troublent. Même chose pour les voyageurs derrière les vitres des voitures ou des compartiments de train, même chose pour les personnages dans les intérieurs, dissimulés à demi, qu’on entraperçoit comme épiant derrière des portes, ou derrière des vitres brouillées par surcroit par la buée qui s’y condense… Toujours une distance est introduite. Difficile de ne pas penser aux personnages de Bacon exhibés dans leur cages de verre ; pourtant, on ressent bien que l’intention est différente – ici, ce ne sont pas des corps torturés, mais des corps mystérieux, secrets, refusés.
Quand il est présent, ce n’est jamais un regard direct, l’œil espionne. C’est parfois celui de ces chiens d’une laideur sarcastique, cachés dans des coins du tableau, boudins montés sur bâtons… Le jarret ou le coude à peine indiqués témoignent que ces bâtons sont des pattes organiques. La tête vue de face semble plutôt là encore une patate, museau complètement aplati par le raccourci ; en revanche, l’œil, à fleur de tête, est bien là, bombé et brillant, qui nous observe – par exemple Jeux sans joueur (1972), Les chiens au Belvédère (1980), ou encore ce Chien de ville (1978-1981) où l’œil du chien – sournois ? inquiet ? – est la raison même du tableau, son trou noir.
Cette caractéristique de l’univers de Cremonini ne fait qu’accentuer, ou peut-être symboliser, ce que toute peinture porte : un silence. Elle est par nature « grosse » de silence, et par là grosse de pensée, et c’est par cela qu’elle s’accroche à notre pensée. Là où il y a paradoxe, c’est qu’un peintre est un regard qui s’adresse à notre regard, silencieusement en effet, mais en nous demandant, dans le miroir du tableau, un regard de connivence, de reconnaissance – c’est peut-être pour cela que chacun a « ses » peintres, comme on a ses amis, ceux avec qui le regard peut s’échanger et échanger ; l’absence du regard dans les tableaux de Cremonini, poussée jusqu’à l’absence de visage pour ses nageurs, nous dit quelque chose, nous préoccupe. « Ce qui me frappe dans ta peinture, c’est que tu peins des hommes qui n’ont pas visages d’hommes, qui n’arrivent pas à parler à d’autres hommes ou à rencontrer d’autres hommes. Le regard n’indique jamais une communion ou une action en commun. C’est un regard d’espion, pas un regard d’amour… c’est loin d’être un reproche, c’est pour moi une marque de reconnaissance, cette façon dont le temps est suspendu, cette congélation de l’instant, cette pétrification des objets, relève tout de même d’une belle maladie mentale… », dit Régis Debray à Cremonini dans l’entretien qui accompagne la monographie de 1995, Éléments.
C’est d’autant plus fascinant quand Cremonini introduit furtivement une communion entre ses personnages. Ainsi ce tableau de plage où les cadres et les toiles des transats délimitent des espaces très picturaux, dans une harmonie solaire de rouge, jaune, orange, ocre – mais tout le tableau, en fait, est concentré, condensé, sur le coin à gauche où, de dos, à peine visibles dans l’espace entre les toiles de leurs transats rapprochés, deux têtes, peut-être d’enfants, semblent se chuchoter quelque chose. Le tableau est intitulé Chuchotements et absences (1972-1974). Une troublante intimité. On pense à La leçon de musique de Vermeer (à Buckingham), peint trois siècles plus tôt, vers 1662, où la fascination joue de la même façon : la perfection de la composition vermeerienne, avec ses plans et sa lumière, nous mène au « fond » du tableau où, rendue petite par la perspective, une femme debout, vue de dos, joue sur son virginal, la tête à demi tournée vers un homme debout à sa droite. Dans le miroir incliné au-dessus du virginal, on distingue, minuscule et un peu brouillé, le visage de la femme. Ces deux personnages semblent se parler. Mais le peintre et le spectateur regardent leur intimité en exclus – ou en espions.
Régis Debray, de nouveau : « Je suis frappé par le nombre de mises en paroles de tes tableaux par toutes sortes d’interprètes ou de commentateurs venus d’ailleurs, qui ne sont pas des critiques d’art. Par exemple Moravia, pour qui ta peinture est souvenir d’enfance, ou Alain Jouffroy, pour qui elle est une narration sur la vie courante, ou Althusser pour qui elle est déconstruction de l’humanité, description de l’inhumanité du monde, ou Umberto Eco pour qui elle est “intrigue ambiguë”, nœud sémiotique, machine à produire des interprétations, ou Marc Le Bot qui fait résonner ses désirs ou ses fantasmes dans tes moyens picturaux. Tout obsessionnelle et singulière que soit ta peinture, c’est un fait que toutes sortes d’obsédés peuvent s’y pencher comme sur un miroir pour regarder leurs propres obsessions. »
Dans l’aquarium de Cremonini, difficile de distinguer entre ses deux obsessions : se protéger du regard des nageurs, ou, en définitive, désespérer de pouvoir le reporter sur lui, désespérer de la rencontre ? Car les nageurs décapités, symbolisant l’autre dans son altérité insaisissable, vivent leur vie hors de son atteinte, dans leur simple complicité avec l’eau. Et ils ont bien une tête, dans l’en-dehors du tableau, rien ne les empêche, eux, de « parler à d’autres hommes ou [de] rencontrer d’autres hommes ». Mais « ça ne nous regarde pas ». Nous, spectateurs, quelle obsession trahit notre interrogation sur ces nageurs que nous épions avec Cremonini, d’en bas, muets comme des carpes, depuis nos limbes sous-marins ?












