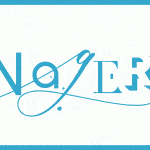 Plonger dans un bassin d’eau chlorée, quel intérêt ? C’est la question posée par le peintre David Hockney, l’écrivain John Cheever et le cinéaste Frank Perry. Trouve-t-on une réponse dans les écrits du sociologue Thorstein Veblen ? La piscine, est-ce de la frime ?
Plonger dans un bassin d’eau chlorée, quel intérêt ? C’est la question posée par le peintre David Hockney, l’écrivain John Cheever et le cinéaste Frank Perry. Trouve-t-on une réponse dans les écrits du sociologue Thorstein Veblen ? La piscine, est-ce de la frime ?
Dans les années 1960, à Milwaukee, au bord du lac Michigan, les baigneurs de Bradford Beach venaient des quartiers défavorisés. Fréquenter cette plage magnifique – bercée par les vagues, surplombée par les gratte-ciels du centre-ville – ne serait pas venu à l’esprit des résidents des banlieues aisées du North Shore. Pourquoi se mouiller avec les basses classes lorsqu’on a ses enclaves réservées ? D’abord, chaque commune – Shorewood, Whitefish Bay et Fox Point – avait un parc public au bord du lac. Même ces parcs étaient peu attirants, les habitants aisés des banlieues préférant se rendre à leurs country clubs, où ils trouvaient de multiples options sportives, dont la natation, le tennis et le golf. Les plus fortunés pouvaient rester chez eux et profiter de la piscine ou du terrain de tennis familiaux.

Neptune’s Pool, la piscine du Hearst Castle à San Simeon, en Californie © CC0 1.0/Daderot
Chaque commune possédait alors des dizaines de bassins creusés dans la terre et chemisés de béton, ils auraient pu servir à abreuver les cerfs, les renards et les lapins du coin, si l’abondante quantité de chlore n’avait pas rendu l’eau imbuvable. On emploie cet oxydant dans un objectif de désinfection, pour empêcher le développement des algues et éliminer les bactéries. Les galets de chlore se dissolvent, mais leur pouvoir rémanent stérilise l’eau du bassin et la rend stérilisante.
Ce processus exigeant un travail d’entretien considérable, les propriétaires souscrivaient un contrat avec une entreprise spécialisée. C’est-à-dire que, non seulement ils utilisaient peu leurs jouets couteux, mais ils ne s’en occupaient pas, tels les détenteurs de voitures de luxe incapables de bricoler le moteur de la machine restant toute l’année dans un garage pouvant accueillir cinq véhicules.
Habiter la banlieue américaine, au milieu de la faune et de la flore, c’est une posture : les résidents sont de simples touristes parmi les arbres et les animaux, ils y vivent sans avoir affaire à eux, faute de connaissances « rustiques ». La fuite vers les banlieues a connu son apogée dans les années 1950, grâce à l’expansion du réseau d’autoroutes nationales (Interstate Highway System), avec comme conséquence l’essor de la piscine privée jouxtant la maison. Cette évolution sociologique a trouvé son reflet dans la culture populaire, dont l’un des exemples les plus jouissifs fut la série télévisée The Beverly Hillbillies (1962-1971), l’histoire d’une famille de péquenots appalachiens installés à Beverly Hills après la découverte d’importantes réserves pétrolières sur leurs terres. Leur ignorance des codes permettait de les commenter : ces Candide bouseux, planqués dans leur magnifique « manoir », restaient perplexes face au mode de vie des autochtones, incarné par d’étranges objets luxueux, notamment la piscine, que les culs-terreux désignaient par le terme « cement pond » (« étang en ciment »).
La naïveté appalachienne éclaire la vulgarité de Los Angeles. À quoi bon le ciment : ce matériau aide-t-il à abreuver le bétail ? On est en plein univers de Thorstein Veblen (1857-1929) et de sa Théorie de la classe de loisir (1899). C’est dans ce livre, comparé par Raymond Aron à De la démocratie en Amérique pour sa « profondeur », que Veblen développe sa critique du capitalisme américain. Elle est fondée sur une conception évolutionniste de l’histoire, et donne la priorité aux instincts pour expliquer la nature humaine. En bon paysan norvégien, Veblen voit une opposition historique entre l’instinct artisan (workmanship) et les instincts prédateurs (predatory). Au prédateur s’impose la nécessité de s’abstenir de tout travail productif, perçu comme « dégradant ». Afin de s’attirer et de conserver l’estime de ses pairs, il ne lui suffit pas de posséder richesse ou pouvoir, il faut encore les mettre en évidence, et ce de manière ostentatoire.

Neptune’s Pool, la piscine du Hearst Castle à San Simeon, en Californie © CC3.0/JPRoy2101
Les piscines privées étaient encore rares au XIXe siècle, mais un autre signe de « consommation ostentatoire » se prêtait à l’analyse de Veblen : la pelouse. D’un point de vue esthétique, celle-ci lui apparaissait comme « un pâturage bien préservé », d’où l’attrait qu’elle exerçait sur les Yankees, conditionnés par leur long passé pastoral. Mais pas question de vache pour y brouter !
Après la Seconde Guerre mondiale – bien après la mort de Veblen –, ce code se modifie : la pelouse cède une partie de sa gloire à la piscine, laquelle affiche aussi son inutilité : elle est interdite aux animaux… Les hommes eux-mêmes sont à peine tolérés ; la forme biscornue, voire atrophiée, de la plupart des bassins décourage la natation sérieuse.
C’est dire combien la nouvelle de John Cheever « The Swimmer » (1964) est subversive : lorsque Neddy Merrill plonge dans la piscine de sa voisine Helen Westerhazy, son geste régressif remet en question le fondement de leur société. On est dans une banlieue aisée de New York, et, contrairement à son entourage bourgeois, Neddy a perdu sa fortune. Mais pour l’instant, le lecteur sait simplement qu’il habite à Bullet Park, treize kilomètres plus loin, et qu’avec « l’œil d’un cartographe » il vient de comprendre qu’une chaine de piscines – « un courant quasi souterrain » – relie le bassin de ses amis à sa propre maison. Il baptise ce courant le « Lucinda », d’après le prénom de son épouse, et il relève le défi de le traverser à la nage de bout en bout, piscine après piscine, en passant par les maisons des Graham, des Hammer, des Lear, etc. Après, il faudra traverser Ditmar Street pour arriver chez les Bunker, puis faire un court « portage » pour atteindre la propriété des Levy, suivie de celle des Welcher, et ensuite la piscine publique de la commune de Lancaster. Il restera encore les propriétés des Halloran, des Sach, des Biswanger…
La nouvelle de Cheever commence donc un dimanche après-midi lors d’un cocktail chez les Westerhazy. Les invités se plaignent d’avoir trop bu la veille, lors d’une autre fête. C’est un milieu de fêtards, fiers de l’être, contents de comparer leurs acquisitions, car comme l’observe Veblen : « Mettre en relief sa consommation d’articles de prix, c’est une méthode d’honorabilité pour l’homme de loisir. » Chez les Westerhazy, la piscine sert de cadre cossu pour la réception, c’est un signe ostentatoire de richesse.

Affiche de « The Swimmer » (1968)
The Swimmer (Le plongeon), film de Frank Perry (1968), donne à ce schéma une allure fantastique. Voir l’eau dégouliner le long du magnifique corps de Burt Lancaster (Merrill), lorsqu’il se promène d’un bassin à l’autre, fait prendre conscience du contraste violent entre sa quasi-nudité et les vêtements conventionnels de son entourage. Devant la caméra de Perry, Lancaster figure l’homme naturel, réunissant l’instinct artisan et l’instinct prédateur décrits par Veblen. En traversant les champs, il croise un pur-sang, avec lequel il se lie d’amitié, les deux « animaux » courent ensemble, séparés par la barrière appartenant au propriétaire du cheval. À côté d’une autre piscine, il tombe sur l’ex baby-sitter de ses filles, qui finit par lui avouer qu’autrefois elle l’avait aimé, confession qui le bouleverse. La rencontre la plus dramatique a lieu avec un jeune garçon perché sur un plongeoir : il semble avoir l’intention de plonger directement sur le ciment du bassin vide.
Les piscines du film sont le lieu de la révélation des basculements du statut social. L’eau fonctionne comme un miroir : impénétrable et transparente, elle cristallise les ambitions des habitants du lieu. L’imperturbabilité de la surface lance un défi, relevé ici par Burt Lancaster, et, dans un autre domaine, par le peintre britannique David Hockney. Dans le livre David Hockney Images (2011), la partie intitulée « Eau » accorde une place importante aux images des piscines. Seules deux d’entre elles sont utilisées par des baigneurs : dans l’un des tableaux, deux hommes nus sont debout au bord du bassin, le dos tourné vers le spectateur – s’apprêtent-ils à sortir ? –, leurs fesses blanches à moitié submergées. Dans l’autre, le nageur – lui aussi sans maillot – s’enfonce dans les profondeurs. On voit qu’il vient de plonger : son élan prolonge le sens du plongeoir, ses pieds laissent la trace d’une grande éclaboussure.
Le plongeoir et l’éclaboussure : voilà la clé de voûte. En plongeant, on traverse une frontière invisible, la barre rectangulaire du plongeoir suggère le crucifix, c’est une croix allongée, sans le Christ. Dans les tableaux de Hockney, le plongeoir est vide, il invite à un saut vertigineux dans l’abime, à condition qu’on sacrifie tout, à l’image de Neddy Merrill. Éclaboussure équivaut à évènement, l’irruption du réel dans la tombe stérile du bassin en ciment.







![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)



![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)
