Le regain d’intérêt pour l’esthétique d’Adorno initié lors du cinquantième anniversaire de sa mort en 2019 ne semble pas s’épuiser. Il est donc heureux que La fonction de la couleur dans la musique contienne plusieurs textes importants indisponibles depuis longtemps ainsi que de nombreux inédits. Pris ensemble, ils ont surtout la vertu de proposer un parcours dans l’œuvre d’Adorno qui permet d’en saisir l’inspiration profonde, qui souvent échappe.
Theodor Adorno, La fonction de la couleur dans la musique. Timbre, musique et peinture ; Wagner, Strauss et autres essais. Trad. de l’allemand par Sofiane Boussahel et Peter Szendy. Contrechamps, 351 p., 28 €
Une phrase de l’« Autojustification de l’Essai sur Wagner » (1952), texte inclus dans le recueil, illustre les raisons de l’actualité d’Adorno : « Est devenue indéfendable cette représentation pluraliste de la culture qui range les unes à côté des autres, dans des rubriques soigneusement compartimentées, les soi-disant valeurs esthétiques, morales et sociales et les dégrade toutes ensemble au rang d’objet de contemplation bienveillante. La complexité du monde par ailleurs menacée [sic] de catastrophe totale ne tolère aucune contemplation de cette sorte. »
Cette phrase résonne fortement avec la tendance actuelle à sonder la valeur morale des œuvres d’art, dans lesquelles on cherche les causes des injustices sociales. Il n’est donc pas surprenant que les écrits les plus populaires d’Adorno soient ceux qui portent sur l’industrie culturelle, censée insuffler « la voix de leurs maîtres » aux consommateurs. Mais, si précieuses que soient ces analyses, elles passent à côté d’un aspect fondamental de la pensée d’Adorno qui considérait que l’œuvre d’art a un « double caractère » : elle est « autonomie et fait social ». L’étude de l’origine sociale des œuvres ne doit pas faire oublier celle de leur « contenu de vérité », qu’on ne peut appréhender qu’« en entrant en elles comme dans des chapelles », selon un mot de Goethe cité par Adorno dans sa Théorie esthétique. Tout l’intérêt du présent volume est de nous permettre de l’y suivre.
La meilleure porte d’entrée est sans doute « L’art et les arts » (1967). Adorno y constate l’« effrangement » des arts, c’est-à-dire l’érosion des barrières entre eux du fait des emprunts toujours plus fréquents entre peinture, architecture, musique et poésie. C’est que les différents arts, dit-il, ont leurs contraintes matérielles propres (leur « matériau »), dont ils tendent à se libérer. Ce mouvement d’abstraction les fait converger, sans pour autant qu’ils partagent une essence commune qui serait « l’art ». Deux ans plus tôt, Adorno suggérait, dans « Sur quelques relations entre musique et peinture » (1965), que la dimension commune aux deux arts est qu’ils sont l’un et l’autre langage. Mais la convergence des arts ne doit pas faire oublier leurs spécificités, qu’Adorno met en évidence dans « Du rapport entre peinture et musique aujourd’hui » (1950). Adorno y compare Picasso, Stravinsky, Kokoschka et Schoenberg pour montrer comment des tendances apparemment similaires prennent des sens opposés selon les arts. Quand le cubisme instaure une distance ludique avec les objets, la peinture y puise un surcroît de liberté ; mais la même démarche en ce qui concerne les formes musicales revient, chez Stravinsky, à ruiner la liberté propre à la musique, qui réside précisément dans la maîtrise des structures. « À partir de la Musique » (1967) propose une analyse du même type en étudiant les sculptures de Wotruba qui retrouvent l’esprit de la musique de Schoenberg par des voies apparemment opposées.
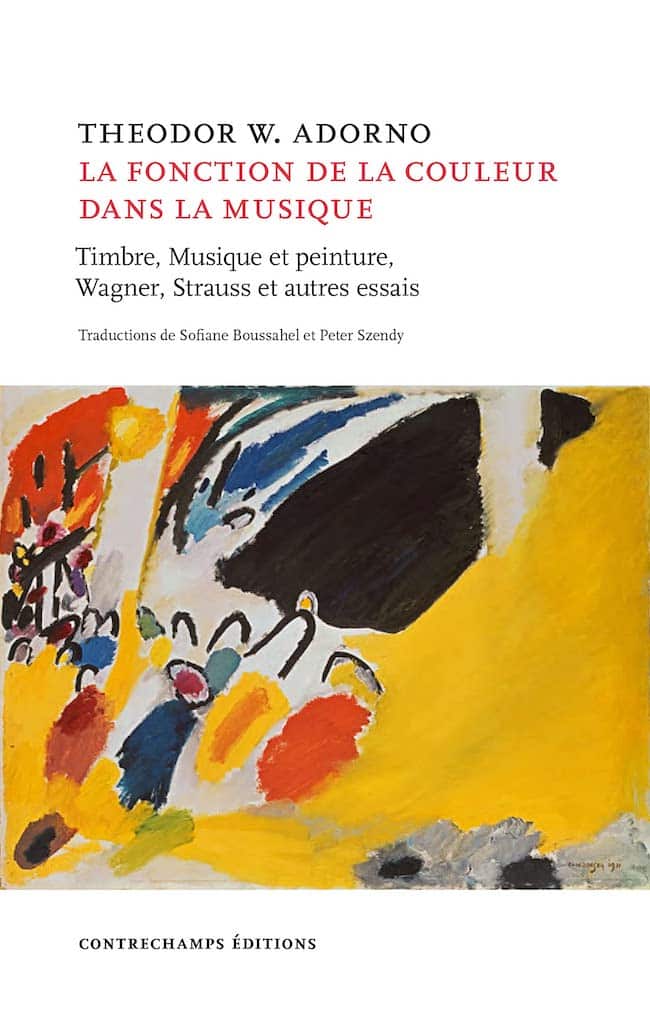
Ces quatre textes familiarisent le lecteur avec la méthode et les enjeux d’Adorno et facilitent la compréhension des neuf autres essais, tous consacrés à la musique. On commencera par celui dont le titre laisse augurer une discussion aride, intelligible aux seuls spécialistes : « Richard Strauss – Questions de technique compositionnelle » (1964). Ce texte propose en fait une réflexion sur l’autonomie de l’art coïncidant avec la naissance de la notion moderne de « technique ». Cette notion n’existait pas du temps de Bach, qui n’écrivait pas « la technique de la fugue » mais bien L’art de la fugue. Elle émerge au moment où « le procédé du compositeur n’est pas simplement réglé par la tradition » : l’artiste ne veut plus cultiver les propriétés inhérentes au matériau mais y imprimer ses propres exigences subjectives. La technique entretient donc « un lien étroit avec le processus de subjectivisation, d’émancipation du sujet vis-à-vis des anciennes hiérarchies traditionnelles ». Mais elle a également partie liée avec l’émergence du public et la recherche du succès. L’œuvre est ainsi travaillée par des exigences contradictoires : d’une part, « la structuration formelle autonome la plus achevée » et, d’autre part, « la cohérence totale par l’effectivité ». Ces deux exigences, écrit Adorno, ont coïncidé pour la dernière fois dans La flûte enchantée. Dans l’œuvre de Strauss, en revanche, elles apparaissent comme irréconciliables, et c’est pourquoi Strauss a résolument sacrifié l’autonomie à l’effectivité dans Le chevalier à la rose.
Adorno souligne que la recherche de l’effet a conduit Richard Strauss à profondément renouveler la technique de composition. Tonalité, rythme, contrastes obéissant à un « principe de surprise », usage des couleurs orchestrales « jusqu’aux confins du rugissement » : les innovations sont telles, écrit Adorno, que « la musique moderne est en réalité le Strauss qui s’est trouvé lui-même et s’est, par voie logique, constitué sa propre structure en lui-même. » Mais pourquoi Strauss ne s’était-il pas trouvé tout seul ? La réponse se trouve dans le violent réquisitoire « Richard Strauss en son centenaire » (1964). Adorno convoque la psychanalyse, l’économie, les sciences politiques et sociales ou encore l’architecture pour faire de Strauss le compositeur bourgeois par excellence, celui qui préfigure l’industrie culturelle. Le texte est écrit dans une langue allusive, saturée de références qui se concrétisent dans des analogies réjouissantes. La musique de Strauss, écrit Adorno, « se comporte à l’égard de la musique à programme de Liszt telles les villas de grand style de 1910 envers les appartements pleins à craquer de 1880 : l’expression musicale tient la maison à partir des stocks des prédécesseurs directs. La générosité avec laquelle il y puise a d’abord été nouvelle. Une telle largesse possède déjà un double sens social ; libérée de l’étroitesse d’esprit, de la morale étriquée, des petits préjugés vilipendés par Nietzsche ; l’indélicatesse, la brutalité et l’inconsistance en complément de la détestable sécurité de la bourgeoisie moyenne ».
Si la charge est violente, le propos n’est pourtant pas univoque. Adorno souligne que Strauss est en porte-à-faux avec sa classe par « sa haine contre tout ce qui, selon ses propres dires, est “guindé” ». La désinvolte liberté de Strauss fait de lui un paradoxe ; il est le bourgeois qui voulait être Dieu. C’est la démesure de ses ambitions qui fait la valeur de son échec. Dans un monde d’où toute transcendance a disparu, l’œuvre de Strauss est « à la fois havre de l’exilé et cellule vide ». C’est parce qu’elle fait signe vers ce que nous avons perdu qu’elle suscite chez Adorno un poignant déjà-vu : l’adulte retrouve un instant le regard qu’il posait, enfant, sur les fêtes de Noël. Adorno conclut que l’œuvre de Strauss contient « une expérience inexorable de la ruine », phrase où l’on entend l’écho de Walter Benjamin et qui n’est pas tant un rejet de Strauss qu’une invitation à l’écouter autrement.
Adorno porte un regard tout aussi nuancé sur le plus sulfureux des compositeurs dans « Actualité de Wagner » (1963). Impossible de banaliser Wagner, dont la relation au nazisme n’est pas purement circonstancielle mais inscrite en l’œuvre même. Se pose donc la question : faut-il jouer Wagner et comment ? Qu’y a-t-il dans l’œuvre qui vaut d’être préservé ? Adorno rappelle d’abord que l’opposition à Wagner fut d’abord conservatrice : « Le mouvement antiwagnérien fut le premier phénomène de ressentiment de grande envergure en Allemagne contre l’Art moderne. » Les puritains ont toujours haï Wagner car « il est peu de choses dans le Panthéon allemand qui soient d’un érotisme aussi libre que sa musique ». L’érotisme de Wagner est lié à sa fascination pour les forces primales, donc à son intérêt pour le mythe, qui est aussi la source des tendances totalitaires des œuvres. Dans la mythologie wagnérienne, « la violence apparaît […] comme cette loi qu’elle était en des temps immémoriaux. Dans cette œuvre absolument moderne la préhistoire est la modernité même. […] Ce fait à lui seul suffit à prouver l’actualité de Wagner ». Parce qu’il a su représenter la violence au cœur de la modernité, Wagner atteint à une paradoxale « transcendance » : il est « tout à la fois au-dessus et au-dessous » de la culture, puisque c’est en régressant vers le mythe qu’il parvient à transcender les représentations bourgeoises. C’est aux metteurs en scène qu’il appartient, en instaurant une distance avec l’œuvre, de médier le rapport à la violence. Adorno se félicite donc des innovations qui ont lieu jusque dans le temple de Bayreuth (il fait probablement allusion à la mise en scène des Maîtres-Chanteurs de Nuremberg par Wieland Wagner en 1963).
Au long des analyses de Strauss et de Wagner, le thème de la couleur musicale émerge progressivement. À mesure que craquaient les formes traditionnelles et que les compositeurs privilégiaient l’effet par rapport à la structure, la dimension hédoniste de la couleur prenait davantage d’importance, jusqu’au jour où Arnold Schoenberg put envisager l’écriture d’une Klangfarbenmelodie, c’est-à-dire d’une mélodie qui ne serait pas fondée sur les hauteurs de notes mais sur leur timbre. Adorno fait l’histoire du timbre en musique en la rattachant à celle des instruments et établit une distinction lumineuse entre le timbre (Klang) et la couleur du timbre (Klangfarben). Toute note produite par un instrument a un timbre, mais il faut que celui-ci soit suffisamment défini pour être entendu et conçu comme une couleur. On pourrait faire la même distinction pour les sensations visuelles : il y a un pas entre les teintes des objets et leur déclinaison sur la palette du peintre, où elles forment un continuum structuré. La musique de Berlioz est le moment où émergent simultanément une recherche de couleur de la part du compositeur et les moyens techniques permettant de la satisfaire. De Berlioz à Wagner puis Strauss, la couleur s’impose comme un élément essentiel de la composition, théorisé comme tel par la seconde école de Vienne, dont les recherches sont prolongées, par exemple, par Ligeti. Peut-on cependant penser, comme Stockhausen, que la couleur se prêtera bientôt à des développements structurels comparables à ceux que permettent la hauteur ou le rythme ? Adorno en doute, mais avoue être « encore accroché […] à certaines représentations traditionnelles » – une modestie qui sied à un penseur aussi respectueux du passé que visionnaire.
D’un essai l’autre, le lecteur est ainsi conduit de la question la plus fondamentale de l’esthétique – qu’est-ce que l’art ? – à celle qui est encore aujourd’hui au cœur de la musique contemporaine : les potentialités structurantes et signifiantes du timbre. Si lui venait le désir d’approfondir la réflexion d’Adorno sur la musique, réflexion qui reste aujourd’hui la meilleure voie d’accès à la musique contemporaine, il en trouverait l’occasion dans les trois précédents ouvrages d’Adorno publiés par les éditions Contrechamps : Figures sonores, Moments musicaux et Introduction à la sociologie de la musique. Pour l’heure, lire La fonction de la couleur dans la musique est une excellente manière de pénétrer au cœur de la pensée d’Adorno, dont on oublie souvent qu’il fut compositeur, élève d’Alban Berg, et qu’il puisa toujours dans la musique la matière première de sa pensée, si ce n’est la forme de son écriture.












