Alice Kaplan est une universitaire américaine qui s’est fait connaître en France par un livre aussi remarquable que remarqué sur Albert Camus, En quête de L’étranger (Gallimard, 2016), où elle a su finement analyser ce « saut dans la mort » inscrit dans le patronyme de Meursault. Son premier roman vient d’être traduit en français.
Alice Kaplan, Maison Atlas. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Patrick Hersant. Le bruit du monde, 272 p., 21 €
Parcourant Alger pour les besoins de son enquête camusienne, Alice Kaplan y découvre la présence d’un judaïsme – mais elle préfère parler de judaïté – résiduel qui la retient et l’interpelle dans sa fibre juive d’ascendance ashkénaze : au milieu de la Casbah, sur la Grand-Place naguère appelée du nom du Grand-Rabbin Abraham Bloch (un héros de la Première Guerre mondiale), on lui montre la grande synagogue, désormais vouée au culte musulman, que tout le monde à Alger appelle « la mosquée des Juifs ». Intriguée, elle se lance à la découverte de ce qu’il peut encore rester de juif dans cette ville et ce pays qui comptait avant l’indépendance quelque cent cinquante mille « Israélites ». Une famille la retient, qu’elle nomme Atlas – comme le massif maghrébin ou le Titan porteur du monde. On reconnaitra sous ce nom la lignée d’un homme politique juif qui fut président de l’Assemblée algérienne et demeura jusqu’au bout fidèle à ce qu’il avait été, « l’élu de la Casbah », et farouche partisan d’une Algérie indépendante mais où tous seraient restés.
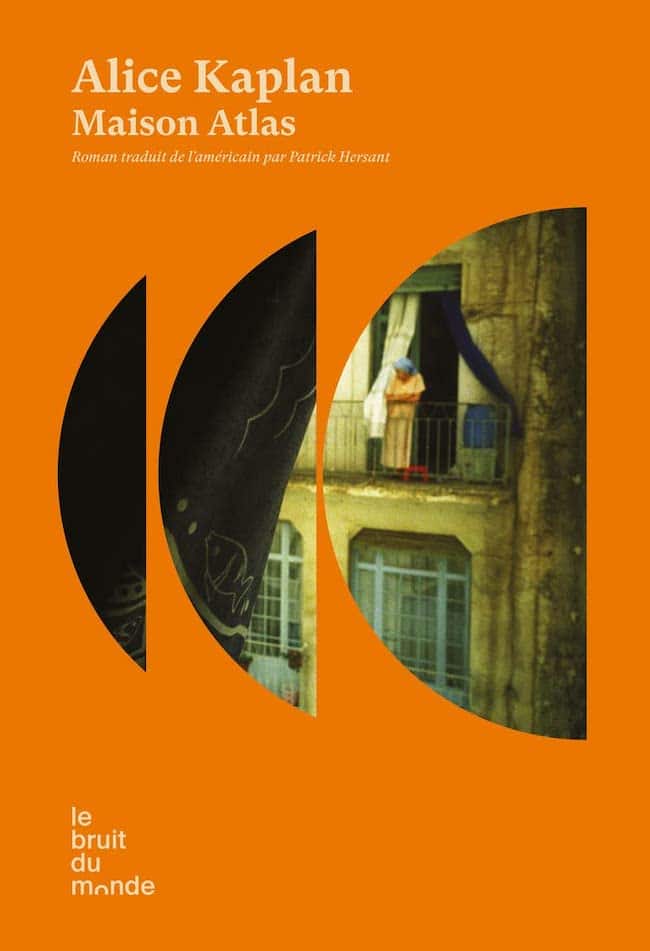
Le récit commence par l’inévitable rencontre initiale en forme de coup de foudre. Un homme et une femme, étudiants à l’université de Bordeaux. Lui vient d’Alger et est algérien, elle est américaine de Minneapolis. Ils se découvrent, accidentellement, juifs. Ce Daniel Atlas est tout bonnement le dernier de ces Juifs glorieux d’une Algérie séculaire ; les racines d’Emily sont à chercher du côté de la Mitteleuropa. Au demeurant, ce Daniel n’est juif que par son père, Samy, héritier du grand Henri Atlas, qui fut cet homme politique d’Alger unanimement respecté, mais aussi prince déchu, autant que déçu dans ses aspirations à une Algérie libre et plurielle.
L’amour fou de ces deux jeunes gens pourrait, en d’autres circonstances, déboucher sur un mariage. Mais voilà, l’Algérie traverse la crise des années 1990, guerre civile de dix ans qui fera cent cinquante mille morts. Daniel, inquiet pour ses parents, et remettant à plus tard la suite de ses amours, s’en retourne à Alger, où son père sera bientôt assassiné, sans qu’on sache par qui ; il n’ira pas rejoindre celle qu’il aime. Tout pourrait en rester là, lien rompu et oubli. Mais il a eu une fille avec Emily : vingt ans après, la jeune Becca désembobinera l’écheveau, fouillant tous les sites généalogiques, et c’est elle qui raccordera le fil des illusions perdues.
La quête du géniteur, tel est l’itinéraire romanesque, opérée sur une trame qui veut croire à la transmission, cet impératif prégnant du judaïsme tel que l’énonce l’expression hébraïque ledor vador, « de génération en génération », qu’aime à répéter la romancière. Mais, pour en arriver là, il faut parcourir ce terrain accidenté d’une Algérie déchirée de rivalités politiques et religieuses. Nous sommes au milieu du chaos, d’un « asile de fous à ciel ouvert », comme le dit Daniel.
L’identité de ce personnage demeure problématique dans l’Algérie indépendante. Après 1965 et la chute de Ben Bella, seuls les musulmans y ont réellement eu droit de cité, les représentants d’autres confessions y étant discriminés ou, comme ici, assassinés. Henri Atlas clamait bien haut son indigénat, dont le régime de Vichy lui avait redonné une claire conscience en lui retirant la citoyenneté accordée en 1870. De 1940 à 1943, les Juifs, sauf rares exceptions, ne furent plus français. D’où cette phrase de l’auteure qui dit toute l’ambiguïté de l’identité des Atlas : « Les Juifs d’Algérie, même absents, hantaient le pays précisément parce qu’ils étaient des Juifs arabes ».

Alice Kaplan © Bob Hendelman
Eux, les Atlas, sont restés ; ils sont demeurés algériens, tout en conservant prudemment leur passeport français. Et dans cette ville à la judaïté fantasmée, il ne reste que quelques vieillards regroupés dans un centre communautaire de Bab el-Oued dont s’occuperont jusqu’à leur mort – et là, Kaplan les cite – maître Roger Saïd et sa sœur, Line Meller-Saïd, par ailleurs romancière et chroniqueuse de cet Alger qui lui échapperait définitivement. Les stigmates de cette exclusion des Juifs se résument ici à l’attentat à la bombe contre la plus belle des synagogues, celle des mariages, rue de Dijon, dont Alice Kaplan, dans sa visite, ne ramènera que ruine et gravats.
Les connaisseurs de l’histoire algérienne reconnaitront en Henri Atlas le belle et haute figure du député Marcel Belaïche qui fut, un temps, président de l’Assemblée algérienne, alors partagée en deux collèges (l’un français qui prenait les décisions, l’autre « arabe » à valeur dérisoirement consultative), et lutta pour l’adoption d’un collège unique et en faveur d’une réforme qui aurait donné des droits égaux, indistinctement, à toute la population du territoire (vieux et lucide projet, d’ailleurs, de Napoléon III, surnommé pour cela « l’empereur des Arabes »). Promis à l’oubli, les Atlas et leurs aspirations ? À coup sûr, n’était cette petite Américaine qui, acharnée à retrouver les traces de son géniteur, fera le voyage jusqu’à rencontrer ce vieil homme aux cheveux gris, qui lui ouvrira les portes de sa maison et lui fera accéder au rêve d’une Algérie qui n’est plus.
Finalement, l’amour triomphe, certes, mais avec un goût de cendre dans la bouche. Dans un style d’une grande sobriété, s’attachant davantage à la psychologie de ses personnages contrastés qu’à une radiographie politique et historique de ce pays à laquelle elle n’est pas préparée, constatant seulement, au détour du récit, que « l’Algérie est une énigme », Alice Kaplan nous donne, en définitive, un portrait sensible de cette terre algérienne fichée comme une écharde dans la conscience française, dans les soubresauts horrifiants de la guerre et les tourments d’une société qui n’a toujours pas évacué ses démons.












