Qui peut se vanter de posséder la clef d’interprétation de la « philosophie », de la pensée de Walter Benjamin ? Comme chez Kafka, les strates se superposent sans s’annuler, les lectures, politiques, religieuses, esthétiques, rivalisent. Il en est ainsi du rapport très ambivalent de Benjamin à la technique et à la modernité qu’elle incarne, comme on le voit dans son monumental Paris, capitale du XIXe siècle, quand il est question de l’architecture de fer et de verre propre aux passages parisiens et dont il salue la transparence protectrice. Benjamin ne partage pas la critique réactionnaire de la modernité technique caractéristique du romantisme allemand ; dans un texte essentiel, « Expérience et pauvreté », il prend le parti de la sobriété et de la nudité, de l’effacement des traditions. Philippe Baudouin aborde cette question décisive de la technique, de la modernité et du lien entre elles par un biais qui peut paraître marginal – les textes radiophoniques – mais qui n’est pas loin de conduire aux réflexions les plus hardies de Benjamin.
Philippe Baudouin, Walter Benjamin au micro. Un philosophe sur les ondes (1927-1933). Édition de la Maison des sciences de l’homme, 288 p., 18 €
Après l’échec en 1924 de son habilitation, qui aurait pu lui assurer une carrière universitaire, Benjamin se tourne, grâce à son ami Ernst Schoen, vers la radio, de 1927 à 1933. Une centaine de contributions (celles qui subsistent) sont rassemblées dans un précieux volume intitulé en français Lumières pour enfants (Christian Bourgois, 1989), et complété depuis par une abondante bibliographie. La radio ? Le Rundfunk ? S’agit-il d’un simple gagne-pain, par essence précaire ? Philippe Baudouin, par une réflexion théorique plus large sur le médium de la radio en général, met admirablement en valeur la vraie portée de ces petits contes à l’intention des radios de Francfort et de Berlin.

Portrait de Walter Benjamin © CC2.0/Renée
Le message, dans un premier temps, apparaît politique. L’auteur a perdu son auréole, il devient producteur et, comme son ami Brecht, il cherche à cette époque à susciter un sentiment de distance, de dépaysement, voire d’étrangeté. C’est la fin de « l’œuvre d’art » avec l’aura que lui procure sa présence hic et nunc. Avec elle, nous entrons dans l’ère de la reproductibilité, de l’omniprésence, du podcast universel. Comme l’écrit Philippe Baudouin : « loin de mépriser la radio ou de sombrer dans le fétichisme de la technique, Brecht, comme Benjamin, voit dans ce médium un moyen révolutionnaire de modifier le rapport du public à la culture, à la politique, etc. ». Ces interventions sur les ondes, sans doute un peu improvisées, sont donc présentées comme le fruit d’un « véritable laboratoire », d’une expérimentation progressiste : d’où ce titre d’Aufklärung qui est attribué un temps à l’édition allemande. Et l’on ne peut que souscrire à l’ambition reconnue à ce médium.
Mais surgit tout de suite un paradoxe, une étrangeté imprévue : Benjamin, pour réaliser ce projet culturel, choisit de recourir à la « formule archaïque » du conte. Il s’inspire ici plutôt de son ami Ernst Bloch, qui, dans Héritage de ce temps, opposera lui aussi à la fatalité de l’aliénation le conte, libérateur, émancipateur, qui sait ironiquement échapper aux puissances paralysantes du mythe. Le « petit homme » du conte triomphe finalement du mythe et du destin. Présenter des contes modernes, à la hauteur des enjeux contemporains (ne serait-ce que pour neutraliser la voix de Hitler dès les années 1920), telle est la mission que se donne Benjamin, avec un grand sens de l’urgence.
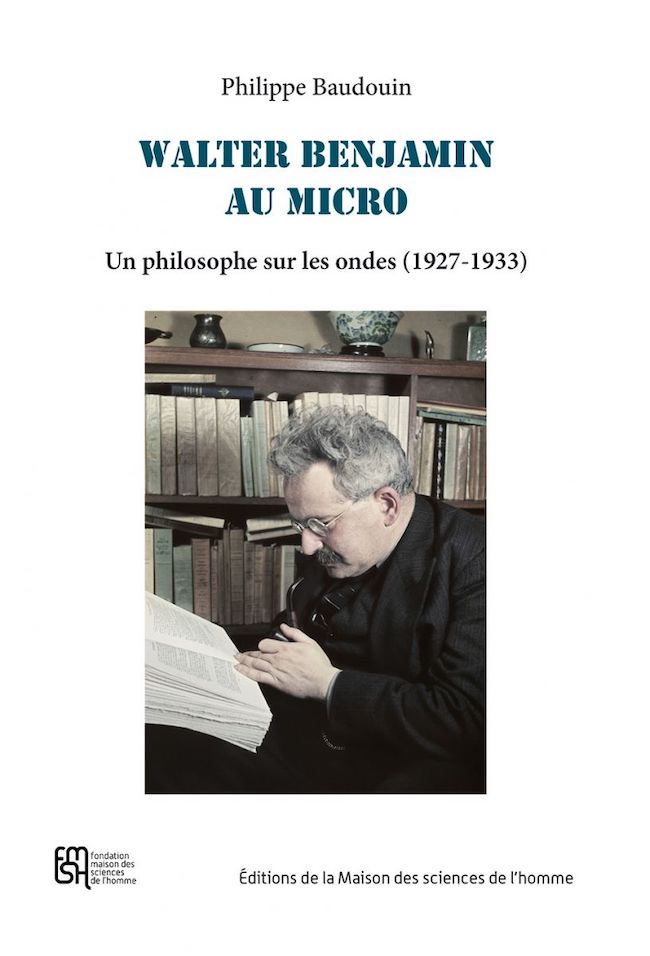
Les lecteurs français et allemands de ces contes destinés à l’éducation politique des enfants, une fois admise leur ambition émancipatrice, n’ont pas manqué cependant d’être surpris par la tonalité de cette Aufklärung : les héros de ces contes sont généralement des escrocs et des charlatans, des brigands et des va-nu-pieds, des « sans-parole », des sorcières et des pirates, voire un personnage énigmatique comme Cagliostro et même un faux messie, Sabbataï Zevi. Romain Rolland avait écrit des « vies héroïques », Pierre Michon a retracé des vies « minuscules » ; Benjamin présente aux gamins de Berlin des « vies infâmes » en rupture avec l’ordre social.
Mais quand les adultes ont dévoilé leurs « trucs de magicien », c’est le récit de catastrophes que la « voix invisible » de Benjamin propose à l’éducation des enfants : les cendres de Pompéi, le tremblement de terre de Lisbonne, l’inondation du Mississippi en 1927… C’est une vision de l’histoire comme catastrophe et comme désastre qui sert d’arrière-plan à ces vignettes pour enfants, lesquels découvrent ainsi en même temps le mal et le malheur, mais aussi la mystérieuse réconciliation des êtres, que Benjamin associe à la notion d’apocatastase selon Origène, « l’admission de toutes les âmes au paradis ». Mais, avec un moindre degré de théologie, il est loisible de penser que l’enseignement et l’exemple que les jeunes auditeurs de Benjamin ont pu tirer de ces chroniques radiodiffusées sont une certaine expérience de la ville comme labyrinthe, ouverte au flâneur, au collectionneur, au poète baudelairien, et au philatéliste… « L’enfant, écrit Philippe Baudouin, est en mesure de réveiller l’âme des choses pétrifiées et dès lors […] d’établir des liens privilégiés avec l’utopie. » Benjamin dans ces émissions tente de rendre justice à cette dimension secrètement utopique.

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)





![Quinn Slobodian, Le Capitalisme de l’apocalypse. Ou le rêve d’un monde sans démocratie, trad. de C. Le Roy, Seuil, 2025 [2023], 368 p., 25,50 € Arnaud Orain, Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle)](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/01/1920px-Yangshan-Port-Containers.jpg)




