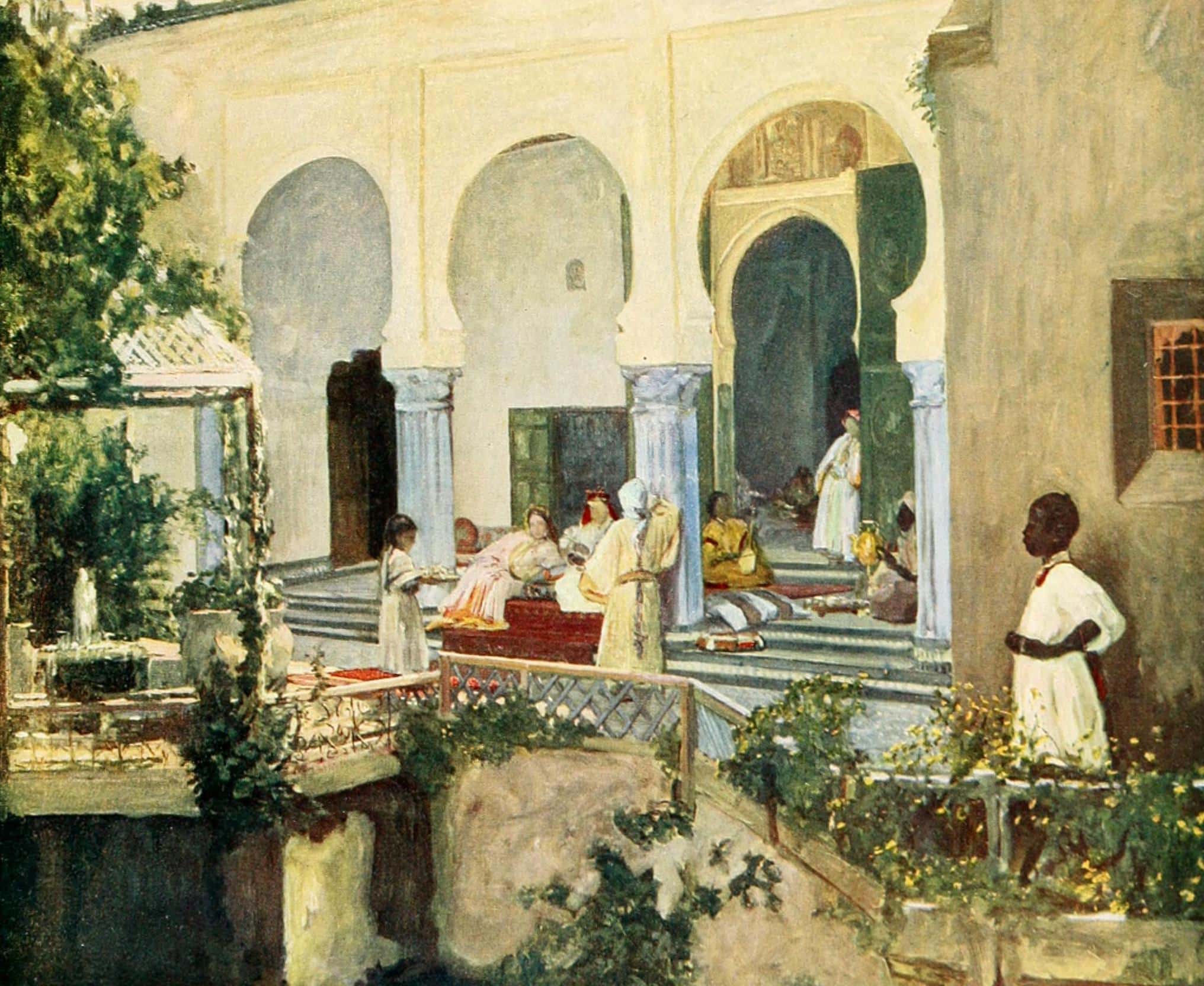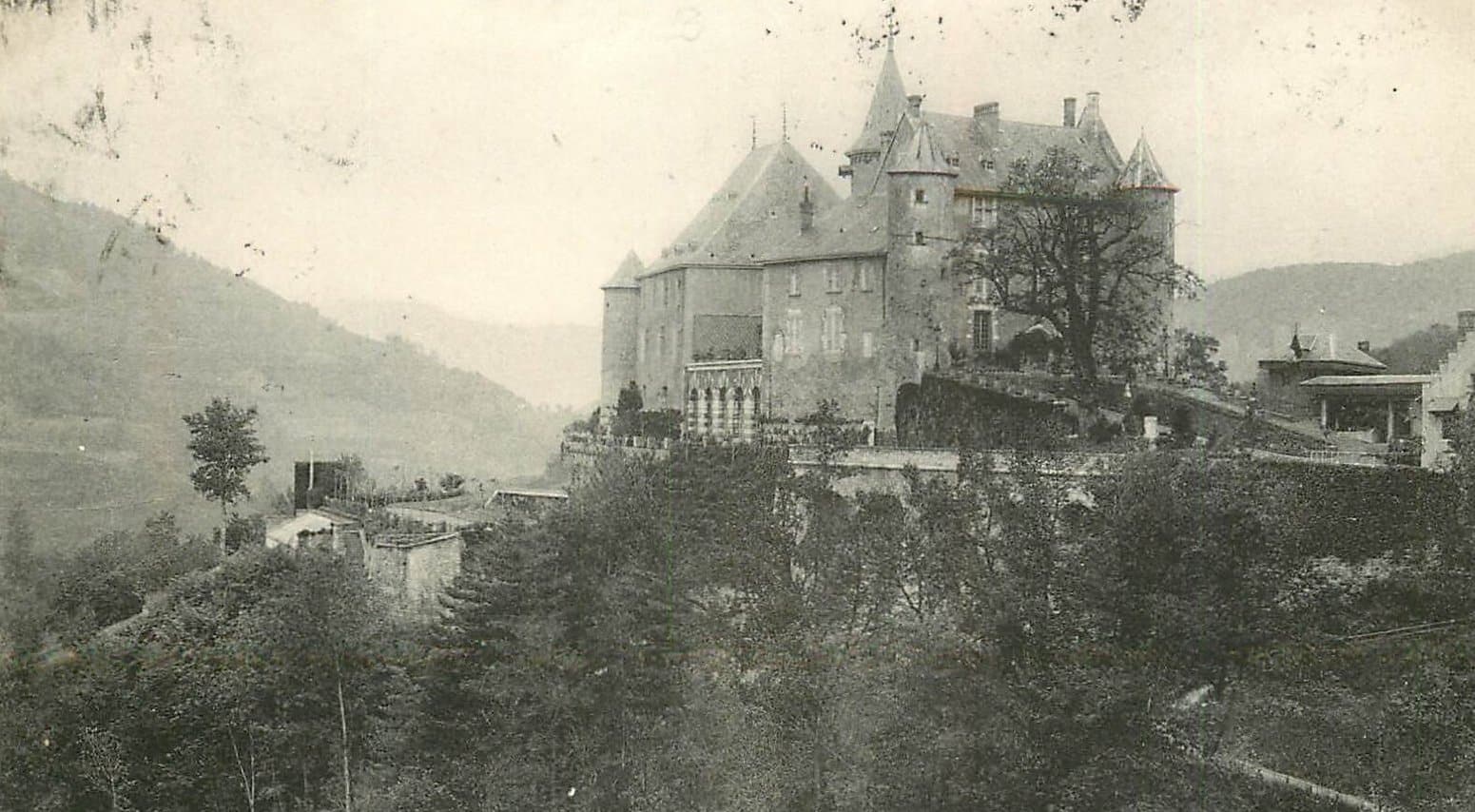La plantation coloniale hante la mondialisation. À cause de la paresse, de l’idéologie, ou de l’amnésie, peu d’études historiques parviennent à exorciser les clichés qui entourent ces lieux de massacres perpétrés sur tant de siècles. Du Cubain Manuel Fraginals, avec El Ingenio (La plantation) en 1964, jusqu’à la classique synthèse de Philip Curtin (Plantation Complex, 1991), rares sont les ouvrages de référence sur ce sujet majeur dans les bibliographies de la traite atlantique et de l’esclavage des populations déportées d’Afrique. Plus encore en français, peut-être, où les travaux précédents de Gabriel Debien ou de Jacques de Cauna, auxquels Paul Cheney rend un hommage appuyé, sont rarement cités. La traduction de Cul de Sac, cinq ans après sa publication originale, est de ce point de vue un événement.
Paul Cheney, Cul de Sac. Une plantation à Saint-Domingue au XVIIIe siècle. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Christophe Jaquet. Fayard, 320 p., 24 €
Le sujet du livre est aussi simple que son titre : l’histoire d’une plantation de Saint-Domingue, actuel Haïti, dans la plaine de Cul de Sac, possédée par la famille française des Ferron de la Ferronays. Sa nature exceptionnelle tient d’abord aux archives sur lesquelles travaille Paul Cheney : l’ensemble des papiers de la famille noble a été saisi par les gouvernements français lors de la Révolution, et les documents postérieurs à 1789 ont été ouverts par leur propriétaire actuelle, Aliette de Cossé-Brissac. Cette source exceptionnelle permet à l’auteur d’atteindre ce qui n’existait pas dans les recherches précédentes sur l’empire colonial français, à savoir le temps long – les sources précédemment étudiées par Debien ou Cauna concernaient des périodes plus courtes et ne possédaient que très rarement le degré d’intimité atteint par les archives des Ferron de la Ferronays.
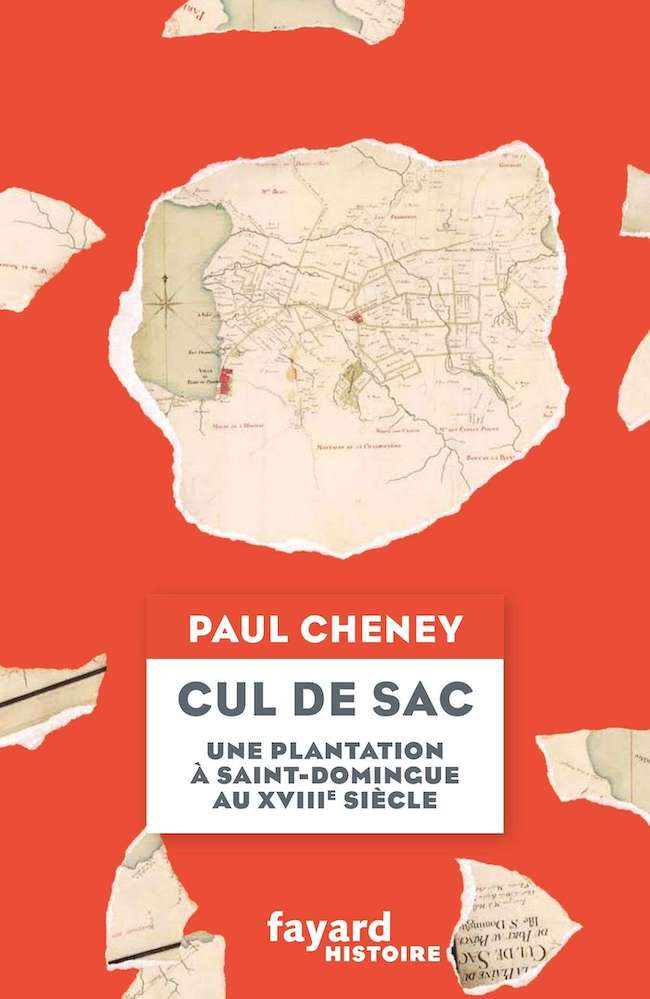
Il ne faudra pas trop s’étonner d’évoquer l’intimité de documents servant l’histoire d’une plantation sucrière, car c’est l’un des ressorts les plus novateurs du livre, qui prend au sérieux l’art d’écrire de ces gens de plantations qui se concevaient aussi comme des gens de lettres. L’essentiel de la documentation de Paul Cheney est en effet constitué par la correspondance entre les propriétaires de la plantation (les Ferron de la Ferronays, résidant le plus souvent en Europe) et la famille de leurs intendants, les Corbier. Cette correspondance transatlantique permet de tout suivre : les affaires, bien sûr, la gestion des esclaves, la propagation des idées des Lumières dans ce bout d’empire colonial français, le maintien des réseaux de clientèles bretons, l’intimité sexuelle des couples, les stratégies matrimoniales, l’ennui, le jeu, l’impact de 1789 ou de la guerre de Sept Ans, les liens avec les États-Unis ou Cuba, le rôle de la cour, des fonctionnaires, le marronnage, l’influence sentimentale de Rousseau. Rien, semble-t-il, n’échappe à Paul Cheney dans sa lecture de cette documentation monstrueuse, et l’auteur parvient à un geste d’historien qui n’est pas sans précédent : trouver dans les traces laissées par ces personnages (Corbier et Ferron de la Ferronays) un point de vue qui reprend tout ou presque. On pense au Mennochio de Ginzburg, au Pinagot d’Alain Corbin, à tous ces anonymes qui, par un geste historique, devinrent des clefs ouvrant sur des mondes entiers.
Aussi efficace que bref, le livre articule cette foule de thèmes au moyen d’un procédé assez simple en apparence. Chaque chapitre s’organise autour de deux notions que l’auteur fait jouer ensemble : « province et colonie », pour souligner l’imbrication des échelles et des géographies dans l’histoire mondiale et locale de Cul de Sac ; « production et investissement », pour mener une critique méthodique d’un capitalisme allant irrationnellement mais sûrement dans une impasse économique fatale ; « évacuation et indemnité », pour poser la question du devenir de cette histoire toujours brûlante. Ce tempo binaire permet à l’analyse de se déployer en un entrelacs de multiples conversations, prises au débotté puis quittées, reprises plus loin. Leurs sujets ne sont pas anodins et ouvrent de nombreuses perspectives sur de passionnants et vertigineux débats. Pour donner à voir un peu plus précisément ce qui se joue dans Cul de Sac, trois exemples peuvent être isolés parmi tant d’autres.

Carte de la plaine de Cul de Sac, entre la ville de Port-au-Prince et la rivière de l’Artibonite (1750) © Gallica/BnF
Dans le chapitre « Humanité et Intérêt », Paul Cheney plonge dans la question de la « police des esclaves » au siècle des Lumières à partir des cas de conscience de Corbier. Voici un intendant dont le but est l’enrichissement économique de la plantation, auquel il est intéressé directement puisqu’il reçoit 10 % des bénéfices totaux. Prosaïquement, il doit rendre compte de sa gestion au propriétaire. Cependant, Corbier souhaite faire preuve d’« humanité ». Il s’interroge, lit les philosophes, Beccaria ou Rousseau. Il réfléchit aux questions d’hygiène des esclaves et fait construire, comme le veut l’administration coloniale à partir de 1776, un hôpital. Le plus rationnel n’est-il pas de bien traiter les esclaves, avec humanité ?
La gestion de l’hôpital permet d’illustrer au plus près la conciliation de l’humanité et de l’intérêt telle que la conçoit Corbier. Lieu de repos pensé pour les esclaves, de façon à leur permettre d’être plus efficaces dans leurs tâches, l’hôpital permet de valoriser l’humanité de Corbier. Pour autant, il importe de maintenir jusque dans ces soins la clarté de la structure servile : les malades étaient attachés par les pieds à la « barre » et n’avaient en réalité droit qu’à un repos minimum et toujours contrôlé, compté. « La contrainte corporelle rappelait aux détenus que le rétablissement de leur santé n’était lui-même qu’une autre forme de travail accompli pour le bien de leurs maîtres. Prisonniers de la barre, les esclaves touchaient avec leur chair la véritable relation entre l’humanité et l’intérêt. »
Le jeu entre humanité et intérêt permet ici de faire rayonner les faits comme les idées qui les pensent : humanité de l’esclavagiste contraint d’interroger la déshumanisation des esclaves à laquelle il participe, intérêts financiers qui se télescopent avec les intérêts économiques, éthiques, sociaux, tout cela faisant retour à une histoire du corps asservi et outragé. La « véritable relation entre l’humanité et l’intérêt » se fait chair grâce au travail historique, dont la destination devient l’incarnation presque littérale de celles et ceux qu’on a meurtris dans leurs corps. Est-ce à ce prix-là aussi qu’en Europe furent pensés l’humanité et l’intérêt ?

La plaine de Cul de Sac (1888) © Gallica/BnF
Paul Cheney tire également un parti passionnant des velléités littéraires des Corbier et des Ferron de la Ferronays. Leur correspondance est truffée de citations, de digressions, d’exercices de style souvent loin d’être ridicules, de critiques littéraires et esthétiques. Cul de Sac décide de s’emparer pleinement de cette dimension en la reliant à un contexte littéraire plus large, clivé entre d’un côté un culte de la sensibilité (Rousseau, Lessing, Richardson) et de l’autre la rationalisation de la pensée économique (Adam Smith, Mandeville, Condorcet). Par ce biais littéraire apparaît une interprétation remarquable de certains comportements des Corbier en milieu colonial, en établissant des parallèles saisissants avec La Nouvelle Héloïse et Julie, son héroïne : « Le culte de l’humanité exigé par la logique émotionnelle de la sensibilité conduit Julie à sacrifier son amour pour lui, un amour qui n’est qu’individuel. Ce qui ressemble de l’extérieur à un mariage d’intérêt témoigne en réalité de la profondeur du sacrifice de Julie, qui va jusqu’à la mort. En dépit de son amour et de sa pitié pour les esclaves qu’il commandait, Corbier fils devait néanmoins trouver en lui la force de les punir comme l’exigeaient l’ordre et le profit. Les âmes sensibles servent le bien commun par des voies paradoxales. »
Dans cette optique, on peut interpréter certaines lettres étonnantes avec profit. Corbier père, en froid avec son fils, demande à Ferron de la Ferronays s’il peut faire don d’une esclave à celui-ci pour assouvir ses besoins sexuels. Le proxénétisme du père, justifié par une conception sentimentale de la famille, se conclut heureusement : « Une fois ces désirs sexuels domestiqués, la tension entre le père et le fils se dissipa, et les passions du second, désormais calmées, purent être détournées vers le progrès de l’humanité. La luxure, comme la cruauté, dérangeait la bonne administration de la plantation. » Cette exploration historico-littéraire de l’intimité coloniale jusque dans sa dimension sexuelle dialogue avec un pan majeur de l’anticolonialisme – on pense à Fanon, ou à l’analyse de la situation coloniale chez Balandier. Le caractère pathologique, pervers, de cette situation apparaît ici dans une rationalité et une écriture nouvelles, plus troublantes encore, qui croient parvenir à réguler la prostitution par le proxénétisme, l’humanité par la réification, la luxure par le viol, la cruauté par la brutalité répressive, le meurtre par l’exécution, ou plus tard à remplacer l’indépendance d’Haïti par l’indemnisation des colons.

La plaine de Cul de Sac (2017) © CC4.0/Yohann-benmalek
Cette apesanteur des valeurs morales, sociales, esthétiques, n’est jamais aussi criante que dans un chapitre prodigieux (« Mari et femme ») à tout point de vue, qui fournira une dernière illustration des voies ouvertes par ce Cul de Sac. Ces voies sont celles du genre, de la créolisation, de l’histoire matrimoniale, de l’intimité. Tant de voies pour comprendre en quoi le cul-de-sac en était bien un – le jeu de mot est de Paul Cheney – pour cette société coloniale moribonde dont l’agonie semble s’étirer sur le long siècle préindustriel mais déjà industrieux (1750-1850). Ferronays est marié à Marie-Élisabeth Binau de Léogane, fille d’un bourgeois créole, habitant de deuxième génération de l’île. Mariage d’intérêt, bien évidemment, qui explose en quelques mois : le marquis délaisse sa femme pour une vie de débauche, avant de regagner seul la France et la cour, faisant naître une détestation commune au sein du couple.
La correspondance de Corbier devient éloquente dans ses sous-entendus (l’intendant invente un personnage d’un autre nom pour décrire à Ferronays les frasques de son épouse) : Marie-Élisabeth a de nombreux amants, donne naissance à plusieurs enfants dont elle se fait la marraine à défaut de pouvoir être officiellement leur mère, impose pour ces bâtards créoles une éducation aristocratique en France, multiplie les scandales sexuels et mondains, crée une sorte de communauté où se rejouent les rôles de genre et de race, avec un certain tropisme abolitionniste qui ne franchit toutefois jamais le pas d’un anti-esclavagisme structuré. Marie-Élisabeth est littéralement monstre et mère de monstres sous la plume de Corbier, qui ne parvient guère à l’écrire tant elle figure un impensable que Paul Cheney ressuscite entre les lignes de documents qui ne cessent de l’accabler comme stupide, nymphomane, impie, démoniaque. À travers sa biographie, ainsi retracée comme en négatif des sources, c’est toute l’ambiguïté et l’horreur de la société coloniale et esclavagiste qui ressortent, aveuglantes. Il y a là un modèle de visibilisation d’une parole bridée, ridiculisée, volée, par les sources, dans la façon qu’a Paul Cheney de redonner sa voix à Marie-Élisabeth.
Ce grand chapitre d’un livre puissant trouve dans ces flots d’anonymes des voix à réenregistrer et des chairs à nouveau sensibles, ressources par lesquelles on aborde des mondes, des siècles, des imaginaires. Aussi nos mondes et notre temps, que ce Cul de Sac apostrophe avec autorité en démontrant à quel point les impasses peuvent s’emprunter longtemps, à l’aveugle. Pour un monde, cela prend du temps de mourir, aujourd’hui comme hier.