Si le volet critique du travail de Jean-Luc Steinmetz est connu et reconnu depuis 1985, sa part créative – un temps en devenir – est en revanche restée durablement dans l’ombre. La revue Nu(e) et le site Poezibao ont, en 2018, attiré l’attention sur ce qui s’était développé à partir de 1990. Il est alors apparu qu’avec des recueils tels que Le jeu tigré des apparences (1994) ou 28 ares de vivre (2019), l’ensemble des livres publiés par Jean-Luc Steinmetz au Castor Astral méritait d’être mis au premier plan. Vers l’apocalypse confirme aujourd’hui cette importance.
Jean-Luc Steinmetz, Vers l’apocalypse. Le Castor Astral, 200 p., 15 €
Europe, n° 1121-1122 (septembre-octobre 2022). 384 p., 20 €
Jean-Luc Steinmetz, Présence de la poésie. Présentation, choix de poèmes et cahier photographique par Marc Kober. Éditions des Vanneaux, 380 p., 20 €
Ce livre constitue la clé de voute d’une actualité qui combinera, de septembre à novembre 2022, la publication d’un récit, Un homme en trois (PROPOS-2 éditions), une soirée en prélude du Salon de la revue organisée par Ent’revues, une étude dans Critique et enfin un dossier dans Europe. Préparé par François Rannou, celui-ci réunit un entretien, des inédits et des interventions (Lionel Ray, Daniel Leuwers, Laurent Fourcaut, Henri Scepi) parmi lesquelles on remarque une étude très convaincante de Béatrice Bonhomme.
Vers l’apocalypse est un poème d’une rare ambition. Nourries de la lecture de l’Apocalypse de saint Jean, mais aussi de nombreux voyages et d’une conscience aigüe de l’évolution chaotique du monde, ces 180 pages écrites entre octobre et décembre 2019 ont la force d’une vision. Même si des évènements survenus récemment en corroborent certains passages, il ne faut pas s’y tromper : c’est l’écriture du livre qui fonde son importance. À commencer par une qualité rythmique constante et une versification servant sa dimension spirituelle, au point que trouver la bonne vitesse de lecture est déterminant pour que le texte se révèle dans toute sa singularité : « Il s’agit, à tout instant, de bien autre chose que de comprendre. »
On trouve une des premières reconnaissances de l’activité poétique de Jean-Luc Steinmetz dans l’anthologie La nouvelle poésie française de Bernard Delvaille. Au début des années 1970, celui-ci avait fait sensation en pariant sur cent noms pour désigner aux yeux de tous la génération qui devait prolonger celle des Deguy, des Réda, des Dupin… Près de cinquante ans plus tard, on peut s’apercevoir de sa clairvoyance : une large proportion des poètes choisis s’est effectivement imposée au cours d’une évolution qui a connu l’apogée et le déclin des avant-gardes, le renouveau du lyrisme, le retour des vieilles certitudes et l’explosion du postmodernisme.
Mais il n’était pas du pouvoir du directeur de la collection « Poètes d’aujourd’hui » de deviner l’évolution des uns et des autres. Ainsi, Jean-Luc Steinmetz occupe désormais une place bien plus importante que celle qui était la sienne hier. Même si sa participation aux recherches sur le langage l’a parfois mis en péril, même si le souvenir du caractère polémique de TXT – la revue qu’il a cofondée – en a dissuadé plus d’un d’écrire sur lui, même si ses travaux sur Lautréamont, Mallarmé et Rimbaud ont capté les regards, il est, en tant que poète, un repère qu’ont signalé des lecteurs aussi avisés que Malrieu, Tortel, Jouffroy, Forest, Maulpoix, Beck et Barbarant.
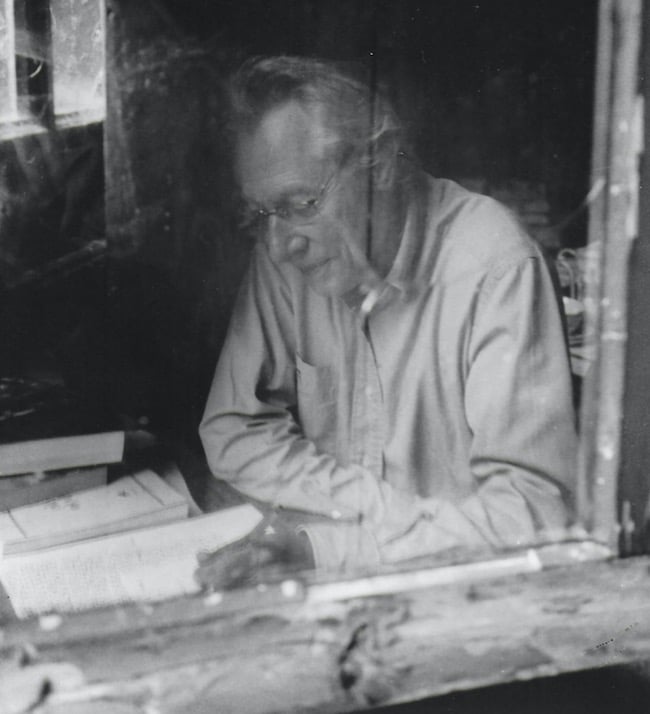
Jean-Luc Steinmetz © D. R.
Vers l’apocalypse n’a guère d’équivalent dans la poésie de ces trente dernières années. Comment expliquez-vous ce qui ressemble fort à une éruption ?
Aucun motif particulier n’explique l’avènement d’un poème dont l’ampleur ne m’était pas habituelle. Néanmoins, presque tous mes livres contiennent de longs textes. Ici, le départ fut une relecture de l’Apocalypse de Jean. La réalité des genres classiques répond à une répartition universelle. Mes poèmes se sont tous confrontés à celle-ci, en prenant soin de renouveler les genres. Il se trouve que, depuis 2006, ils ont objectivement une valeur testamentaire, qu’ils retracent une descente imaginaire dans l’au-delà, évoquent un décès ou dressent une liste de legs (1).
À quel moment avez-vous senti que ce texte était abouti ?
Le moment était venu pour moi de signifier une fin du monde et de la dire selon le texte de Jean de Patmos, en y portant un constant regard critique qui l’actualiserait. L’entreprise supposait une analyse préalable, une interprétation de base, une supervision et la pleine disposition du langage en son étendue maximale. Fort de certains acquis d’écriture, je me suis lancé dans cette performance avec pour garants le texte biblique, les interactions du langage avec lui-même et les dix-sept poètes universels qui interviennent au final. Le texte s’achève au moment où cesse celui de Jean, qu’il entend et regarde, et dont il cite les paroles. L’heure de la fin conclut à la seule présence/absence du langage qui vaut en ce cas comme alpha et oméga, alphabet constitutif du monde nommé. La réalité du Verbe s’affirme. Le dernier mot, qui appartient à Jean, est : « viens ».
Dans l’essai qu’il vous consacre aux éditions des Vanneaux, Marc Kober remarque combien votre poésie est « hantée par la parole biblique, en particulier par la figure traditionnelle du prophète ».
Marc Kober a montré l’importance de la Bible pour moi. Elle n’est pas une fréquentation assidue, mais on relève dans mes livres les marques constantes de la présence du Récit – et non du « Nouveau » Testament – et la lecture perpétuée de la Genèse et du Pentateuque. Ce n’est pas un hasard si Valère Novarina a illustré la couverture de Vers l’apocalypse. Loin d’être catholique, ma lecture de la prophétie de Jean est hérétique et métissée. Elle se prête à une interprétation constante. Par là, le lecteur entre dans une durée qui dépasse obligatoirement l’histoire littéraire.
La dernière page tournée, on est sidéré de constater combien votre écriture est portée par le pressentiment des catastrophes qui s’abattent sur nos sociétés…
Sans aucune préméditation, ce poème se révèle aussi actuel. Le siècle de dérèglement climatique, d’activité épidémique, de dégradation des démocraties, rencontre les prédictions de Jean, écrites sous le règne de Néron. Il ne faut pas s’en étonner. Une langue juste, la sienne, la mienne, mène juste à l’heure, chacun en son temps. Mais loin de moi une sympathie pour les collapsologues. Je vais même jusqu’à croire au Prendre feu (2) de Bianu et Velter. C’est vous dire les écarts que je pratique ! Par ailleurs, dans mes livres, le mot bonheur brille de sa lumière arcadienne. Je m’unis d’esprit à Henry David Thoreau, sans avoir attendu les écologistes dont j’évite les doctrines.

Une de vos caractéristiques, c’est d’avoir constamment reconsidéré les rapports entre la poésie et les mutations historiques. Êtes-vous un poète de l’histoire et de la politique ?
Je ne suis certes pas un poète de l’Histoire. Mais du temps, pleinement, selon ses moires. Je vis sous la double lumière du régional et du mondial, en constant état de simultanéité. Et je sais que l’histoire économique est traversée par des transcendantaux, et que des raisons peut-être indiscernables la doublent. Je refuse les chapelles intellectuelles, puisqu’au matérialisme marxiste je fais faux bond, sans renier Épicure, Lucrèce et les présocratiques de Nietzsche. Je ne renonce pas à des révélations très réactionnaires en apparence, dans le droit fil d’une pensée gnostique justifiant un univers défectueux. Tout ce que je propose poétiquement provient assurément d’idées trempées au réel meurtrier et d’un style qui a mis des années pour trouver son plein régime, sa difficile et communicative aisance. Le « trouver une langue » de Rimbaud, rabâché éperdument, équivaut non pas à tramer des néologismes et à pratiquer une verboclastie effrénée, mais à œuvrer une syntaxe – ce qu’avait exemplairement compris Mallarmé, nullement hermétique comme on le croit. Comme Francis Ponge, en ce genre de rapports, je crois en la langue française, je l’active, admire la précision d’un Baudelaire ou d’un Leiris.
Les années Change/Tel Quel/TXT ont avancé nombre de propositions. Vous semblez en avoir intégré certaines. Est-ce le cas pour l’intertextualité ?
L’intertextualité, cette notion qui revient à Kristeva, va de soi pour qui écrit à longue distance, en toute connaissance du fonds culturel d’une époque, de sorte que Vers l’apocalypse poursuit et active d’autres textes, outre la prophétie majeure qu’il décalque et déconstruit. Les dix-sept poètes dialoguent entre eux. Le texte admet un emportement amoureux et mystique. Le dernier mot nous fait être homme universellement par le Verbe, malgré la diversité des langues.
À l’inverse, pourquoi revendiquez-vous désormais le « je » et le « beau » ?
Rappeler, à cette occasion, des notions de base comme le Sujet ou le Beau, admises, abandonnées, reconnues de nouveau, ouvrirait sur l’émergence des avant-gardes, leur brève homéostase, leur déclin. Je m’en suis délié depuis longtemps, non sans avoir profité de ce passage quasi initiatique, y avoir acquis ma « distinction ». Ce sont plus de vingt ans de questionnements. Sur le sujet grammatical, le « je » fissuré par l’analyse. Sur la notion de Beau, audacieusement jugée par plusieurs obsolète et dépassée, et le contresens couramment fait à propos du fameux passage de Rimbaud : « J’ai assis la Beauté sur mes genoux et je l’ai injuriée », qui, quelques pages plus loin, aboutit au « Je sais aujourd’hui saluer la beauté ». La beauté n’a pas lieu d’être remise en cause au nom d’un exercice libérateur qui l’effacerait comme un mauvais rêve. Vers l’apocalypse propose, sous les harmoniques d’un poème, de vastes déséquilibres où la langue poétique donne cependant une preuve : celle de l’art possible et menacé. Il assure le trasumanar (3) de Dante.
Propos recueillis par Gérard Noiret
-
Dans 28 ares de vivre, Le Castor Astral, 2019.
-
Gallimard, 2013.
-
« Dépasser l’humain » : Dante, Paradis, ch. 1, v. 70.











