Le centenaire de la mort de Proust a vu se multiplier les publications tout au long de l’année 2022. Un anniversaire peut être l’occasion, pour la postérité d’un auteur ou la vie d’une œuvre, d’un tournant dans la réception. Il semble ici que ce soit le cas, dans la mise en valeur d’un Proust moins monumental, plus intime et familier. Décryptage.
Antoine Compagnon, Proust du côté juif. Gallimard, 426 p., 32 €
Charles Dantzig, Proust Océan. Grasset, 330 p., 23 €
Bertrand Leclair, Le train de Proust. Pauvert, 318 p., 20 €
Marcel Proust, Essais. Édition d’Antoine Compagnon, avec la collaboration de Christophe Pradeau et Matthieu Vernet. Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1 980 p., 75 €
L’un des livres événements de cette année Proust a paru en début d’année. Il s’agit du livre d’Antoine Compagnon, Proust du côté juif, dont rend compte Jean-Yves Potel dans ce même numéro. Commencée dans le petit carré juif de la rue du Repos, au cimetière du Père-Lachaise, l’enquête pleine de rebondissements et de découvertes est à la fois passionnante et très touchante. Elle démontre l’importance d’À la recherche du temps perdu pour les jeunes sionistes des années 1930 (André Spire, Albert Cohen, Georges Cattaui) qui n’en faisaient pas du tout une œuvre antisémite ou anti-juive, comme certains plus tard ont prétendu le décider. En suivant le trajet du petit caillou déposé sur la tombe de ses parents par son grand-père Weil, Antoine Compagnon fournit aussi un document exceptionnel sur la trace des rituels dans l’œuvre et sur la famille maternelle de l’écrivain. Son livre a lancé une « année Proust » marquée également par l’exposition du musée d’Art et d’Histoire du judaïsme, « Marcel Proust du côté de la mère », qui pareillement racontait que l’assimilation n’est pas sans tradition ou sans mémoire et inscrivait dans une histoire commune, à la fois culturelle et intime, des liens étroits avec la famille maternelle dont l’œuvre porte constamment le témoignage, malgré les prestiges de la dissimulation.
Un livre disparaît
C’est donc sous le signe de la famille et du familier que s’est ouverte l’année du centenaire. Il y a bien sûr des livres qui vont dans le sens de la monumentalisation, comme ce Proustographe (1) qui fournit des données quantitatives et factuelles sous forme d’infographies : on y apprend combien il y a de points et de virgules dans la Recherche ; quantité de chiffres ou de cartes sur sa population, ses lieux, ses traductions, ses adjectifs les plus utilisés, nous placent devant l’exceptionnel. Le tout sur papier glacé et en blanc et or. Mais l’objet est curieux, on y recueille des choses intéressantes et on se promène dans le volume avec le plaisir immédiat et bref que donne le quantitatif. Son auteur est le créateur et l’animateur de l’excellent site Proustonomics et il mène toute une campagne pour faire entrer Proust et son frère au Panthéon.

La plupart des parutions mettent plutôt en valeur des marges de l’œuvre-somme, avec notamment un volume d’Essais dans la Pléiade qui remplace en l’augmentant considérablement le volume Contre Sainte-Beuve de 1971 et en avançant, plus que l’écrit programmatique, l’incertitude générique de l’œuvre, le roman tendant vers l’essai et l’essai – qu’on pense au célèbre Sur la lecture, par exemple – vers le roman, ou plus exactement le romanesque. Barthes parlait de « tierce forme » à propos de ces textes qui ne se laissent enfermer dans aucune catégorie, et c’est bien le cas des pastiches de « l’affaire Lemoine », critique créatrice en acte, dans laquelle le récit domine. Contre Sainte-Beuve est un exemple magnifique de cette hésitation consentie. Dans sa première édition de 1954, le livre comportait des chapitres romanesques. Dans la seconde (la Pléiade de 1971), seules étaient retenues les pages critiques. Le volume d’Essais propose un « Dossier du Contre Sainte-Beuve », qui expose certes toutes les étapes tourmentées d’une genèse mais montre aussi l’auteur sauter d’un bord à l’autre de ses projets, les Soixante-quinze feuillets retrouvés à la mort de Bernard de Fallois, et publiés l’année dernière dans l’édition de Nathalie Mauriac-Dyer, ayant été écrits avant la plongée dans le projet critique sur la méthode de Sainte-Beuve et son incipit fameux : « Chaque jour j’attache moins de prix à l’intelligence », qui vaut presque l’autre, encore plus fameux.
Le travail de l’essayiste, qui a fait quantité de lectures et de recherches, est constamment débordé par le narratif et l’ensemble du dossier augmente l’incertitude : certaines pages relèvent-elles encore de l’essai ou bien sont-elles déjà le roman ? En cette année-tournant de 1909, on voit littéralement naître le roman du ventre de l’essai, puis s’en affranchir progressivement ; même si le caractère narratif du projet du Contre Sainte-Beuve est maintenu (conversation avec la mère précédée du récit d’une matinée), et si À la recherche du temps perdu englobe la question de l’essai. Les deux éditeurs précédents, Bernard de Fallois et Pierre Clarac, avaient chacun inventé un texte qui n’existe pas. Le premier avait privilégié la narration et le second la réflexion. L’édition de 2022 donne une version beaucoup plus fragmentée de ce « texte-fantôme ». C’est donc un livre qui disparaît. À la place, un « dossier » de près de 500 pages qui sont les brouillons d’un labeur de près d’une année avant le basculement définitif dans la Recherche. Proust sépare théoriquement l’œuvre de l’auteur avant de se glisser progressivement dans le « je » romanesque. C’est passionnant à voir mais assez perturbant : ôter un livre de l’œuvre est un coup de force important, même si c’est le signe d’une fidélité génétique à l’œuvre inachevée. C’est une forme intéressante de démonumentalisation. Ou bien peut-être l’inverse, par la fidélité absolue à la genèse contre la tradition élaborée ultérieurement.

Y aurait-il eu un Contre Sainte-Beuve définitif et achevé si Proust avait vécu au-delà de 1922 ? Dans un roman contrefactuel, Jérôme Bastianelli, président des Amis de Marcel Proust, musicologue et écrivain, ne répond pas à cette question. Dans Les années retrouvées de Marcel Proust (2), il lui donne vingt ans de vie supplémentaire après qu’il a guéri de la maladie pulmonaire qui l’a, dans le réel, emporté en 1922 et il suit sa vie possible dans le Paris des années 1920 et 1930 puis à New York où il se retrouve exilé en compagnie de Breton et de Saint-Exupéry. On se demande à quoi sert une telle fiction et si on peut en retirer quelque chose. Pourtant, le fait que l’auteur prenne au sérieux la tierce forme proustienne et propose un ouvrage au croisement du roman et de l’essai – et d’un essai extrêmement documenté sur l’époque et la survie des milieux que Marcel fréquentait – le rend à la fois curieux et déstabilisant. Tout est réel et a eu lieu, sauf que le personnage principal n’y était pas. On a le sentiment de vivre une époque avec un fantôme dedans.
Proust quotidien
Un Proust familier, c’est aussi le Proust quotidien. Il y a plusieurs façons de l’approcher. Passer par les lettres n’est pas forcément la plus gratifiante. On sait depuis longtemps que la correspondance de Proust n’est pas celle de Flaubert. On n’y découvre ni l’atelier de l’écriture ni une personnalité hors du commun. Le moi social y domine le moi profond. En 2004, Plon avait publié un choix important de lettres de Proust à partir de la Correspondance générale établie sur plus de vingt ans par Philip Kolb à l’université de l’Illinois et qui comporte 21 volumes. Françoise Leriche propose, toujours chez Plon, une nouvelle édition de ce même ouvrage, augmentée d’inédits retrouvés dans le fonds Kolb de l’université de l’Illinois, de révisions et d’annotations qui tiennent compte de l’avancement des recherches (3).
Malgré des choix drastiques (627 lettres sur les 5 300 de l’édition Kolb – mais Le Proustographe nous apprend que 70 % des lettres manquent à ce massif), l’ensemble n’est pas palpitant et continue de révéler le côté mondain de Proust. Il s’adapte à ses interlocuteurs, ses interlocutrices, il ment, prend des masques. On n’apprend presque rien sur sa vie amoureuse, sur sa pensée du monde comme il va. Il parle parfois de ses préférences politiques, mais on ne sait jamais ce qu’il pense vraiment. Comme l’indique la préface avec un exemple éclairant, la vérité sociale est à géométrie variable. Ainsi, la représentation de Pelléas et Mélisande en février 1911 est pour Proust une véritable commotion esthétique, comme elle l’a été pour beaucoup de ses contemporains. Il en témoigne dans de très nombreuses lettres. Mais, sachant que son ami Reynaldo Hahn n’aimait pas Debussy, il croit bon de dénigrer la pièce lorsqu’il lui écrit. En revanche, dans ce volume, on en apprend beaucoup sur la vie quotidienne de l’écrivain, sur son train de vie, sa domesticité, les restaurants où il dînait (le Café Weber, le Ritz), les hôtels où il allait en vacances, ses déménagements qui sont l’occasion de grands troubles. Le plus frappant et touchant reste l’écho qu’il donne de ses deuils dans sa correspondance, de ses parents et d’Agostinelli. On y sent le poids d’un temps individuel absolument dissocié du temps social, qui est la partition de l’œuvre.
Proust électricien : c’est encore un Proust quotidien, car il a connu un certain nombre de transitions dans ce domaine. Lui qui exalte les transitions entre deux états, entre sommeil et veille comme entre chien et loup, a connu le passage de la bougie à l’éclairage au gaz et du gaz à l’électricité, qui, au début du siècle, a supplanté chez les riches toutes les énergies l’ayant précédée : l’avenue de l’Opéra éclairée de becs électriques, l’hôtel de Mme Verdurin fonctionnant tout entier à l’électricité, « jusqu’aux chambres qui auront leurs lampes électriques avec un abat-jour qui tamisera la lumière. C’est évidemment d’un luxe charmant ». Au début, tout émerveille. Puis le narrateur se met à allumer « machinalement » la lampe, ou d’un air ennuyé, et il s’ouvre au regret des fumées d’autrefois. Mais le livre de la nuit, qui laisse une telle place à la nuit, parle sans arrêt de la lumière, de ses effets, de ses variations et de ses instruments, et l’inventaire proposé par Jean Gury est vraiment éclairant. On regrette un peu que ne soit faite aucune place au personnage récurrent du « wattman » et plus généralement aux foules d’ouvriers anonymes qui peuplent la Recherche. Proust n’est pas électricien, mais il côtoie des électriciens. En faire un éclairagiste, vers la fin du livre, et un personnage qui côtoie les électriciens paraît plus juste que de le considérer lui-même comme un électricien. Comme il l’écrit dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs : « Les électriciens par exemple comptent aujourd’hui dans les rangs de la Chevalerie véritable. » Ou encore, dans Le temps retrouvé : « J’avais assez fréquenté de gens du monde pour savoir que ce sont eux les véritables illettrés, et non les ouvriers électriciens. » Les simples, avec les livreurs, les télégraphistes, les cochers, les fumistes, les grooms, les garçons de café, peuplent la Recherche avec prudence et discrétion mais leur présence est cruciale. Depuis leur représentation sur les bas-reliefs de Saint-André-des-Champs, ils sont une force d’immuabilité mais aussi de remplacement.

Un autre élargissement des marges peut venir de l’étranger. L’anthologie Proust-Monde, réalisée par Blanche Cerquiglini pour la collection « Folio-Classique », rassemble quatre-vingt-trois textes d’auteurs étrangers qui ont lu Proust, en français ou en traduction (5) ; parfois même en le traduisant, comme c’est le cas de Walter Benjamin en allemand, de Natalia Ginzburg en italien ou de Guy Régis Jr en créole. Certains de ses textes étaient connus (les lectures de Nabokov, de Woolf et de Beckett), mais il y a aussi de véritables découvertes, avec vingt textes traduits pour la première fois en français : de Vargas Llosa, d’Edmund Wilson, d’Alejo Carpentier et de bien d’autres. L’avant-propos précise que l’idée de l’anthologie est née de la redécouverte d’un texte de Stefan Zweig, publié en 1925, intitulé « La tragique destinée de Marcel Proust », et proposé ici dans une traduction inédite. Il est vrai que ce texte est d’une extraordinaire vivacité. Il fait revivre (et mourir) Proust sous nos yeux, en lui prêtant des traits qu’il a lui-même prêtés à certains de ses personnages. Il met bien en scène un Proust familier, introduit au plus près de nos vies.
Les images du temps
Parmi les publications de l’automne, trois très bons livres retiennent l’attention. Le premier, Proust et le temps, est issu d’un programme de recherche scientifique, ProusTime, qui a réuni des spécialistes de littérature, des physiciens, des neurobiologistes, des linguistes, afin de confronter des conceptions du temps proposées par différents domaines scientifiques et artistiques (6). Dirigé par Isabelle Serça, connue pour ses importants travaux sur Proust (sur la phrase et sur la ponctuation notamment), le volume est passionnant. Confiante dans les enjeux cognitifs de la littérature, elle a soumis à ses compagnons de travail des figures ou des images du temps afin d’en faire des modèles ou de les confronter à des modèles proposés par la science : ainsi de l’image de la partition musicale, que l’on retrouve chez Alain Connes, théoricien de la « géométrie non commutative », ou chez le physicien Étienne Klein ; ainsi du terme de « traces » – ces « traces persistantes du passé » qui retiennent l’attention du Narrateur –, examiné dans ses usages en astrophysique, en neurologie, en histoire et en médecine. Le livre prend la forme d’un dictionnaire et rassemble des notices parfois écrites en collaboration. On apprend beaucoup des textes du physicien François Charru (« Irréversibilité », par exemple, « Linéarité », « Causalité »), d’Alain Connes (sur l’image du Tore ou de la pelote de laine), mais tout autant des ex-cursus artistiques proposés par Gérard Tiné. L’entrée « Ellipse », écrite par Maylis de Kerangal sous forme de petite fiction théorique, est très belle. Bref, c’est un livre sur Proust, mais c’est aussi une réflexion sur le temps d’une grande générosité, animée d’un réel souci de dialogue et de transmission.
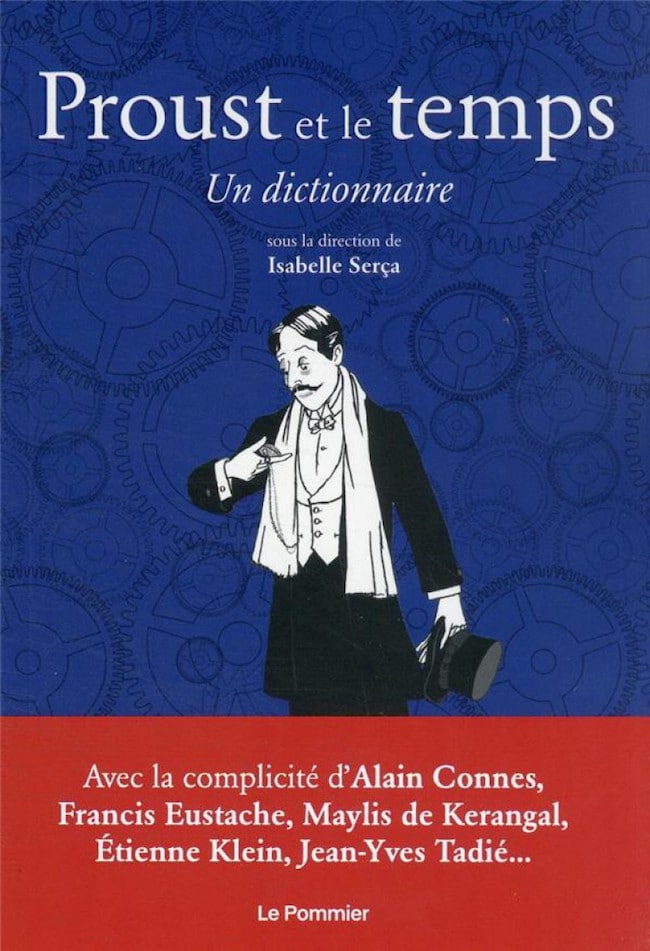
Mais terminons sur deux textes d’écrivains qui ont fait de la Recherche le livre de leur vie. Le premier, Le train de Proust, repose sur une idée géniale, qu’on aimerait avoir eue : celle de faire du train la figure du temps retrouvé mais aussi de l’expérience de la lecture. Combien de scènes décisives du roman ont lieu dans un train, que ce soit dans le « petit train d’intérêt local » qui dessert Balbec, le train de Venise, ou encore, dans Le temps retrouvé, le train qui ramène le Narrateur à Paris après un long séjour dans une maison de repos et où il décide de renoncer à la littérature. « C’est dans le train que le même narrateur, à la fin du sixième et avant-dernier volume (Albertine disparue) apprend que Gilberte Swann s’apprête à épouser Robert de Saint-Loup, entraînant la confusion irrémédiable des côtés de chez Swann et de Guermantes dont l’opposition structurait sa mémoire. »
Proust a vécu l’âge d’or du chemin de fer (dès la fin des années 1920, de petites gares de campagne, non rentables, commencent à fermer). Le train rapproche et il égalise. Le paysage mis en mouvement par le train se charge des interférences de l’espace sur le temps. Bertrand Leclair repère ce qu’il appelle « le principe du nœud ferroviaire de la narration proustienne » dans ces scènes d’arrêt du train dans des gares de triage où se nouent alors tous les fils du récit (la jalousie, la création, la mort, le passé…), leurs possibles et leurs correspondances. Il pose aussi la question de la destination du train de Proust, entendu cette fois comme le voyage de l’écriture elle-même, horizon qui ne peut pas se figer en un point du temps et de l’espace. Proust reconnaissait que la qualité du style de Flaubert était de donner l’impression du temps. Et il comparait ses pages à un « grand Trottoir roulant », qui vous embarque, comme le train de Proust. Mais le train de Proust est encore la métaphore d’autre chose : celle du voyage que l’on entreprend lorsqu’on le lit et qu’on le relit.
Ainsi le livre de Bertrand Leclair est-il loin d’être un simple inventaire des « scènes de chemin de fer » dans À la recherche du temps perdu. Il est une traversée de l’ensemble de l’œuvre et une lecture profondément compréhensive sous l’impulsion d’un motif proustien : le changeant, le relatif, le mobile. Il est aussi un livre d’amour, sur l’amour en général et sur l’amour d’un livre et le voyage en perpétuelle mutation qu’il nous propose. La deuxième partie porte ainsi sur la première lecture et sur les relectures, les sentiments d’aujourd’hui superposés à ceux d’autrefois, le sens nouveau pris par certaines scènes dans l’actualité présente (les remarques antisémites de certains personnages, par exemple). On ne peut pas résister à cet enthousiasme informé, qui partage avec nous la joie d’avoir toujours ce livre « en train ».
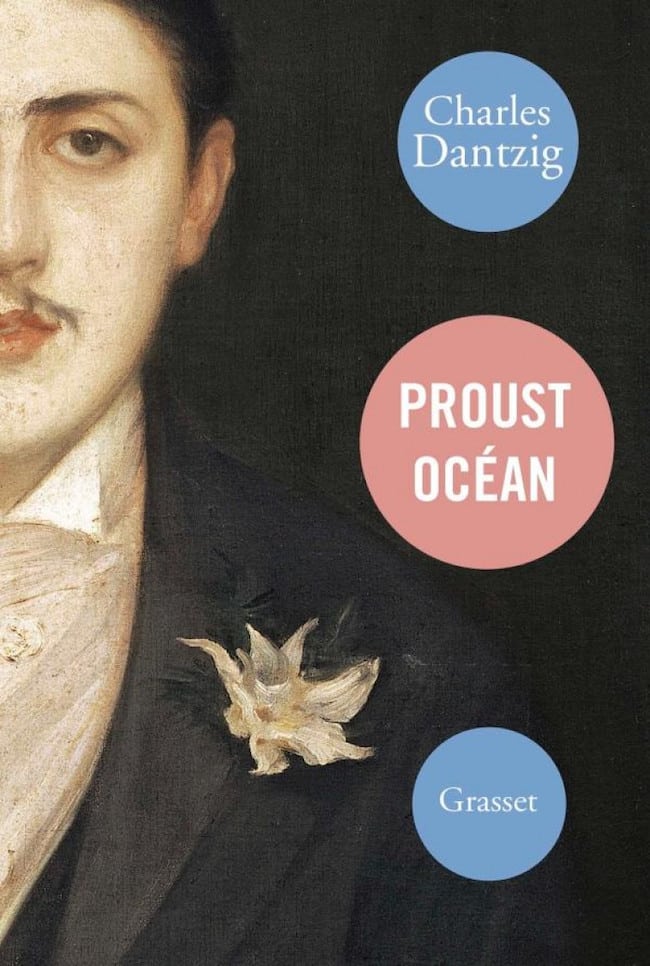
Le deuxième écrivain est lui aussi un grand lecteur et il donne à Proust une autre métaphore. Proust Océan de Charles Dantzig invite à lire À la recherche du temps perdu comme on traverse un océan, au rythme de son tressaillement lent, de son opacité aussi. « Et c’est très facile, écrit-il, il suffit d’adapter sa respiration ». Il fait du Narrateur un grand poulpe, hypersensible et très intelligent, dont les tentacules nous enserrent. Les métaphores aquatiques, dont la plus célèbre est celle de l’aquarium formé par la salle à manger de l’hôtel de Balbec devant laquelle se presse la population ouvrière de la ville, transforment tout le personnel de la Recherche en poisson. L’image de l’océan marche aussi bien que celle du train et ce livre est vraiment très beau. C’est que Dantzig a aussi fait du roman de Proust un livre-vie, qu’il le connaît parfaitement et sait le faire partager. Il est à la fois très drôle, lorsqu’il reprend l’auteur sur ses naïvetés et ses bévues (en particulier en voulant nous faire croire à un narrateur « straight », ou avec un certain nombre de scènes vues du placard), et très mélancolique, dans des pages magnifiques sur la souffrance amoureuse.
Dantzig devient tour à tour l’auteur et le Narrateur, jouant à cache-cache avec ce qu’il est et ce qu’il veut être. Il s’en défend, mais il parle aussi de lui. « Ne lisant pas pour moi-même, j’ai peu appris sur ma personne dans À la recherche du temps perdu. Quand c’est arrivé cela a été par surprise et à mon chagrin : ces moments où le Narrateur expose les souffrances qu’il se crée avec des amours irréalisables et auxquelles moi non plus je n’ai jamais su renoncer. Des moments d’imbécillité, en somme. » Dantzig accorde du prix à l’intelligence, et il montre au fond que Proust aussi. Dans sa façon de faire vivre les personnages, de mettre au jour comme personne la rivalité entre l’auteur et le narrateur, d’écrire en situation, il dévoile la force de l’œuvre : elle est la vie même et on a le devoir de la raconter. Écrire sur Proust, c’est écrire la vraie vie.
-
Nicolas Ragonneau, Le Proustographe. Proust et À la recherche du temps perdu en infographies. Denoël, 192 p., 24 €.
-
Jérôme Bastianelli, Les années retrouvées de Marcel Proust. Essai de biographie. Sorbonne Université Presses, coll. « Essais », 258 p., 8,90 €.
-
Marcel Proust, Lettres (1879-1922). Édition de Françoise Leriche. Plon, 1 355 p., 39 €.
-
Christian Gury, Proust électricien. Non Lieu, 240 p., 16 €.
-
Proust-Monde. Quand les écrivains étrangers lisent Proust. Textes choisis et commentés par Blanche Cerquiglini, Antoine Ginésy, Étienne Sauthier, Guillaume Lefer et Nicolas Bailly. Gallimard, coll. « Folio classique », 590 p., 10,60 €.
-
Proust et le temps. Un dictionnaire, sous la direction d’Isabelle Serça, Le Pommier, 295 p., 22 €.



![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)








