L’épistémologie peut être conçue comme une discipline qui se place entre logique et psychologie, pour une conception métaphysique réaliste en continuité avec les sciences. C’est l’approche de Charles S. Peirce, comme le montre bien Jean-Marie Chevalier dans un livre qui accompagne le lecteur sur le chemin philosophique complexe du père du pragmatisme
Jean-Marie Chevalier, Peirce ou l’invention de l’épistémologie. Vrin, 312 p., 29 €
Peirce est un auteur difficile. Sa terminologie est souvent idiosyncrasique, ses écrits sont dispersés, ses distinctions sont subtiles. L’architecture théorique à laquelle il a sans cesse travaillé, surtout à propos de notre « pensée-signe » (1), ne se laisse pas facilement reconstruire. Logique et mathématiques, phénoménologie, sémiotique, philosophie critique, grammaire spéculative, théorie de la méthode et des sciences normatives sont quelques-uns des angles sous lesquels il a essayé de formuler un système rationnel du monde.
Ce livre de Jean-Marie Chevalier permet d’aborder Peirce de manière claire et systématique. L’épistémologie, discipline se situant entre logique et psychologie, est au cœur du discours. L’intérêt de Peirce pour la psychologie est ancien, et « si celle-ci n’est d’aucune utilité positive pour la logique formelle, l’étude des faits psychologiques vise vraisemblablement à l’élaboration de ce qui deviendra un troisième domaine entre psychologie et logique, l’épistémologie ».
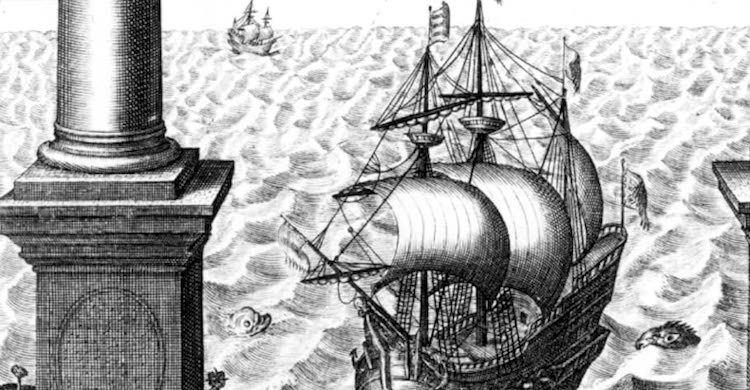
© Vrin
Le fil directeur de Peirce est la question « comment pouvons-nous connaître ? », une question à la fois transcendantale et empirique, « qui interroge cette extraordinaire capacité que nous avons de savoir, et demande aussi comment nous pourrions connaître plus et mieux ». Chevalier divise la réflexion de Peirce en quatre phases : « La recherche d’une méthode (1857-1867) », « L’enquête en théorie et en pratique (1868-1884) », « Lois de la nature et lois de l’esprit (1884-1902) », « Pragmaticisme et sciences normatives (1902-1914) ». Bien plus qu’un pragmatisme anthropologique ou sociologique, comme on le pense souvent aujourd’hui.
Le livre traite des questions centrales de la philosophie de Peirce : la méthode transcendantale et les catégories de la métaphysique, le syllogisme et la sémiotique, les lois algébriques de la pensée, l’inférence et la théorie de l’enquête, la nature de l’esprit et de l’univers, les sources de la normativité, le pragmatisme comme méthode de clarification, le pouvoir analytique et cognitif des diagrammes, le réalisme des universaux.
D’un côté, il y a la logique. Pour Peirce, elle sert à fournir une méthode de connaissance. Cela ne se limite pas à la déduction. Alors que les mathématiques utilisent notamment la déduction, les sciences empiriques se servent surtout d’hypothèses et d’inductions, et de toute façon, comme le montre la théorie de la méthode scientifique, toute entreprise scientifique nécessite une triade inférentielle : par abduction on formule des hypothèses ; par déduction on tire leurs conséquences ; et par induction on teste ces conséquences.
Peirce explore aussi les implications morales de ces questions de méthode, à partir du principe social de l’enquête (la science exige une communauté de chercheurs) et du « principe social de la logique ». Dans son article de 1878 « The Doctrine of Chances », il soutient que la logique a un principe social : pour raisonner correctement, les individus doivent assumer le point de vue de la communauté illimitée des hommes. Il fait découler de cela un argument moral sur la délibération pratique : pour décider et agir correctement, les individus ne doivent pas être égoïstes. Ces idées ont été discutées par Hilary Putnam et bien d’autres (2). Un point de départ est la théorie fréquentiste de la probabilité, avec le problème du choix dans les cas singuliers. Pourquoi choisir X sachant que la probabilité de succès est plus grande pour X que pour Y ? Et pourquoi souligner que le choix de X était rationnel même quand, dans un cas singulier, X échoue ? Selon Peirce, on opère un transfert psychologique de soi à la communauté, de manière que, si la communauté agit conformément aux probabilités, alors elle connaîtra plus de succès que d’échecs. Peirce en tire la thèse du principe social de la logique : pour exercer une pensée véritablement logique, il faut prendre en compte la perspective de la communauté. Ce qui reste plus incertain, cependant, est la conséquence morale de l’argument, puisqu’un égoïste peut bien utiliser pour son utilité personnelle les probabilités calculées selon la perspective de la communauté. Cela n’implique pas que nous devions être égoïstes : c’est simplement, à mon avis, que l’argument contre l’égoïsme ne s’ensuit pas du seul argument du principe social de la logique.
De l’autre côté, nos inférences reposent sur la tendance à acquérir des habitudes, ou l’habitude d’adopter des habitudes. C’est une question psychologique, c’est le domaine de la science naturelle, qui à l’époque était marquée par le débat sur l’évolutionnisme et ses conceptions. Peirce voyait une croissance progressive de la rationalité dans le monde, et le mental comme domaine de l’action finalisée. Cela l’amène à réfléchir sur les sciences normatives, qui portent sur l’excellence esthétique, éthique et logique. Comme le dit Chevalier, ces sciences « s’efforcent de formuler les conditions sous lesquelles un objet possède cette excellence (sans statuer sur la vertu de tel ou tel objet particulier) : pour l’esthétique, les conditions de l’excellence des objets dans leur présentation, indépendamment de toute autre chose ; pour l’éthique, celles de l’excellence de l’action volontaire dans sa relation à son but ; pour la logique, celles de l’excellence des signes considérés comme représentations du réel, c’est-à-dire de la vérité ».

Charles Sanders Peirce (vers 1870)
Le débat sur les sciences normatives venait de la philosophie allemande du XIXe siècle ; Frege, Husserl, Peirce et Ramsey y participent (3). Aujourd’hui, on peut distinguer deux problèmes que cette discussion classique n’a pas toujours séparés : (A) le statut des sciences normatives ; (B) la nature de la normativité dont ces sciences s’occupent. Sur (A) : les énoncés de ces sciences sont-ils des propositions sur des normes ou bien eux-mêmes des normes ? Sur (B) : est-ce que cette normativité se définit en termes irréductiblement déontiques ou plutôt en termes naturels ?
L’intérêt de la tentative de Ramsey – dans son livre posthume sur la vérité (4) – réside dans l’idée d’articuler une théorie instrumentale de la normativité compatible avec une forme de naturalisme d’une part et avec le but critique des sciences normatives de l’autre. Ce qui ne va pas sans difficultés : premièrement, peut-on réellement définir la normativité en termes de relations entre fins et moyens ? Si je dis que M doit être en fonction de F, je ne donne pas une définition du « devoir être » ; deuxièmement, peut-on rendre compte de toute norme en termes de relations entre fins et moyens et de rationalité instrumentale ? Il y a des normes, semble-t-il, qui résistent à ce traitement ; troisièmement, une conception instrumentale de la normativité, pour certains types de normes au moins, entraine-t-elle leur naturalisation ? On pourrait objecter que les valeurs qui constituent les buts de l’esthétique, de l’éthique et de la logique (le beau, le bien et le vrai) ne sont pas naturalisables.
Dans les mêmes années de la réflexion sur les sciences normatives, Peirce présente son « pragmaticisme » (pour le distinguer du pragmatisme nominaliste et utilitariste qui devenait à la mode) comme une méthode de clarification logique qui se concentre sur les conséquences de la pensée pour la conduite, étant donné que « la signification d’une proposition est l’ensemble de ses conséquences pratiques ». Ainsi, « le pragmaticisme voit dans l’habitude la clef de la signification et du comportement des êtres et des choses en général ».
Cela renvoie encore une fois au rapport entre logique et psychologie : Peirce, montre Chevalier, « a contribué à la violente expulsion de tous les relents de psychologie hors des études logiques » et pourtant sa philosophie a été marquée par une phase nettement naturaliste et par ses études sur l’inférence comme habitude ou disposition mentale. Entre norme et nature, il y a un espace où se développe la connaissance. Chevalier montre ainsi que Peirce reste un philosophe à la fois kantien et naturaliste – ce qui rend sa réflexion aussi problématique que féconde. Et surtout, cela montre que chez Peirce la connaissance et l’épistémologie ont pour but de nous conduire à une véritable métaphysique formulée a posteriori, c’est-à-dire prenant en compte ce que l’expérience et les sciences nous disent sur le monde. C’est bien plus qu’une philosophie des pratiques sociales.
-
Claudine Tiercelin, La pensée-signe, Jacqueline Chambon, 1993.
-
Cf. Hilary Putnam, The Many Faces of Realism, La Salle, Open Court, 1987, p. 80-86 ; et Claudine Tiercelin, Le doute en question, L’Éclat, 2016, p. 173-174.
-
Cf. Giovanni Tuzet, La pratica dei valori. Nodi fra conoscenza e azione, Macerata, Quodlibet, 2012, chap. 3.
-
Frank Plumpton Ramsey, On Truth (1927-1929), Dordrecht, Kluwer.












