 La noirceur de Forough Farrokhzâd, le sens des formes d’Hervé Martin, les gestes d’Angèle Paoli, la nature de Fabienne Raphoz et une ballade mélancolique de Grégory Rateau : cinq recueils figurent au programme du septième épisode de notre chronique coordonnée par Gérard Noiret.
La noirceur de Forough Farrokhzâd, le sens des formes d’Hervé Martin, les gestes d’Angèle Paoli, la nature de Fabienne Raphoz et une ballade mélancolique de Grégory Rateau : cinq recueils figurent au programme du septième épisode de notre chronique coordonnée par Gérard Noiret.
Forough Farrokhzâd, Une autre naissance. Trad. du persan par Laura Tirandaz et Ardeschir Tirandaz. Héros-Limite, 120 p., 18 €
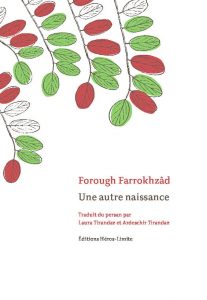 « Le visage est le refuge des yeux pourchassés », écrivait Edmond Jabès. Celui, si poétique, de Forough Farrokhzâd (1934-1967), tel que déployé dans ses souvenirs et toutes ses larmes, nous semble bien être cet asile aux cœurs transis et aux exilées de toutes sortes, cette maison ouverte aux quatre vents qui recueille les égarées comme les proscrits. Le désir en ses saisons y siège en maître versatile autant qu’exigeant. Une autre naissance (recueil paru en 1964 et traduit ici aux éditions Héros-Limite par Laura et Ardeschir Tirandaz) possède les rides délicates d’une sagesse déjà évidente et la sensibilité à fleur de peau d’une amante, d’une irréductible et, plus que tout, d’une passionnée. Chaque fois que ses lèvres s’ouvrent (« souffles d’une fleur en soie »), elles bravent la mort, toutes les morts, qu’elles soient d’abandon ou de lâcheté, d’une heure ou de quelques secondes. Il y a chez Forough Farrokhzâd, tout au bout de la noirceur et du trouble, « une petite fée triste / Qui meurt le soir d’un baiser / Et à l’aube renaît d’un baiser ». Louis Pailloux
« Le visage est le refuge des yeux pourchassés », écrivait Edmond Jabès. Celui, si poétique, de Forough Farrokhzâd (1934-1967), tel que déployé dans ses souvenirs et toutes ses larmes, nous semble bien être cet asile aux cœurs transis et aux exilées de toutes sortes, cette maison ouverte aux quatre vents qui recueille les égarées comme les proscrits. Le désir en ses saisons y siège en maître versatile autant qu’exigeant. Une autre naissance (recueil paru en 1964 et traduit ici aux éditions Héros-Limite par Laura et Ardeschir Tirandaz) possède les rides délicates d’une sagesse déjà évidente et la sensibilité à fleur de peau d’une amante, d’une irréductible et, plus que tout, d’une passionnée. Chaque fois que ses lèvres s’ouvrent (« souffles d’une fleur en soie »), elles bravent la mort, toutes les morts, qu’elles soient d’abandon ou de lâcheté, d’une heure ou de quelques secondes. Il y a chez Forough Farrokhzâd, tout au bout de la noirceur et du trouble, « une petite fée triste / Qui meurt le soir d’un baiser / Et à l’aube renaît d’un baiser ». Louis Pailloux
Hervé Martin, Sous l’odeur des troènes. Unicité, 168 p., 16 €
 On sait Hervé Martin intéressé par la forme du poème, on le voit à l’œuvre dans ce livre découpé en trois parties qui se clôt sur le beau « À la clarté de l’ombre ». Les poèmes disent le quotidien, proposent une vision humaniste enchâssée dans une expérience de transformation de l’écriture. Une citation de Maurice Regnaut dans « Cette présence en nous », une adresse aux parents, éclaire la logique du livre. Une liste de prénoms, de titres de poèmes, précède ceux consacrés au commerce ambulant de proximité. Les silences et les coupes disent l’intérêt pour Lionel Ray, rythment les vers à la manière des cadences imposées par le travail. « Coffreurs », « Plâtriers » mais aussi « Cueilleurs » et « Jardiniers » contiennent le dur labeur. Il y a intervention sur la langue, découpe et agencement dans la page au risque d’un harassement. Le découpage se réduit avec « Trémulations ». La lecture s’apaise, finit en eau calme visuelle avec « Ce qui ne revient plus ». On est dans une littérature qui mise sur de nouvelles formes. Catherine Champolion
On sait Hervé Martin intéressé par la forme du poème, on le voit à l’œuvre dans ce livre découpé en trois parties qui se clôt sur le beau « À la clarté de l’ombre ». Les poèmes disent le quotidien, proposent une vision humaniste enchâssée dans une expérience de transformation de l’écriture. Une citation de Maurice Regnaut dans « Cette présence en nous », une adresse aux parents, éclaire la logique du livre. Une liste de prénoms, de titres de poèmes, précède ceux consacrés au commerce ambulant de proximité. Les silences et les coupes disent l’intérêt pour Lionel Ray, rythment les vers à la manière des cadences imposées par le travail. « Coffreurs », « Plâtriers » mais aussi « Cueilleurs » et « Jardiniers » contiennent le dur labeur. Il y a intervention sur la langue, découpe et agencement dans la page au risque d’un harassement. Le découpage se réduit avec « Trémulations ». La lecture s’apaise, finit en eau calme visuelle avec « Ce qui ne revient plus ». On est dans une littérature qui mise sur de nouvelles formes. Catherine Champolion
Angèle Paoli, Le dernier rêve de Patinir. Henry, 128 p., 10 €
 Peut-on écrire comme d’autres peignent ? Ce recueil inciterait à penser que oui. « Le peintre élague. Efface et gomme. » Ses gestes seraient donc ceux du poète, et tous deux ont le pouvoir de réveiller nos imaginaires. D’emblée, on pressent une émotion esthétique rare, qui mène du désert à l’Égypte, au Styx, et autre torrent impétueux, avec Jérôme, Christophe, Joseph, la figure des ermites, leurs grimoires à la « lumière perdue ». On réapprend le langage ancien et la lumière est bien là, elle « fait cligner des yeux ». On lit le cœur battant, avec l’impression d’un agréable vertige. On s’approprie le musée, une histoire de l’art mise à notre portée. On descend avec Patinir au cœur du rêve. Un recueil puissant, impactant le cœur et les sens. Sans doute avons-nous « encore beaucoup à apprendre / du dialogue avec le silence ». C’est tout le paradoxe de ce livre bruissant qui nous renvoie à la solitude des peintres et des poètes. Marie-Pierre Stévant-Lautier
Peut-on écrire comme d’autres peignent ? Ce recueil inciterait à penser que oui. « Le peintre élague. Efface et gomme. » Ses gestes seraient donc ceux du poète, et tous deux ont le pouvoir de réveiller nos imaginaires. D’emblée, on pressent une émotion esthétique rare, qui mène du désert à l’Égypte, au Styx, et autre torrent impétueux, avec Jérôme, Christophe, Joseph, la figure des ermites, leurs grimoires à la « lumière perdue ». On réapprend le langage ancien et la lumière est bien là, elle « fait cligner des yeux ». On lit le cœur battant, avec l’impression d’un agréable vertige. On s’approprie le musée, une histoire de l’art mise à notre portée. On descend avec Patinir au cœur du rêve. Un recueil puissant, impactant le cœur et les sens. Sans doute avons-nous « encore beaucoup à apprendre / du dialogue avec le silence ». C’est tout le paradoxe de ce livre bruissant qui nous renvoie à la solitude des peintres et des poètes. Marie-Pierre Stévant-Lautier
Fabienne Raphoz, Ce qui reste de nous. Héros-limite, 96 p., 16 €
 On ne sait si les longs blancs entre certains mots sont la trace d’un silence ou d’une absence à venir, ou alors un exercice de respiration, ou bien le constat d’une disparition, ou encore une pause entre deux regards posés, ici sur un pic épeiche de passage, là sur un grand corbeau. Ce qui reste de nous hésite entre le temps d’avant, celui où les animaux de toutes sortes avaient droit de cité, et le temps d’après, où les insectes, les empereurs, et autres crapauds épineux ne seront plus que cités ; entre un phrasé vif, vivant, et un texte savant ; une émotion et une notation : « ce vrombissement dans un jasmin ». Jardin et champ, mare et mer, forêt et chênaie, l’espace est comme la page blanche, si mince et tellement immense, prête à recueillir la nature qui parle, avant que ne tombent le jour, la nuit, la vie : « se presser d’aimer (c’est le présent) ». Alors on revoit un « thylacine éteint », on croise « le regard roux du renard », on suit l’alouette « dans le ciel familier », on entend la fauvette, au loin. Trop loin ? « jusqu’à / quand / fauvette / vas-tu / tenir / le chant / haut ? ». Roger-Yves Roche
On ne sait si les longs blancs entre certains mots sont la trace d’un silence ou d’une absence à venir, ou alors un exercice de respiration, ou bien le constat d’une disparition, ou encore une pause entre deux regards posés, ici sur un pic épeiche de passage, là sur un grand corbeau. Ce qui reste de nous hésite entre le temps d’avant, celui où les animaux de toutes sortes avaient droit de cité, et le temps d’après, où les insectes, les empereurs, et autres crapauds épineux ne seront plus que cités ; entre un phrasé vif, vivant, et un texte savant ; une émotion et une notation : « ce vrombissement dans un jasmin ». Jardin et champ, mare et mer, forêt et chênaie, l’espace est comme la page blanche, si mince et tellement immense, prête à recueillir la nature qui parle, avant que ne tombent le jour, la nuit, la vie : « se presser d’aimer (c’est le présent) ». Alors on revoit un « thylacine éteint », on croise « le regard roux du renard », on suit l’alouette « dans le ciel familier », on entend la fauvette, au loin. Trop loin ? « jusqu’à / quand / fauvette / vas-tu / tenir / le chant / haut ? ». Roger-Yves Roche
Grégory Rateau, Conspiration du réel. Unicité, 82 p., 13 €
 Grégory Rateau est constamment à l’affût. Depuis les coulisses, tel un cinéaste, ses yeux captent tout du réel, là où il se trouve. Et il tente de l’exprimer de la manière la plus simple, « calligraphiant dans l’urgence ». Ce qu’il cherche, c’est « le lieu et la formule », comme l’écrivait Rimbaud, qu’il admire. On est en présence d’une poésie existentielle et à vif, captée au fil d’une longue errance qui l’entraîne de sa banlieue parisienne natale vers l’Irlande, le Liban et la Roumanie où il réside aujourd’hui. Ce qui intéresse « ce fou furieux de l’inconnu », ce sont les tavernes des vieux ports, « des guetteurs cheminant le long des quais », les bas-fonds, les endroits perdus de la campagne et des villes, avec ces personnages du quotidien, pourtant singuliers, dont il dresse le portrait. Il peut tout aussi bien faire appel au présent, dans ce réel immédiat dont il faut déjouer les complots, qu’au passé, tous ces souvenirs où « l’enfance surgit dans un contre-jour ». Le livre est une ballade mélancolique, avec en sourdine quelque chose de la musique tzigane. Alain Roussel
Grégory Rateau est constamment à l’affût. Depuis les coulisses, tel un cinéaste, ses yeux captent tout du réel, là où il se trouve. Et il tente de l’exprimer de la manière la plus simple, « calligraphiant dans l’urgence ». Ce qu’il cherche, c’est « le lieu et la formule », comme l’écrivait Rimbaud, qu’il admire. On est en présence d’une poésie existentielle et à vif, captée au fil d’une longue errance qui l’entraîne de sa banlieue parisienne natale vers l’Irlande, le Liban et la Roumanie où il réside aujourd’hui. Ce qui intéresse « ce fou furieux de l’inconnu », ce sont les tavernes des vieux ports, « des guetteurs cheminant le long des quais », les bas-fonds, les endroits perdus de la campagne et des villes, avec ces personnages du quotidien, pourtant singuliers, dont il dresse le portrait. Il peut tout aussi bien faire appel au présent, dans ce réel immédiat dont il faut déjouer les complots, qu’au passé, tous ces souvenirs où « l’enfance surgit dans un contre-jour ». Le livre est une ballade mélancolique, avec en sourdine quelque chose de la musique tzigane. Alain Roussel











