« Impuissance », c’est le mot clé du dernier livre de l’historien médiéviste Gabriel Martinez-Gros, La traîne des empires. En s’inspirant d’Ibn Khaldûn, ce spécialiste de l’histoire de l’islam propose une réflexion sur la façon dont les religions succèdent aux empires lorsqu’ils deviennent « impuissants ».
Gabriel Martinez-Gros, La traîne des empires. Impuissance et religions. Passés composés, 240 p., 21 €
Alors que nous pensions que s’approfondissait le sens de l’unité du genre humain (au-delà des caractéristiques anthropologiques physiques), de l’infinité de la personne (au-delà du citoyen et des droits de l’homme eux-mêmes), et de l’unicité de la terre (lieu unique de l’aventure humaine), alors que nous étions certains que nous avions enfin touché quelque chose de vraiment commun, au-delà de la « réalité » créée par l’effectivité de la technoscience liée au régime capitaliste de production, voilà que tout se disloque à nouveau. Nous étions pourtant arrivés au point de réhabiliter une notion d’empire préalablement repensée, en rupture avec des modèles séculaires de domination, comme un moyen de parvenir à une globalisation pacificatrice et émancipatrice. Mais voilà que resurgissent des velléités impériales régressives (chacune avec ses origines et ses objectifs), prises dans le jeu infantile du « c’est à moi, c’est mon tour, maintenant », réduisant à l’impuissance les institutions qu’une conscience nouvelle du destin de l’humanité s’était données, un jeu qui nous entraîne dans la spirale sans fin de la rivalité et de la concurrence.
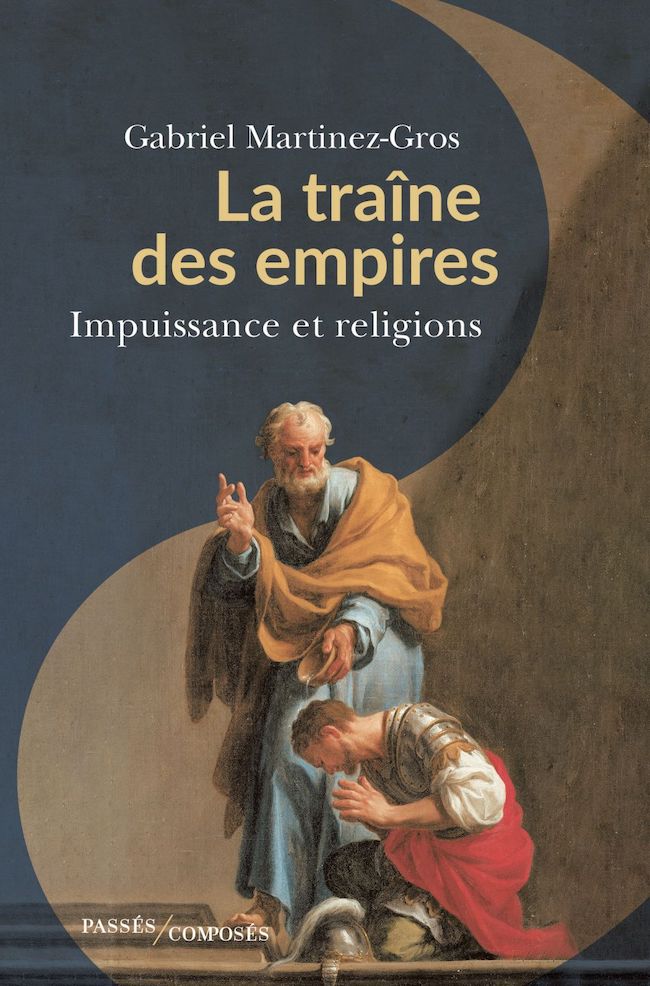
Depuis longtemps, à l’instar de certains philosophes, Gabriel Martinez-Gros s’intéresse à la notion d’empire. En 2014, il publiait au Seuil un essai intitulé Brève histoire des empires. Il s’agissait d’expliquer, à la lumière de la pensée du grand Ibn Khaldûn (1332-1406), la naissance des empires et leur chute. Il y déployait une philosophie de l’histoire inspirée par celui qu’il considère comme le seul philosophe non européen de l’histoire. C’est encore le penseur tunisois qui inspire l’historien dans cet essai destiné avant tout à discerner notre situation actuelle à la lumière du cycle de la vie des empires défini par Ibn Khaldûn. À la dialectique entre sédentaire et « bédouin », par laquelle l’auteur de la Muqaddima (Introduction à l’histoire universelle, 1377) expliquait la naissance des empires à la suite des conquêtes des tribus guerrières, et leur chute après sédentarisation et désarmement, les livrant de nouveau aux attaques des barbares, Gabriel Martinez-Gros ajoute une réflexion sur le « lien généalogique » entre empire et religion.
Pour lui, les grandes religions dominantes d’aujourd’hui (christianisme, bouddhisme et islam) sont toutes des « créations d’empire » ou plutôt « de fins d’empires, de traînes d’empires ». Elles naissent quand le pouvoir n’est plus assez fort pour maintenir l’ordre sédentaire, elles en sont les substituts et il est facile d’en déduire les caractéristiques à partir de celles de leur matrice commune. En reprenant les catégories d’Ibn Khaldûn, l’historien tente de montrer qu’après l’empire vient la religion qui maintient la « dualité du sédentaire et du bédouin » en assurant le pouvoir du premier et en rejetant le second dans la violence. Mais surtout la religion « consacre la dissociation de l’action politique et des valeurs humaines » ; par l’universalisme abstrait de leurs valeurs et l’espérance d’un salut hors du monde, elles « transforment l’impuissance historique de l’empire en impuissance ontologique ».
C’est certainement la situation contemporaine qui a poussé l’historien à reprendre cette énième version de la religion comme idéologie. Le paradoxe contemporain semble total : d’un côté, les régressions auxquelles nous assistons ont un point commun, l’instrumentalisation de la religion à des fins impériales. C’est vrai de la Chine, de l’Inde, de la Russie, de la Turquie, de l’État islamique… Dans le même temps, le néo-empire d’Occident en perte de vitesse laisse derrière lui une nouvelle religion, un nouvel universalisme tiers-mondiste, antiraciste et écolo-jeuniste, amplifiant son impuissance à maintenir sa domination.

« Le Couronnement de Charlemagne » de Henri Léopold Lévy (1878-1883), conservé au Panthéon (détail) © Hervé Lewandowski / Centre des monuments nationaux
Mais si l’on peut saluer l’effort de compréhension du moment présent rapporté à l’échelle d’une histoire longue, doit-on partager l’analyse ? Entre empire et religion, la relation est complexe. D’abord parce qu’il existe plusieurs modalités d’empire et plusieurs échelles. Administrative : l’empire des Habsbourg n’est pas l’empire romain ; culturelle : la domination mondiale de la technoscience de provenance européenne est une forme d’empire ; économique : la souveraineté du dollar et celle du « marché » exercent bien un pouvoir impérial. À l’intérieur de ces différentes modalités, différentes « religions » jouent différemment leur partie. Il existe ainsi dans l’histoire du christianisme des formalités différentes selon les époques, de l’opposition frontale à l’empire à sa reconnaissance comme « évêque du dehors », en passant par la recherche de l’équilibre, toujours impossible, entre le prophète, le prêtre et le roi – sans oublier les compromissions les plus honteuses. Il ne sert de rien d’écraser, bien que l’auteur s’en défende, dans une « machinerie » (pour parler comme le regretté Paul Veyne) dialectique, élevée au rang de moteur de l’histoire enfin découvert, les variations interprétatives et pratiques des deux apophtegmes toujours décisifs : « rendez à César ce qui est à César » et « mon Royaume n’est pas de ce monde ».
Mais il faut aller plus loin dans la critique. Le livre de Gabriel Martinez-Gros prend les allures d’une attaque en règle, voulant éviter que « l’histoire s’abolisse en religion », de ce qui constitue le cœur d’une remise en cause de l’Occident par l’Occident lui-même. Non que ce soit une manière perverse de réaffirmer une fois de plus la supériorité de l’Occident, seul capable de se remettre en jeu. Le tiers-mondisme, l’antiracisme, l’écologie, bref, la nouvelle « religion » que laisserait derrière elle la fin de la domination occidentale, ne sont pas des ruses inconscientes pour réassurer un empire défaillant, ni des succédanés induits par l’impuissance. Ce sont des tentatives, certes encore inabouties, pour transformer les logiques régressives de la puissance, qu’elles s’attachent aux modes de gouverner les hommes ou aux modes de produire. Loin d’un universalisme abstrait, il s’agit de faire échec par des actions on ne peut plus concrètes à la domination, qu’elle vienne de la richesse, de la couleur de peau ou d’entreprises destructrices de la terre, les trois étant liées par une triple finalité : gagner, soumettre, exploiter.
Avons-nous touché en vérité quelque chose de commun, des dimensions qui nous interdisent tout retour à nos vieux démons, néocolonialisme, déshumanisation, « ouranisme » (qui fait fi de son inscription terrestre, comme le chtonien, du reste, qui exalte son enracinement) dévastateurs ? C’est la question : ne la disqualifions pas d’emblée en la réduisant à un idéalisme abstrait ou en y voyant l’effet d’une lâcheté impuissante.












![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)