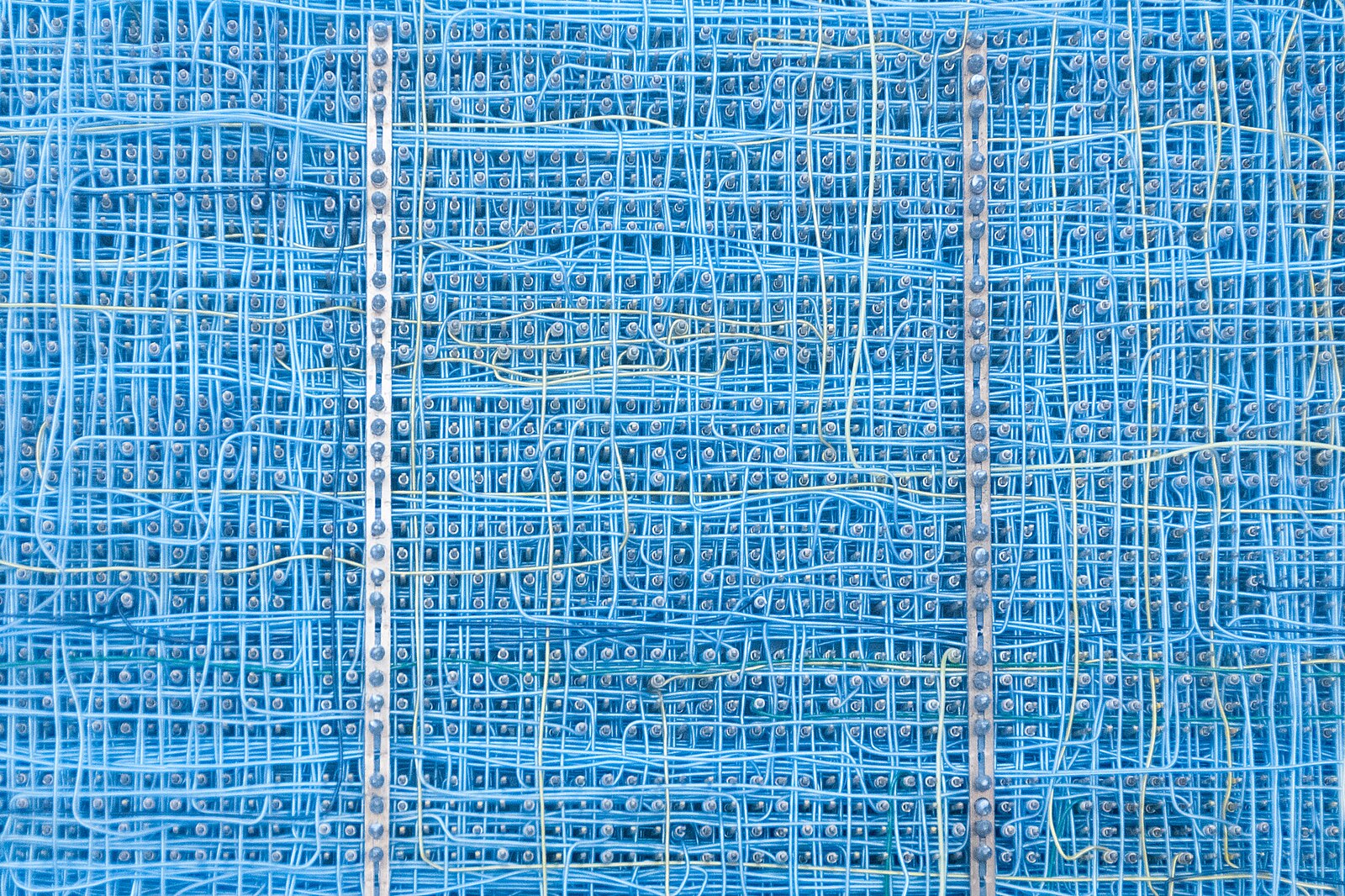La Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » consacre son dernier numéro à la question des enfants dans la guerre entre 1920 et 1950. Le sujet est hélas à nouveau d’actualité avec la guerre en Ukraine : après des signalements dans la presse, la sous-secrétaire générale aux droits humains de l’ONU, Ilze Brands Kehris, a estimé « crédibles », début septembre, les « accusations » concernant des enfants « qui ne sont pas sous la garde de leurs parents, transférés de force en Russie » pour y être adoptés.
Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », « Séparés. Des enfants dans la guerre, 1920-1950 ». Dossier dirigé par Laura Hobson Faure, Manon Pignot et Antoine Rivière. Anamosa, 208 p., 23 €
Dans une tribune publiée dans Le Monde, un collectif d’intellectuels et de pédopsychiatres, parmi lesquels Bernard Golse, l’écrivain Jonathan Littell et l’anthropologue Véronique Nahoum-Grappe, rappelle qu’entre le 24 février et le 18 juin, selon le ministère russe de la Défense, plus de 1,9 million d’Ukrainiens, dont plus de 307 000 enfants, auraient été transférés de force vers la Fédération de Russie, sans garantie ni contrôles extérieurs sur leurs conditions de vie et leur avenir. Les signataires s’inquiètent de leur sort, notamment des plus vulnérables. Côté russe, on parle sans vergogne de « rééducation ». Les décrets, signés par Vladimir Poutine le 25 mai et le 11 juillet, simplifiant l’obtention de la nationalité russe pour les Ukrainiens – y compris pour les enfants – facilitent même leur adoption.

© Alice Gravier/Anamosa
C’est ainsi que les coordinateurs du dossier de la Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » disent avoir été « rattrapés » par l’histoire. La période couverte par les différentes contributions (1920-1950) concerne essentiellement la Seconde Guerre mondiale, ses prodromes et ses conséquences. Laura Hobson Faure étudie le phénomène du Kindertransport qui accueille dès 1938 au Royaume-Uni et en France des enfants juifs non accompagnés en provenance des territoires allemands, à travers leurs journaux intimes. Des écrits qui, selon elle, « diffèrent de façon importante et révélatrice des récits rétrospectifs produits après la guerre, une fois la Shoah pleinement connue ». Citant la prodigieuse enquête de Nicolas Stargardt (Des enfants en guerre. Allemagne 1939-1945, Vuibert), basée sur les devoirs d’écoliers, les dessins, journaux intimes et correspondances d’enfants de tous horizons – juifs et non juifs, en Allemagne et dans les territoires occupés –, elle souligne que ceux-ci « établissent leurs propres chronologies de la guerre au travers d’événements clés : l’instant où leur guerre était devenue réelle », le moment où « la sécurité de leur monde s’effondre » et notamment par les bouleversements familiaux, les séparations.
L’histoire du Kindertransport recoupe celle des « républiques d’enfants » sous les auspices d’éducateurs progressistes, des institutions où les enfants élisaient leurs propres représentants et étaient encouragés à décrire leurs expériences. Parmi eux, Heinz Löw, douze ans, écrit dans son journal lors de l’invasion de la Pologne : « Hitler a occupé l’Allemagne en 1938 et une mauvaise période a commencé pour les Juifs. » La formulation est étonnante et pertinente à la fois – l’Allemagne occupée par Hitler ; elle pose la question de « l’agentivité », ou capacité d’observer et d’agir des enfants, pour documenter à leur échelle des événements qui les dépassent. Ainsi que celle de la valeur de tels documents pour écrire, selon l’expression de Manon Pignot, « une histoire à hauteur des enfants », à partir de nouvelles sources qui ne se résument pas à « une histoire des adultes agissant sur eux, parlant d’eux et pour eux », ouvrant la voie à une forme de micro-histoire, « au ras du sol » enfantin. « L’étude des expériences de guerre enfantines offre un gain d’intelligibilité tant pour l’histoire de l’enfance que pour celle du phénomène guerrier à l’ère contemporaine », notent Laura Hobson Faure, Manon Pignot et Antoine Rivière en introduction de l’ouvrage.

Cette historiographie « minuscule » de la guerre est en plein développement, car elle est cruellement révélatrice, notamment des dommages et traumatismes du monde qui vient après, mais aussi de ses promesses. Et, au-delà du caractère puissamment symbolique et affectif des récits et dessins d’enfants marqués par le cataclysme, pour tous ceux qui ont collecté, conservé puis étudié ces traces, celles-ci gardent intact le choc initial de l’événement, comme un pur écho de l’avertissement qu’il lance. « Ou plutôt : un avertissement déjà présent prend de petits événements pour traces et pour exemples. Ils indiquent un plus ou moins qui est à méditer en racontant et à raconter en méditant. » (Ernst Bloch, Traces, Gallimard, coll. « Tel », 1998)
Pour Sans ciel ni terre, Hélène Dumas s’était plongée dans les milliers de cahiers d’écoliers remplis par des enfants ayant survécu au génocide tutsi au Rwanda : des témoignages suscités par des ONG – une association de veuves, notamment – aidées de « conseillers en traumatisme » et de psychologues pour contribuer à une archive des rescapés les plus jeunes. La lecture d’Hélène Dumas résulte de plusieurs « actes d’écriture » – dont le soin porté à la traduction des paroles enfantines – pour constituer ce livre comme une autre histoire du génocide. L’une des étapes de cette transmission est due à Émilienne Mukansoro, rescapée du génocide et psychothérapeute, qui a permis de lire ces textes à la source, « comme on le fait d’un précieux secret ». À l’autre bout de la chaîne de transmission, Hélène Dumas montre comment ces gamins ont dû « pour survivre et échapper à leurs bourreaux, se construire de nouveaux écosystèmes de survie », une géographie intime avec « des cachettes qu’ils ne partageraient plus avec le monde des adultes, un monde à soi, à habiter pour tout simplement ne pas mourir ». Voici, à l’état brut, quelques bribes de récits d’une « enfance figée » – le terme clinique employé pour les jeunes rescapés – ayant subi les pires des violences, « mais rédigés à la première personne » : « Alors je suis descendu pour échapper à la barrière et je suis allé par la vallée ; j’ai pénétré dans les marais de papyrus et j’ai vécu comme un crapaud. » Ou encore cette gamine qui se rappelle : « Dans cette brousse, je me suis couchée sur un serpent : j’avais peur des balles mais lui aussi avait peur. En vérité, s’il m’a mordue, je ne le sais pas. »

© Alice Gravier/Anamosa
Majoritaires dans les fosses communes, les moins de quinze ans constituent aujourd’hui 38 % de la population post-génocidaire. Mais retrouver une place dans la société n’a pas toujours été simple pour les survivants, qui font l’objet « d’un soupçon et d’une méfiance permanents ». Pas plus que les retrouvailles avec la famille ou la fratrie… Même pénible constat pour les enfants séparés de la Seconde Guerre mondiale. Les coordinateurs du dossier de la Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » soulignent que le temps des retrouvailles « peut aussi être vécu par les enfants comme une nouvelle séparation, une nouvelle rupture, un rejeu parfois traumatique des bouleversements de l’entrée en guerre ».