Dirigé par Dominique Jean, à qui on devait déjà les deux premiers volumes de la série, paraît (enfin) dans la Pléiade le troisième et dernier volume des Œuvres de la famille Brontë. Dans l’élégante préface du victorianiste Laurent Bury, Shirley et Villette sortent de l’ombre dans laquelle Jane Eyre les a longtemps relégués. En dépit, ou plutôt en raison, de leur allure victorienne, ils le méritent bien, pour l’éclairage mi-figue, mi-raisin qu’ils jettent sur la condition ouvrière, pour le premier, féminine, pour les deux.
Charlotte Brontë, Shirley – Villette. Sous la direction de Dominique Jean, avec la collaboration de Véronique Béghain et Laurent Bury. Trad. de l’anglais (Royaume-Uni) par Véronique Béghain et Dominique Jean. Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1 392 p., 65 €
Avec Shirley (1849), Charlotte Brontë fait basculer l’usage. Elle y féminise un prénom masculin : après elle, il ne sera quasiment plus attribué qu’à des femmes. Petite révolution – petit « trouble » – dans le genre, d’une portée non négligeable, déclenchée mine de rien par Charlotte Brontë, laquelle avait de la suite dans les idées, et de qui tenir : de Jane Eyre, en l’occurrence, à la farouche indépendance. Après la parution du roman, rares sont les hommes qu’on prénommera de la sorte. Ainsi, dérobant son bien au genre masculin, Shirley la châtelaine se sera fait une place, sa place, dans l’état civil. Si on osait, on rapporterait ce changement de sexe à celui que connaît la fonction-auteur sous la plume des Brontë. En entrant en littérature, Charlotte se fait passer pour un homme – condition souffrant une ou deux exceptions, mais pas davantage, si on veut publier de la fiction ; à l’arrivée, « il » est devenu « elle », écrivaine (presque) à part entière. Et le tout sans lutter ou presque – de quoi faire naître des soupçons.

Autographe de Charlotte Brontë, avec la reproduction de son portrait réalisé en 1850 par George Richmond © The New York Public Library Digital Collections/Domaine public
Avec Villette (1853) ensuite, Brontë invente le nom d’une ville dont le modèle est Bruxelles, située dans le royaume francophone (imaginaire) de Labassecour (figurant la Belgique) – alors que les lecteurs du roman retiennent surtout le nom de son émouvante héroïne à la première personne, Lucy Snowe. Sur chaque couverture, donc, un prénom, un toponyme, et c’est tout. L’autrice de Jane Eyre, car c’est à ce roman qu’on la ramène immanquablement, voulait non pas faire court – Shirley s’étend sur 600 pages en Pléiade, et Villette n’est guère plus mince – mais faire entendre une (sa ?) différence. En réclamant pour cela une place pour la femme dans la langue – la sienne, qui est aussi celle de l’autre : femme, ouvrier ou étranger, selon les circonstances et le contexte.
Une place pour la femme, mais aussi pour les travailleurs. On commencera par là, une fois n’est pas coutume. Pour son roman Shirley, le troisième après The Professor et Jane Eyre, Charlotte Brontë nourrit une ambition majeure, majuscule même : faire peau neuve, briser avec les sentiments, fussent-ils fougueux comme ils ne sont jamais chez Jane Austen, et tourner le dos au genre du « roman de gouvernante ». En s’ouvrant au roman social, au Condition-Of-England-Novel. Un an après la parution du Manifeste du parti communiste, dans le sillage du printemps des peuples européens, et à la fin des Hungry Forties (la décennie 1840-1850, ponctuée par des émeutes de la faim), Brontë veut se faire l’émule de Benjamin Disraeli et de Sybil (1845), le premier ouvrage de fiction à mettre le doigt sur la fracture béante apparue entre les nantis et les autres. Entre les deux « Nations » d’Angleterre, d’en bas et d’en haut. Thématique reprise à son compte par Elizabeth Gaskell, la future biographe de Charlotte, avec son Mary Barton (1848), en attendant North and South (1854).
Brontë est donc bien décidée à se détourner de la passion amoureuse, préférant attirer l’attention sur les tourments endurés par la classe ouvrière, confrontée en ces années noires (1811-1812) à l’automatisation croissante des métiers à tisser et autres outils de travail. C’est le temps du luddisme, férocement réprimé. D’emblée, son narrateur (de genre épicène) prévient : ce qui suit va procéder d’un réalisme triste et ennuyeux comme un « lundi matin » : « Ce qu’on dispose devant vous est réel, froid et ferme. » On a connu entrée en matière plus apéritive… Inutile de préciser que, de nombreuses interpellations plus tard, l’ironique promesse d’un régime sec en émotions, d’une réelle diète affective, énoncée en ouverture du roman, ne sera pas tenue. Shirley aura bel et bien une double intrigue, amoureuse et sociologique, l’intrication des deux se faisant sur la base d’une commune victimisation : celle des ouvriers, dont on n’entend guère la voix, à quelques spectaculaires exceptions près, et celle des femmes, ici représentées par le duo formé par la douce et discrète Caroline Helstone et par Shirley Keeldar (qui fait son entrée dans l’ouvrage portant son nom à la page 196 !). Riche héritière, flamboyante « capitaine » dans l’âme et châtelaine dans les faits, ses parents, disparus peu après, lui ont donné un prénom unique, un patronyme masculin qu’ils auraient donné au garçon qu’ils désiraient ardemment.

« The Vale of Dedham » de John Constable (1828)
Antagonistes à plus d’un titre, les deux jeunes femmes se lient d’amitié. On pense qu’une rivalité amoureuse va classiquement les opposer, mais il n’en est rien. La résolution (heureuse, mais laissant à désirer) passe par un double mariage – comme dans les comédies de Shakespeare, ou à l’image de ce qui vient clore un « Conte », c’est le sous-titre générique du roman. Un mariage qui à la fois couronne le bonheur privé, d’ordre domestique, de Caroline (qui en pince pour le beau et grand Robert Moore) et de Shirley (qui a jeté son dévolu sur le frère de Robert, déshérité) et en marque (cruellement) les limites. Dans un monde d’hommes, l’avenir des femmes, réduites à ronger leur frein, passe (encore) par eux. De ces derniers, elles seront, dans le meilleur des cas, les « compagnes les plus gaies », les « garde-malades les plus aimantes », le « bâton de vieillesse le plus fidèle ». Même triplement superlatif, c’est tout sauf prometteur.
Les ouvriers ne sont pas logés à meilleure enseigne. Ambivalente, ainsi que le souligne Laurent Bury dans sa Notice, Brontë hésite à trancher entre la chèvre et le chou. L’apôtre d’une forme de paternalisme idéalisé et bienveillant épouse sans coup férir le point de vue des ouvriers jetés dans la misère – mais soutient mordicus l’entrepreneur dans ce qu’elle estime être ses droits légitimes à la propriété. Le second crie : « Au vol ! Au feu ! » quand ses ouvriers démolissent ses machines ; pour les seconds, c’est une question de vie ou de mort. Face à la fatalité de la misère, les hommes du West Yorkshire hurlent et grondent, en langue dialectale et incorrecte, mais le « bruit » que font les « émeutiers » quand ils jettent à bas les grilles et s’en prennent à la fabrique de Moore est un bruit de « haine », insupportable pour l’esprit de la « classe moyenne », qui saurait difficilement se montrer « tolérante » et « juste ». La régression intervenue depuis Hard Times (1845), de Dickens, est patente.
Une chose est sûre, cependant : les travailleurs ont en partage avec les femmes d’être une minorité, par quoi on entendra une absence de perspective émancipatrice, un statut « mineur » – sans qu’on entrevoie véritablement en quoi les uns ou les autres pourraient devenir majeurs. Et ce, quand bien même le combat et la farouche résistance seraient (presque) semblables. Pour un peu, on aurait préféré que Brontë s’en tînt à la trame initiale, qui prévoyait la mort de Caroline, « la petite démocrate », mais on comprend aussi que, profondément marquée par les deuils se succédant à quelques mois d’intervalle dans la fratrie – mort de Branwell, d’Emily et enfin disparition d’Anne, sur laquelle elle aura pris modèle pour le personnage de Caroline –, Charlotte n’aura pas souhaité se priver d’une thérapie et/ou d’une échappatoire, voire de l’espoir d’une contre-vie, d’un anti-destin, qu’offre l’écriture romanesque.
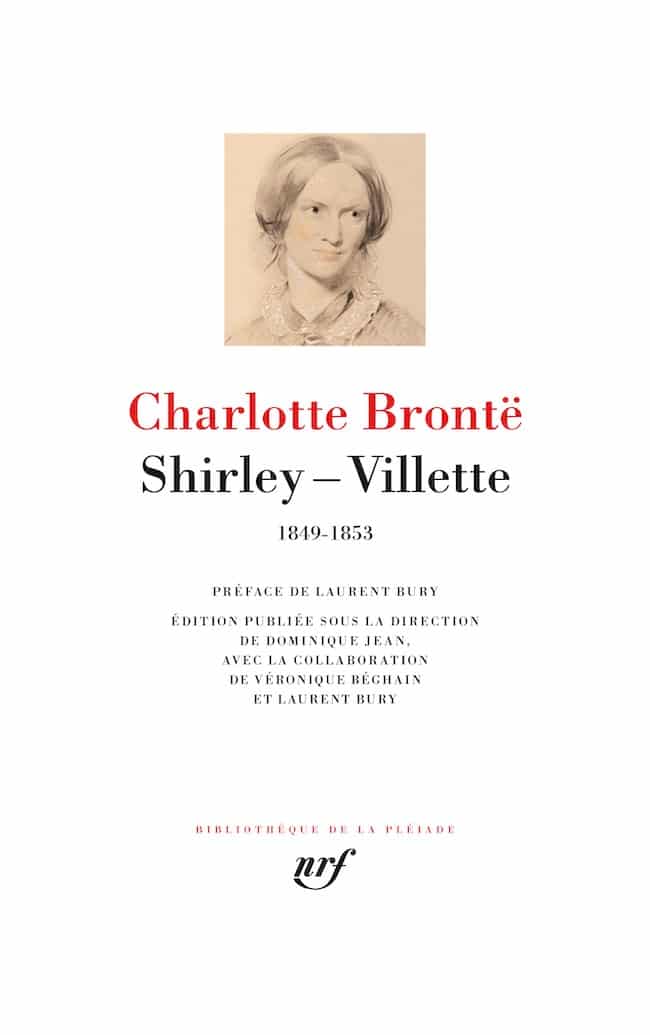
C’est moins la contre-vie que la vie fictionnalisée que raconte Villette. D’inspiration nettement autobiographique, en ce qu’il s’inspire des années passées comme enseignante par Charlotte à Bruxelles, il fait fond sur le « tropisme jane-eyrien », comme le nomme Bury. Un temps, le lecteur s’impatiente même devant le retour en force de l’asymétrie originelle (comme le péché du même nom), celle qui voit une jeune élève/disciple/gouvernante/maîtresse d’école s’abîmer devant la figure dominante du beau ténébreux, du héros byronien, sombre, mystérieux et maléfique, qu’il soit seigneur et maître (Rochester) ou directeur d’école. Avant de comprendre que les enjeux sont autres. Qu’ils ont notamment à voir, ainsi que le suggère Véronique Béghain dans la Notice qu’elle signe, avec la langue, le bilinguisme français/anglais. Les mots français dans le texte – le français étant pour Charlotte la « langue de l’amour » — sont partie prenante de l’identité de Lucy, de l’identité féminine. Une identité silencieuse, instable, poreuse, autre, en lien avec l’oscillation générique du roman, à l’intertextualité trouble et complexe, tiraillée entre réalisme et noirceur gothique.
Un propos qui rejoint l’intuition formulée par Laurent Bury, dans son Introduction, selon laquelle Charlotte Brontë, tout compte fait, n’eut rien à envier à Mary Shelley, l’autrice de Frankenstein. L’une et l’autre auront reconstitué « un squelette à partir des ossements de la réalité, que j’habillai et auxquels je tâchai d’insuffler la vie, ce que j’eus du plaisir à faire » (Villette). À condition d’ajouter que la démarche de Charlotte romancière, qui n’a rien à envier à la force de pénétration psychologique d’une George Eliot, n’a pas à « imiter » le docteur Victor Frankenstein. Currer Bell s’impose en faisant résonner son timbre propre, et c’est résolument du côté de la vie, de son « vacarme » langagier, de ses victoires et de ses défaites, que regardent Jane, Caroline, Shirley, Lucy et les autres. Bienheureux les « vieux livres anglais » riches de cette musique-là !












