Disparu le 26 mars 1989 à vingt-cinq ans dans des circonstances spectaculaires et tragiques, Haizi est en train de devenir en Chine une figure vénérée de « poète maudit ». « Le fils de la mer » (tel est littéralement son nom) quitta son petit village natal de Chawan (province d’Anhui) pour venir étudier dès l’âge de quinze ans dans une célèbre université de la capitale ; toujours à Pékin mais dans un autre district, il enseignera seulement quatre ans plus tard la philosophie et l’esthétique à Changping (université de droit et de sciences politiques). Entre délire verbal et sincérité bouleversante, symptôme toxique ou perle sublime, son recueil, intitulé Le langage et le puits, est un météore étrange. Il faudra du temps pour laisser se décanter son éclat et goûter sa profondeur sombre, bizarre et lumineuse, loin d’une fébrilité tapageuse.
Haizi, Le langage et le puits. Poèmes courts complets 1983-1989. Trad. du mandarin par Yujia Yang et Pierre Vinclair. Éditions Unes, 320 p., 25 €
Si l’entrée dans cet univers poétique n’est pas toujours aisée, la publication d’un recueil entièrement composé de poèmes de Haizi est vraiment à saluer ; il fait découvrir une voix fulgurante et testamentaire au cœur même de son intranquillité ; il aide aussi à mieux comprendre les apories et les malaises de la Chine contemporaine avec laquelle les échanges intellectuels et artistiques deviennent de plus en plus nécessaires et risqués.
La première impression de lecture, c’est celle d’une voix déchirée entre l’exaltation de la nature, l’histoire de la Chine et la nostalgie d’un amour perdu toujours plus dévastateur. Le poète voit sa mémoire blessée par la disparition de l’amante démultipliée au fil du recueil dans le retour obsessif de « quatre sœurs » au « silence éternel » : la beauté fulgurante du cosmos en a perdu son soleil. L’absence de son visage hante les champs de céréales, l’aube et le crépuscule comme la demeure du poète. Elle rôde sur la poésie de Haizi avec une douleur d’autant plus inquiétante qu’elle n’est jamais nommée. Nulle Béatrice ou Diotima, ni son corps, ni son regard, ni son nom n’apparaissent. Comme si c’était « le » féminin dans son ensemble qui avait abandonné l’auteur à sa déréliction. Le malheur amoureux prend dans ce recueil une proportion cosmique : en lui, l’équilibre du yin et du yang a été rompu et l’auteur étend cette rupture à une échelle universelle.

Dessin à l’encre de Haizi © Éditions Unes
Il y a dans cette projection « auto-sacrificielle » comme un double nouage de sa vie intérieure : le poète s’identifie à l’histoire de la Chine comme destin, il la voit comme un écartèlement entre la simplicité de la vie traditionnelle paysanne et l’irruption foudroyante des mégapoles et il se voit occuper, « seul » au milieu de ce vertige, la place du bouc émissaire. C’est la même attitude qu’il adopte, fantastiquement mais avec la même gravité, lorsqu’il se voit le passeur et l’oblat de la Chine et de l’Occident. Le suicide de Haizi incarne ce déchirement sur la voie ferrée de « l’histoire » entre l’Extrême-Orient et l’Ouest. Son annonce et son anticipation répétée sous diverses formes et allusions scandent le recueil à la manière d’une hallucination morbide ; s’y met aussi à nu une passion de la littérature tantôt lourdement occulte, tantôt fabuleusement lumineuse.
Dans Le langage et le puits, ce partage des eaux symboliques se traduit par des dédicaces à plusieurs écrivains occidentaux : Tolstoï mais aussi Kafka, Baudelaire, Rimbaud, ainsi que Hölderlin ; il n’hésite pas à s’adresser à ce dernier, à l’apostropher dans un dialogue d’outre-tombe :
« dis-moi, Hölderlin, pour qui mes poèmes sont-ils écrits ?
poèmes et vivres empoisonnés cachés au fond d’une porte souterraine
maisons et arbres fruitiers – ces éclats – quelle image présenteront-ils dans les ténèbres, Hölderlin ?
[…] quel dieu t’a dirigé en te tenant la main sur le chemin où se mêlent la lumière et les ténèbres ?
[…] était-ce des visions ? ou la vérité ?
était-ce une beauté ou un mensonge ? la mélancolie ou la joie ? »
Le poète et philosophe américain Henry David Thoreau est aussi convoqué. Il est à sa place dans le recueil de Haizi, tant la perception transcendantale de la nature et l’expérience radicale de la marginalité du poète chinois rejoignent l’auteur de Walden ou la vie dans les bois. Il s’y ajoute aussi des hommages à Van Gogh, dont Haizi partage l’instabilité et la sensibilité d’écorché vif.
Dans la poésie de Haizi, l’écriture n’a pas eu le temps d’éteindre les braises, elle rejoint le cri d’une parole, sa profération, laisse coïncider la simplicité et l’excès de la vie, sa surabondance : la vraie vie est ailleurs, mais cet ailleurs qui se dérobe à la saisie du poète affûte et hante la soif d’une entière présence au monde et aux autres. C’est cette proximité impossible, le chant du monde interrompu par le départ de l’amante qui rend sa poésie si nécessaire ; l’écriture est devenue la seule demeure possible à l’intérieur d’un monde hypnotisé par le culte de la sécurité qui conspue les aspirations amoureuses et mystiques d’un « je » qui se sent abandonné de Dieu :
« Je veux être fils fidèle du lointain
et amant éphémère de la matière
comme tous les poètes qui prennent leur rêve pour cheval
je suis obligé de prendre le même chemin que les martyrs et les clowns » (« La patrie »)

Dessin à l’encre de Haizi © Éditions Unes
Enfin, le poème intitulé « Le voyage du vagabond » dit le désarroi d’un « fils de paysan » broyé par la ville, une déclamation de pathos dans l’ébriété de ses tavernes. Pire encore, le retour au pays natal de Chawan est celui d’un enfant prodigue sans nulle oreille attentive pour l’accueillir. Tout rappelle dans les poèmes d’après la rupture amoureuse le désastre d’une parole brisée par une ingratitude ouvrant une opposition radicale entre le « moi » de la vie paysanne et le « moi » de la culture citadine ; c’est l’image du « peuplier blanc », « magnifique et tranquille », définitivement abattu par ce qui est devenu « l’éternel silence » des villes :
« te souviens-tu que le tonnerre roulait au loin
très haut dans le ciel retentissait le son du paradis
humanité inconstante te souviens-tu
du peuplier blanc sous l’éclair et dans la pluie »
À partir de cette fracture, le poète est livré à l’empire d’un imaginaire de déréliction et d’exposition au cycle des saisons et à la tyrannie des éléments. La neige, la pluie, la nuit, le soleil (qu’il veut pour nom), tout devient prétexte à souligner la souveraineté précaire du poète émerveillé mais maudit par les grands mouvements de la nature qu’il subit à la manière de « tresseuses mystérieuses » aux « rouets empourprés » de son sang.
Si la poésie de Haizi partage avec la poésie occidentale l’évocation des saisons et de la rose, la thématique de la nuit spirituelle, et bien d’autres encore, elle est d’abord marquée par une forte topique « chinoise » : la prégnance du blé et des céréales dans la vie des campagnes, celle des chevaux et des oies sauvages, celle de la pluie et des grands lacs, le lac Qinghai en particulier, et les grottes de Dunhuang. On y retrouve aussi l’érable, les fleurs de pêcher, l’aubépine et le plaqueminier, traités avec une grande économie de moyens. Le désert de Gobie et quelques villes du nord, différentes allusions aux légendes chinoises les plus populaires, comme celle de la « concubine bleue » devenue impératrice ou du poète Qu Yuan disparu dans les eaux par dépit politique, ajoutent leurs couleurs orientales à la voix intimiste de Haizi :
« Là-bas, près de la tour de bois
il n’y a que deux personnes
Concubine Bleue est une petite tête ronde
le mari de Concubine Bleue est un empereur qui vend du sorgho »
Quant au style de ce recueil, il mêle l’art brut à quelques « fusées » baudelairiennes d’une grande finesse de tact et d’envol.
« Je ressemble à un puits
creusé par les ancêtres
pour les générations futures
tous les malheurs sont nés de mes eaux profondes et mystérieuses. » (« La lune, la nuit »)
Il s’ajoute aussi à cette veine un romantisme cosmique où tout rappelle la mémoire des amantes, comme dans le poème intitulé « Les quatre sœurs » :
« Sur la colline désolée se tiennent debout quatre sœurs
les vents ne soufflent que vers elles
les jours ne se brisent que pour elles »
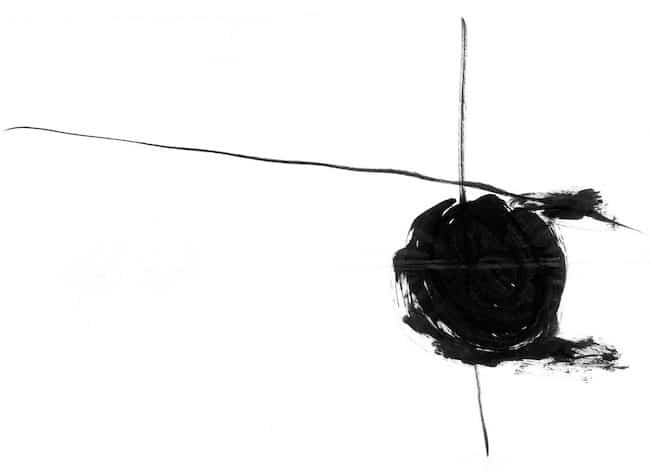
Dessin à l’encre de Haizi © Éditions Unes
Il y a aussi quelques formes fixes – sonnets, quatrains, haïkus chinois, distiques – au milieu de très nombreux poèmes en vers libres. Mais, la plupart du temps, les poèmes sont touffus, spontanés et incantatoires, sans crainte de reprendre pour l’approfondir le même leitmotiv. Ils sont aussi éprouvants quand le désespoir et la mort reviennent à la charge comme un destin à accomplir : dans une telle perspective, l’acte d’écrire, éminemment performatif chez Haizi, prend l’allure d’un lourd tribut que le corps de l’auteur (le sang) devrait payer au corps aveugle de l’Histoire (le destin), soit le corps social considéré dans son évolution historique « implacable ». D’où le relief apocalyptique d’une telle poésie, chargée de dévoiler la persistance d’un mal incurable au cœur même de l’Histoire, son goût du tragique difficilement soutenable :
« dans le langage aveugle il y a le sang et le destin
alors que le captif est rentré chez lui
il y a le sang de la liberté et le sang de la mort
il y a le sang de la sagesse et le sang du péché ».
La fréquente mise en scène de soi dans le recueil assigne au poème le rôle d’une transgression nécessaire de l’union ancestrale de la terre, du ciel et du corps social. Quelquefois, Haizi croit à la possibilité de nommer le monde en toute innocence, de « donner un nom doux à toutes les rivières, toutes les montagnes », à la possibilité aussi de construire « un bonheur », d’accueillir un « amour éternel » et les « étrangers » ; le plus souvent, hélas, une sourde culpabilité et un occultisme trouble désenchantent sa poésie au point de la rendre presque inaudible.
Au lecteur de demeurer disponible aux illuminations éphémères de cette voix brisée, à leur capacité d’éveil à un autre imaginaire que le nôtre. Au lecteur d’y déchiffrer quelques oasis de beauté et de paix aux senteurs contagieuses et de relire les quelques pièces où l’espoir d’un « paysage lumineux » et d’un ciel vraiment neuf – Haizi ne craint pas d’employer le nom de Jésus dans l’un de ses poèmes – réveille du stérile sommeil de l’ésotérisme :
« Au printemps, dix Hai Zi reviennent à la vie
dans le paysage lumineux
se moquent de ce Haizi sauvage et triste
pourquoi dors-tu si longtemps à poings fermés ? »











