Comment maintenir l’ordre au cœur d’une révolution ? Une fois abattu le « despotisme policier » de l’Ancien Régime, que signifie « être policier » et « faire la police » dans le Paris de la décennie révolutionnaire ? Entre rupture et inertie, continuités et innovations, le dernier livre de Vincent Denis éclaire de façon inédite un moment au cours duquel la police s’est voulue citoyenne.
Vincent Denis, Policiers de Paris. Les commissaires de police en révolution (1789-1799). Champ Vallon, coll. « Époques », 384 p., 27 €
Ce livre doit être salué parce qu’il aborde un domaine mal connu du fait de l’état de la documentation mais aussi de la difficulté propre à une période marquée par de perpétuels soubresauts politiques et par la complexité d’une organisation administrative sans cesse remaniée. La première réussite de Vincent Denis est d’être parvenu à exposer avec simplicité des questions particulièrement ardues. Avec lui l’érudition n’est pas triste. Il sait restituer de façon alerte, grâce à son excellente connaissance des archives et à l’évocation de ces multiples éclats de vie qui sourdent des vieux papiers, à la fois le tumulte, l’effervescence, mais aussi les hésitations et les incertitudes au quotidien de policiers « en révolution ».

Vincent Denis délaisse les approches étroitement institutionnelles qui ont longtemps prévalu dans la littérature historique, pour s’engager résolument dans la voie d’une histoire sociale des métiers de police, inspirée par un renouveau historiographique qui puise ses racines à la fois dans la sociologie et dans une série de travaux anglo-américains pionniers. Il s’attache à reconstituer les origines socio-professionnelles, les itinéraires, les carrières de ceux qui furent commissaires, mais il se penche également sur leurs pratiques et sur les rapports qu’ils entretenaient avec la population.
L’été 1789 fait disparaître la Lieutenance générale de police créée en 1667 et ses inspecteurs, peu appréciés des Parisiens. Seule exception à cette table rase : les commissaires au Châtelet, vénérable corps d’officiers de justice et de police issu de la bonne bourgeoisie urbaine, restent en poste et s’adaptent jusqu’en 1791 à une nouvelle configuration policière dirigée par l’Hôtel de Ville, avant de s’effacer. Cet effondrement de la machine policière d’Ancien Régime marque la fin d’une police parisienne au statut exceptionnel, étroitement contrôlée par le pouvoir royal, précocement étatisée à la différence de la situation qui prévalait dans nombre de villes du royaume et de toute l’Europe. C’est aussi un coup d’arrêt à l’essor d’une police bureaucratisée, de plus en plus professionnalisée et mobilisée par une forte activité de surveillance, telle qu’elle s’était développée au moins depuis le milieu du XVIIIe siècle.
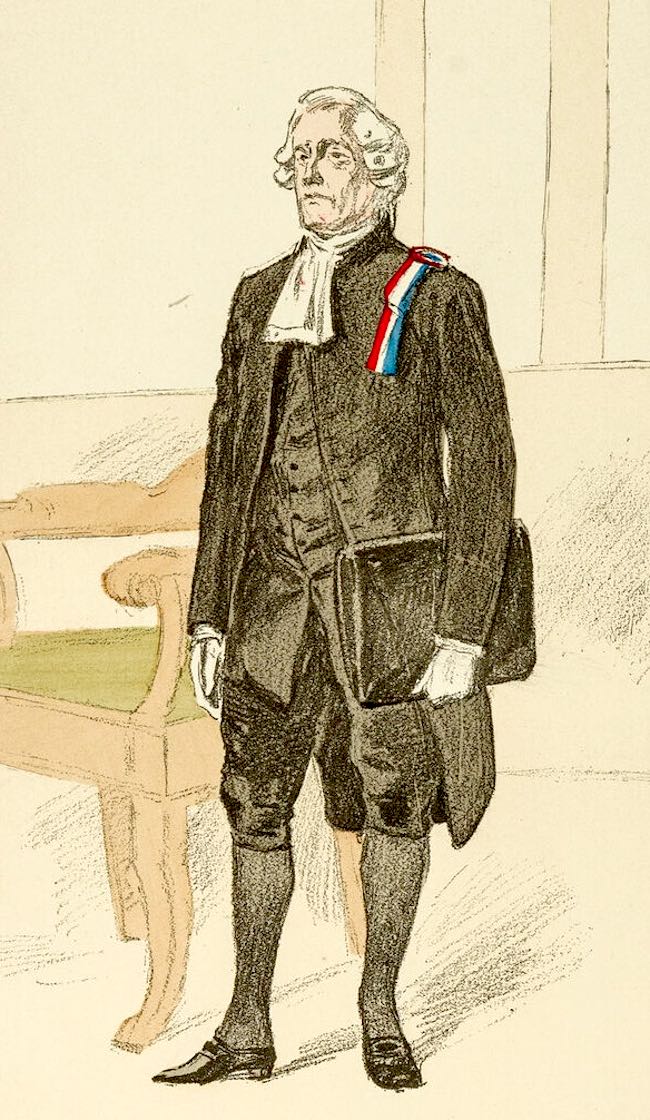
Planche en couleurs « Commissaire de police sous la Révolution ». Illustration extraite de l’ouvrage d’Alfred Rey et Louis Féron, « Histoire du corps des gardiens de la paix » (1896)
Au cours de la période qui s’ouvre en 1789 et dure jusqu’en 1792, les Parisiens se réapproprient leur police qui devient municipale et qui s’exerce principalement à travers deux types d’acteurs, la Garde nationale constituée de « bourgeois » en armes d’une part, des fonctionnaires élus d’autre part. À plusieurs égards, cette première phase revêt pourtant l’aspect d’une « révolution inachevée ». En 1790, l’élection de commissaires non professionnels dans le cadre des 48 sections qui subdivisent le territoire parisien aurait pu créer une toute nouvelle police, exercée par les citoyens au service des citoyens. En fait, et c’est l’un des apports du livre, les continuités l’emportent. D’abord, parce que la majorité des commissaires élus dans les nouvelles sections sont des hommes de loi, et même pour sept d’entre eux d’anciens commissaires au Châtelet. Ensuite, parce que ces commissaires, privés d’une grande partie de leurs fonctions judiciaires avec l’instauration des juges de paix, sont considérés par la Commune comme des exécutants, appliqués à surveiller les populations et les comportements jugés à risque. L’activité ordinaire des citoyens-policiers trahit une continuité d’inspiration avec la police préventive et de surveillance de l’Ancien Régime, parfois bien éloignée des principes proclamés en 89. Peu dotés en moyens matériels et humains, les commissaires de 1790-1791 sont très vite écartelés entre les injonctions de la Commune et les attentes immédiates des habitants de leur section. Les voici bientôt confrontés aux effets des divisions politiques et de la politisation des conflits.
La fuite du roi à Varennes, l’agitation démocratique, la fusillade du Champ-de-Mars du 17 juillet 1791 et le tournant répressif qui s’ensuit plongent la police dans la crise. Les commissaires conservateurs s’opposent aux commissaires patriotes ; l’engagement politique et l’enracinement dans la section deviennent plus importants que la compétence policière elle-même. Avec la chute de la monarchie, le 10 août 1792, la police parisienne bascule dans une expérience policière unique : désormais élus au suffrage universel, les commissaires de l’an II et de l’an III se distinguent nettement de leurs prédécesseurs. Ils sont plus jeunes ; ils viennent du monde de la boutique et de l’artisanat. Surtout, on les désigne en raison de leur militantisme dans la section. Les élections de 1793 portent à son apogée le modèle du « commissaire sans-culotte ». Pour ces hommes engagés, le défi est rude. Comment canaliser les énergies révolutionnaires dans les tensions exacerbées de 1792-1794 ? Comment maintenir l’ordre sans réprimer les aspirations légitimes du peuple, notamment sur le front des subsistances ? Quelle place tenir exactement alors que se multiplient les organes de surveillance politique, entre les comités centraux de l’Assemblée, l’administration de police de la Commune et les comités de surveillance des sections révolutionnaires ? Nombre de commissaires apprennent à naviguer prudemment en eaux troubles. La plupart exercent une influence modératrice à l’égard d’un radicalisme débridé ; beaucoup reconnaissent d’abord la légitimité de la Convention de préférence à celle de toute autre instance politique, ce qui joue de manière contrastée lors des journées révolutionnaires. Le 10 août, ils prennent part à la chute de la monarchie ; le 9 Thermidor, peu soutiennent Robespierre.

« Malheureuse journée du 17 juillet 1791 : des hommes, des femmes, des enfans ont été massacrés sur l’autel de la patrie au Champ de la Fédération ». Estampe 1791 © Gallica/BnF
Avec la Convention thermidorienne et le Directoire, les commissaires de police connaissent une nouvelle mue, cette fois durable. Dans les trois années qui suivent l’été 1794, au gré de remplacements plus d’une fois motivés par des considérations politiques, les commissaires sans-culottes et citoyens disparaissent au profit de personnages plus ternes, choisis avant tout pour leurs compétences bureaucratiques. Ils font la transition avec les commissaires nommés de la Constitution de l’an III qui enterre définitivement le principe de l’élection et instaure la figure du commissaire, fonctionnaire docile de l’État, sans attaches personnelles avec le territoire dont il a la charge. Pendant le Directoire, la centralisation renforcée de la police avec la création du Bureau central de Paris – ancêtre de la Préfecture –, la subordination définitive de la police à la justice avec l’adoption du Code des délits et des peines de Brumaire an IV, condamnent les commissaires à n’être plus que de simples auxiliaires de l’administration. Dans leurs missions quotidiennes, ils poursuivent les petites infractions, se préoccupent de protéger les consommateurs contre les fraudes et défendent l’ordre moral ; ils multiplient les descentes de police, les contrôles d’identité et s’engagent dans une véritable chasse aux prostituées. « Surveillants de la tranquillité publique », « instituteurs » d’un ordre républicain et bourgeois en construction, les commissaires s’efforcent de recouvrer une légitimité de terrain censée compenser la perte de toute légitimité politique. L’impression qui domine est pourtant celle d’un déclassement progressif du commissaire de police entre l’Ancien Régime, la phase montante de la Révolution et le Directoire. Dans la hiérarchie recomposée des administrations et de la justice, leurs fonctions ne se situent plus au même rang qu’avant 1789.
Pour la police parisienne, la décennie révolutionnaire apparaît finalement divisée en deux temps. Les années 1789-1795 seraient celles d’une révolution policière avortée, marquées par la tentative de créer une police de citoyens, mais qui échoue à s’imposer, faute de temps, de stabilité et de continuité politique. La période acte l’échec d’une police non professionnelle qui, pendant tout l’Ancien Régime, était restée une option hors de Paris et en dehors des frontières françaises. Face au centralisme de la machine policière parisienne et aux agents du pouvoir royal, les bourgeoisies urbaines et les autorités locales avaient souvent veillé jalousement à défendre leurs compétences de police. La pratique policière des années 1795-1799 entérine au contraire la transformation des commissaires-citoyens engagés en bureaucrates obéissants. À Paris, le Directoire crée une configuration policière inédite qui s’enracine dans la constitution d’un groupe de professionnels distincts du monde de la magistrature, non plus dans l’exercice de citoyens policiers.
L’expérimentation sans suite de cette police citoyenne a sans doute beaucoup à voir avec la situation d’une ville longtemps prompte aux élans révolutionnaires, trop sensible politiquement pour que ses instances d’ordre et de régulation soient détachées du pouvoir politique. De l’Ancien Régime aux régimes postérieurs, en dehors de la courte parenthèse de 1789-1794, la « résilience policière » reste forte dans la capitale, gage de la construction d’un ordre public étroitement contrôlé par l’État.










![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)

