Fort d’une amitié de plus de cinquante ans avec Mario Vargas Llosa (Prix Nobel de littérature 2010), son traducteur, Albert Bensoussan, offre une introduction à l’œuvre dont il a accompagné pas à pas l’épanouissement. Il en déploie la puissance, la démesure et la séduction, jusqu’à se laisser emporter par la fusion avec son modèle et céder à l’ivresse de s’en éprouver le double.
Albert Bensoussan, Mario Vargas Llosa, écrivain du monde. Gallimard, coll. « Arcades », 240 p., 18 €
Mario Vargas Llosa, Journal de guerre. Trad. de l’espagnol par Annie Vignal. Préface d’Albert Bensoussan. La Martinière, 144 p., 18 €
La prouesse est à bien des égards exceptionnelle qui vaut à Albert Bensoussan d’être devenu depuis 1973, soit un demi-siècle de sa vie d’hispaniste, le traducteur de Vargas Llosa. On comprend le désir qui le saisit aujourd’hui, fort de sa profonde imprégnation par l’œuvre dont il a accompagné pratiquement toutes les étapes, de s’en faire cette fois le médiateur critique. Dépassant le cadre auquel il s’était tenu jusqu’à présent, celui des préfaces isolées ou des aperçus encore fragmentaires, il embrasse cette fois l’ensemble de l’œuvre. L’essai publié aux éditions Gallimard, maison qui dès l’origine accueille Vargas Llosa, dans une collection où il rejoint les essais du Latino-Américain désormais citoyen du monde, constitue un aboutissement. On appréciera l’aisance avec laquelle il nous guide à travers une production immense – romans, essais, politique – qui a gagné à la littérature des domaines encore inexplorés.
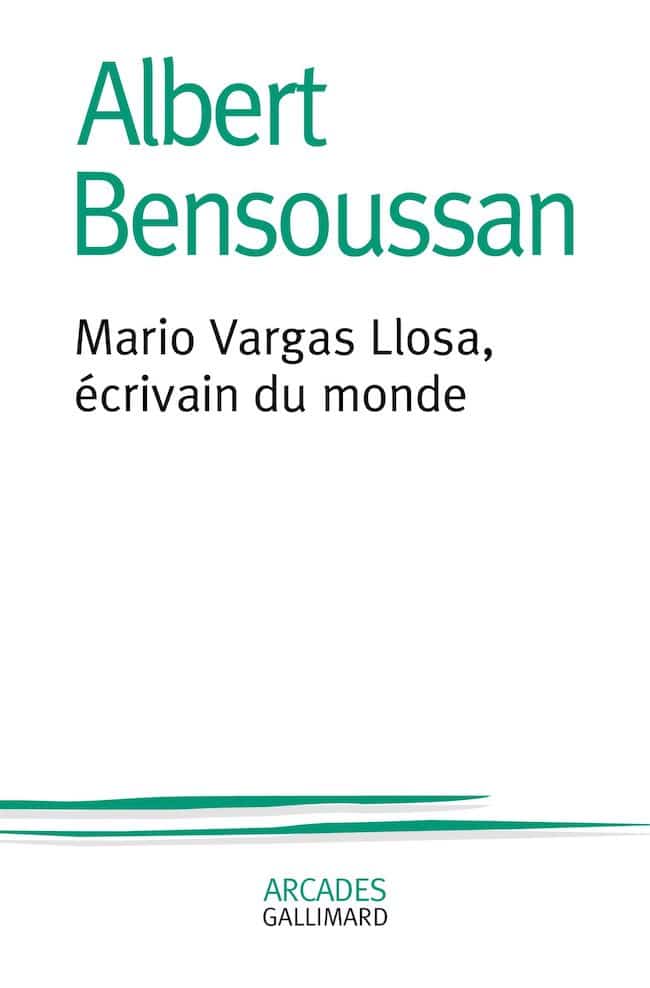
L’étroite collaboration, l’empathie même avec les auteurs qu’il fait passer en français, est une constante chez Bensoussan, expert en littérature latino-américaine contemporaine (et collaborateur historique de La Quinzaine littéraire puis d’En attendant Nadeau). Pour s’en tenir à quelques noms, Bensoussan a traduit l’Uruguayen Juan Carlos Onetti, le Cubain Guillermo Cabrera Infante et sa cadette Zoé Valdès, exilée elle aussi pour fuir les geôles castristes. Au moment de traduire Trois tristes tigres de Cabrera Infante (Barcelone, 1964), dont la version française en 1970 fut couronnée par le prix du meilleur livre étranger, il avait passé quelques semaines à Londres dans l’appartement de l’auteur cubain. Aux premières heures de l’aube, lorsque s’achevaient les joutes verbales avec l’auteur complice disposé à l’aider dans l’approche du burlesque et de la parodie qui sont au cœur du roman, Bensoussan s’étendait sur le canapé du salon jusqu’à la reprise du lendemain. Il garde de ce séjour mieux qu’un souvenir ébloui. Cabrera Infante l’avait initié aux vertiges de la créativité de la langue.
La leçon est encore sensible dans l’approche de Vargas Llosa et l’intimité avec l’écrivain plus grande encore, même si Albert Bensoussan n’a pas été son premier traducteur. La version française des deux premiers romans, La ville et les chiens (1966) et La maison verte (1969), est l’œuvre de Bernard Lesfargues ; Conversation à la Cathédrale paraît en avril 1973, traduit par Sylvie Léger et Bernard Sesé. Vargas Llosa a raconté avec une belle fraîcheur ses expéditions parisiennes de débutant, à la recherche d’un éditeur. Il y avait été accompagné par Claude Couffon, jeune assistant à la Sorbonne. Déceptions et revers pimentent l’aventure. Maurice Nadeau, qui eut la primeur du manuscrit de La ville et les chiens, le laissa dormir, une note de lecture défavorable l’ayant dissuadé de donner suite. Les deux jeunes gens, solidaires par l’âge et la détermination, apprirent le refus lorsqu’ils allèrent récupérer le manuscrit dans les bureaux haut perchés de Nadeau, boulevard Saint-Germain. Couffon, loin de se laisser abattre, eut un sursaut salvateur. Il convainquit son ami de déposer le manuscrit… chez Gallimard. Tel est le début de l’aventure dont Bensoussan relève fièrement aujourd’hui encore le défi.

Mario Vargas Llosa © Fiorella Battistini
La dédicace en tête du livre avertit de l’unicité de la relation à Vargas Llosa : « À Mario, l’hommage qui t’est dû ». L’usage du prénom et du tutoiement s’assortit de l’aveu d’une dette que le traducteur relève au nom de la communauté des lecteurs français. L’épigraphe, empruntée au poète espagnol de la Renaissance Garcilaso de la Vega, achève de dresser le modèle dans une célébration qui échappe aux contingences du temps. Présenté d’entrée de jeu comme un dialogue entre le traducteur et l’écrivain qu’il fait passer en français, l’ouvrage balaie gaiement tout conformisme. La complicité avouée d’un commun accord par Vargas Llosa et Bensoussan (en 1987, aux Assises de la traduction littéraire d’Arles) n’a pas fléchi. Le traducteur est gagné par l’appétit, la puissance de son modèle qui dévore et représente la vie en Flaubert redivivus. Flaubert ne présentait-il pas l’écriture, dans une lettre à Louise Colet, comme une « orgie perpétuelle » ? La conviction que la traduction est une création nous vaut une entrée très vivante dans plus d’un écrit, a fortiori lorsque Bensoussan fut associé à sa genèse. C’est la cas, en particulier, de la tragique épopée des gueux qu’est La guerre de la fin du monde dans le Brésil de la fin du XIXe siècle, roman que le traducteur connut d’abord comme un scénario de film, demandé par le réalisateur brésilien Ruy Guerra, avant son abandon par la Paramount.
La position affichée de drogman, ou de « traducteur à l’ombre d’un géant », n’exclut pas, le cas échéant, d’imprudentes licences. L’invention linguistique s’exerce alors aux dépens des données objectives péruviennes (faune et flore, littérature ou société). L’édition de la Pléiade des Œuvres romanesques redresse (sous la plume de réviseuses attentives qu’on ne saurait trop remercier, Anne Picard et Ina Salazar) quantité d’approximations, voire des truculences enflées à l’excès. Ces débordements sont à entendre comme la rançon d’une étourdissante adhésion à l’œuvre du maître.

Sobre et précise, la préface d’Albert Bensoussan à la traduction française du Diario de Irak (Buenos Aires, Aguilar, 2003) sous l’appellation de Journal de guerre, est indispensable à la compréhension du texte. Près de vingt ans se sont en effet écoulés depuis sa sortie en langue espagnole, fruit du reportage effectué par Vargas Llosa sur le terrain des opérations menées par George Bush et ses alliés contre Saddam Hussein. La rédaction effectuée sur place en Irak aux premiers jours de la guerre, entre le 25 juin et le 6 juillet 2003, avait été accessible d’abord sous forme de feuilleton dans la presse de langue espagnole (El País de Madrid et certains journaux d’Amérique latine), puis publiée en novembre de cette même année. Rassemblées dans un livre, les chroniques s’enrichissaient alors d’annexes reprises à Piedra de toque, nom des chroniques régulières données par l’auteur à la presse, et d’un dossier de photos dû à sa fille Morgana. La traduction aujourd’hui autorisée par Vargas Llosa ne concerne ni les annexes ni le cahier photos de sa fille. La conviction de l’auteur est en effet que l’ouvrage tranche une question toujours actuelle, au moment où le pays, déchiré entre factions rivales, s’enfonce davantage encore dans la guerre civile : les puissances occidentales étaient-elles fondées à renverser militairement, dans un pays tiers, une tyrannie qui opprimait le peuple ? Vargas Llosa maintient ses positions de jadis et répond par l’affirmative. Le débat reste ouvert, dans la mesure notamment où l’argument avancé par les Américains – Saddam Hussein aurait disposé d’armes de destruction massive – s’est révélé mensonger. Le document témoigne de l’engagement de Vargas Llosa dans les affaires brûlantes du monde.












