Dans l’œuvre violente, amère et nécessaire de Sadegh Tchoubak (1916-1998), qui lacère dès qu’elle le peut les rutilances de l’élégance, du folklore et du parler-beau, des êtres grelottent de froid et la misère sordide est omniprésente. Et la mer s’était déchaînée regroupe trois nouvelles écrites dans les années 1940 par cette figure majeure de la littérature iranienne du XXe siècle.
Sadegh Tchoubak, Et la mer s’était déchaînée. Trad. du persan par Sylvie Le Pelletier-Beaufond, Yvonne Rezvani et Joëlle Segerer. Sillage, 96 p., 10 €
On ne le lit pas Tchoubak pour se donner un air d’Iran ou une teinture de vague curiosité. Le lire, c’est recevoir immédiatement un coup dans le bas-ventre, c’est rentrer ligne à ligne, visage après visage, hurlement après hurlement, dans l’enfer quotidien, vécu, de ces très pauvres gens qui ont tout des damnés de la terre. Non que Tchoubak soit sans pitié avec eux, non, il s’interdit délibérément tout sentimentalisme facile, tout larmoiement vendeur, toute sagesse (un peu trop) malicieuse façon Albert Cossery. Ce qu’il tente de restituer avec une vaillance qui force le respect, c’est l’atroce réalité du monde de celles et ceux qui n’ont plus rien, tristes dépossédés de chaque jour.
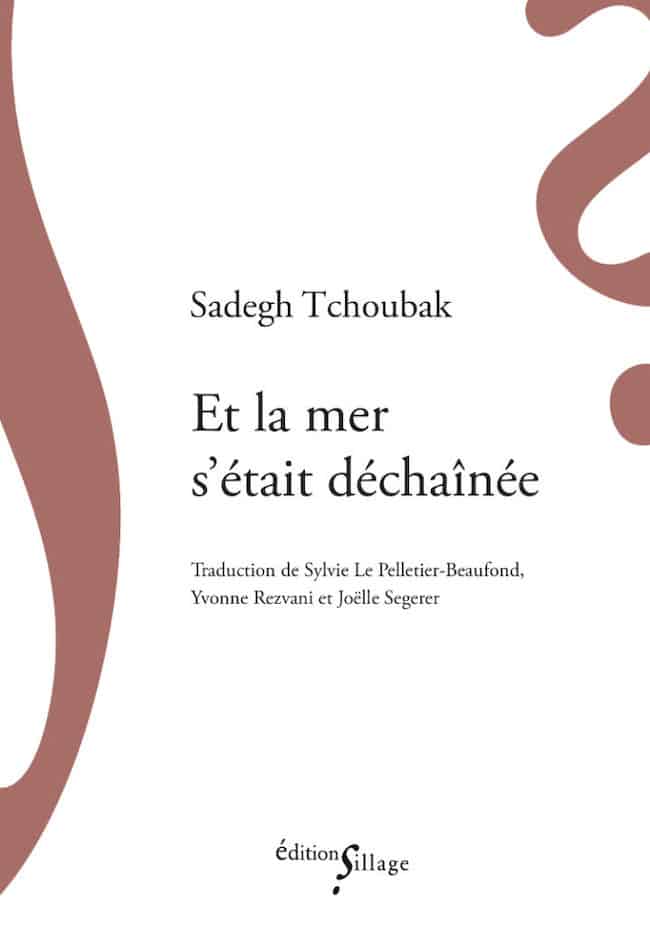
Le monde moderne nous a appris à dire « Iraniennes », « Kurdes » ou « Baloutches », comme si l’étrangeté supposée d’une origine nous épargnait d’avoir à connaître, de l’intérieur, toute l’horreur de ces vies individuelles, brisées, mutilées, sous emprise. Avec Tchoubak, nous entrons dans un Iran « souterrain » – certes l’Iran des années 1940, du monde de la drogue et de la prostitution, d’une religiosité doloriste confinant parfois à la bigoterie, mais comment ne pas entendre en lui les clameurs et les douleurs de l’Iran d’aujourd’hui ? – chaque fois que nous franchissons le seuil de la misère extrême et de l’insoutenable.
« Iran », avec Tchoubak, devient synonyme d’ordure, d’injustice, de brûlures au fer rouge sur le corps et sur la peau. Il n’y a pas de figures héroïques chez lui – comme dans le tout aussi remarquable recueil de nouvelles Nuit d’insomnie que les belles éditions Sillage avaient publié en 2019 et qui fait pendant à ce terrible Et la mer s’était déchaînée –, pas de modèles à suivre, sinon à bout de douleur, d’endurance et de survie, grise et monotone comme la prison et la boue. Le miroir narratif qu’il traîne au long du chemin est coupant comme un rasoir.
Des noms déchirent la nuit de la pénitence (pour qui ? pour quoi ? pour quel Dieu vengeur ? absent ?) ; des cris de femmes s’y font entendre telles Djeyrân, Âfâq, Zivar, toutes maltraitées dans leur chair, ravagées par les salissures abjectes du sexe prostitué. Seules quelques figures rescapées du temps et de l’enfer terrestre brillent un instant dans ces ténèbres sans gloire, funèbres, qu’une toute petite société iranienne enrichie regarde de loin, sans s’en soucier, perdue dans ses fêtes : la naissance d’un enfant (fruit de tous les désespoirs charnels et de toutes les bâtardises enfouies) dans le sang d’un accouchement solitaire, un soir d’orage, zébré de fièvre et d’impatience ; un petit bonhomme dessiné sur un mur n’existant que pour les yeux épuisés d’une femme ; des feuilles d’automne poussées par le vent sous le regard hagard d’un orphelin misérable. Et puis c’est la nuit limoneuse, toujours, partout, et ce monde qui persiste, impitoyablement indifférent, chez Tchoubak : « C’était comme un bidon de pétrole vide tombé des cieux qui dévalait sur la terre ». Comme le dit une prostituée dans sa langue de peine, si pleine de vérité et de verdeur : « La baise des riches, c’est comme la mort des mendiants, ça fait pas de bruit ».

© Jean-Luc Bertini
Devant un tableau aussi sinistre, on pourrait penser que Tchoubak n’est rien d’autre qu’un nihiliste cachant ses vices et ses perversités chez des personnages auxquels il fait vivre une véritable ordalie de foutre et de sang. Or, il n’en est rien. Tchoubak est un écrivain remarquable qui se défie comme de la peste de tout naturalisme voyeuriste. Certes, les sujets peuvent apparemment friser ceux de la littérature « décadente » : mort d’une prostituée de la fièvre cachectique, corps gracile livré aux prédations et orphelins l’œil torve subissant brimades ou humiliations. Mais ce serait s’arrêter à l’étiquette et Tchoubak n’a cure de tout ce qui pourrait sembler scabreux. Il va jusqu’à l’os, il dénude, il perce l’illusoire carapace des respectabilités accumulées ; grand pudique, enfin, il n’est jamais pudibond.
Tout se passe dans son univers comme si l’enlisement absolu était devenu la loi de la nature (« On aurait dit un chaudron dans lequel bouillaient du vieux cuir et un tas de saletés ») ; la déliquescence et la purulence, celle de la destinée des êtres. Tout un chacun, souteneur, mère maquerelle, louti, fille perdue, y jure ses grands Dieux, y épuise à chaque seconde toute une cargaison entremêlée d’injures et d’invectives lancées du sol crasseux sous le haut patronage d’un chiisme vitupérateur et des solennels martyrs de cette religion. Sauf que, chez Tchoubak, le martyre – qui dure toute une vie – et la récurrence déplacée des insultes créent une sorte de confessionnal complètement délabré où le ciel est si bas et les humains si perdus que la symbolique même semble évanouie au milieu des crachats et des exutoires de tous ordres.
On peut comprendre désormais pourquoi l’auteur a dû si souvent subir la censure. Le réalisme poignant de ses scènes, mettant à nu les chairs livrées au scalpel, troque les parades faussement réjouies de Takht-e Jamshid pour les faubourgs pluvieux et désolés de Téhéran, d’Âbâdân et de Bouchehr ; la peinture des ruines chez Tchoubak démolit le vague parfum d’orientalisme stylisé légué par quelque fantomatique Irania Felix en une brûlante fresque apocalyptique où les loques, les haillons, couvrent bien mal quelques opiomanes dépenaillés rongés par le vide et de pauvres créatures dévorées par le manque et une anatomie férocement libidineuse. Ce regard qui ne s’échappe pas et qui fixe obstinément les bas-fonds a tout, mais sans le dire nommément, d’un réquisitoire impitoyable contre l’incurie de la société qui a permis une telle dévastation et un tel abandon. L’émouvante prostituée Âfâq le dit à sa façon sans détour : « Notre tombe à nous, elle sera où ? On creusera un trou dans un coin perdu et l’eau jetée sur notre tombe sera à peine sèche qu’on saura même plus où c’est. »
La vraie question, ultime, de ce recueil à la fois impressionnant et terrifiant porte sur l’impuissance ressentie devant une telle tragédie, devant une humanité bafouée de cette façon. Ce fut le mérite immense de Sadegh Tchoubak que de nous donner à affronter, dans leur horreur la plus crue, toutes ces vies, prises entre le désastre et la banalité du macabre, sans esthétisation malvenue ni complaisance déplacée. Qu’un peu avant notre ère si avilie par le « gore » et l’hémoglobine un écrivain ait décidé de rendre à la cruauté de la vie son sens littéral – sans jamais verser pour autant dans la crudité gratuite ou l’obscène qui émoustille – a quelque chose d’incroyable. Que les buveurs de sang séché, derrière leurs écrans, pâlissent, pris de honte, quand, devant eux, la vie n’a plus pour elle que les oripeaux pantelants d’un chagrin irréductible autant qu’inexpugnable. Le fait même, prodigieux si l’on y songe, que Tchoubak ait pu rendre au plus près ce bouleversant chaos humain strié de noms propres comme autant de cicatrices sans recours et sans répit montre assez qu’il y avait, tout au bout de sa plume, un peu de la lumière fraîche d’un nouveau matin, celle, inviolable, qui n’a plus peur de rien ni de personne. Il convient de lire ce livre de toute urgence, en espérant qu’un jour, peut-être, la mort chevauchera hors de Perse.



![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)








