L’actualité éditoriale suscite quelquefois d’étranges parallélismes et de non moins singulières divergences. Des deux livres qui ont paru à l’automne 2022 sous le même titre, Blanc, le premier est l’Histoire d’une couleur et s’intéresse à ses nuances, le second le compte rendu d’une ascension qui ne voit du blanc que sa pureté. L’ouvrage de Michel Pastoureau se lit tranquillement d’une traite, tandis que la lecture de Sylvain Tesson souffre difficilement d’être poursuivie au-delà de vingt pages.
Michel Pastoureau, Blanc. Histoire d’une couleur. Seuil, 240 p., 39,90 €
Sylvain Tesson, Blanc. Gallimard, 240 p., 20 €
Comme à son habitude, le ton de Pastoureau est cordial quoique sérieux, évitant soigneusement de paraître confus en se faisant catégorique par endroits. Le procédé a prouvé son efficacité et, dans ce dernier ouvrage, il ne se retourne guère contre son auteur que la fois où il qualifie Henri Gervex de « grand peintre des blancs » à propos de Rolla et de « grand peintre de la femme » en parlant cette fois de Cinq heures chez le couturier Paquin, quand il eût fallu dire l’inverse, ou plus simplement que Gervex n’est pas un grand peintre.
Mais Pastoureau l’annonce dès son introduction : « L’histoire de la peinture est une chose, l’histoire des couleurs en est une autre, bien plus vaste ». Celle du blanc, érudite et éclairante comme il se doit, varie les angles d’approche. L’historien y dispense d’utiles repères ; la robe blanche, par exemple, n’est adoptée par les mariées que dans les années 1830. Il y expose des paradoxes : « le vrai contraire médiéval du blanc n’est pas tant le noir que le rouge ». Il livre d’instructives anecdotes, comme celle du faussaire de Vermeer confondu parce que son blanc de céruse ne comportait pas l’antimoine qu’il contenait encore à l’époque du maître de Delft.

Rien de révolutionnaire, donc, ni dans la forme ni dans le fond, sauf lorsque Pastoureau explique que la literie et le linge blanc avaient autrefois la réputation de favoriser le sommeil, là où « notre époque, qui dort dans des draps et des pyjamas de toutes couleurs, dort mal ». Sans doute parce qu’on n’y avait jamais songé, c’est le type de relation de cause à effet à même de modifier ses habitudes en hâte. L’une des faiblesses inhérentes à ce type d’histoire de la sensibilité tient d’ailleurs à l’usage de l’expression « pendant longtemps », laquelle est moins transparente qu’il n’y paraît dès lors qu’elle n’explicite pas jusqu’au bout ce qui a permis à un comportement de s’inscrire dans la durée, puis de cesser soudainement.
Mais peut-être est-ce là la réaction d’une curiosité qui, à force d’être piquée, imagine qu’elle pourrait être intégralement satisfaite. Curiosité qui ne s’éteint en lisant Pastoureau que lorsque ce dernier arrive à la période contemporaine, pour laquelle l’énonciation des équivalents actuels des menus faits d’autrefois perd nécessairement de son piquant. Ce qui n’empêche pas l’historien d’ouvrir par ailleurs des pistes d’analyse plus structurantes en ce qui concerne justement l’évolution de la symbolique des couleurs.
Deux d’entre elles méritent d’être retenues. La première, technique, porte sur le rôle que l’imprimerie a pu jouer dans l’élaboration de la dualité noir-blanc qui a pénétré les imaginaires au moins autant que les pratiques. La seconde, sémantique, influencée par l’héraldique, porte sur le moment où « les termes de couleur », jusque-là adjectifs, « sont aussi devenus des substantifs : le rouge, le bleu, le vert, le jaune ». Un moment qui pourrait bien être, écrit Pastoureau, celui de « “la naissance de la couleur abstraite” et, par extension, […] d’une véritable symbolique des couleurs ». Moment d’autant plus décisif qu’il rejoint la « fonction première de la couleur » qui « est de classer ». Un classement dont on a progressivement inféré des évidences, qu’on a, par la suite, supposées naturelles, et sur lesquelles on s’est mis à projeter des rêves et des prières jusqu’à les broder en ouvrages.
Sous ce rapport critique, l’histoire fait œuvre utile lorsqu’elle permet de surprendre la littérature en train de courber la matière historique à son profit, comme dans le cas de l’un des trois exergues que Tesson a choisis pour son livre, tiré de Rabelais : « Le blanc, donc, signifie joie, plaisir et liesse, et signifie cela non à tort, mais à bon droit et à juste titre. » Extraite des premières lignes du chapitre 10 de Gargantua, cette citation prend un sens un peu différent, plus ironique, et finalement assez cruel pour l’emprunteur, si l’on se fie à Pastoureau rappelant qu’au précédent chapitre Rabelais raille précisément la symbolique des couleurs qu’entendait imposer un traité « trepelu » (très peu lu) publié anonymement à la fin du XVe siècle : Le Blason des couleurs. Rabelais feint de se demander « qui l’a faict ? », assurant que « quiconque il soit, en ce a été prudent, qu’il n’y a point mis son nom. Mais au reste, je ne sais quoi premier en lui je doive admirer, ou son outrecuidance, ou sa bêterie ».
Sylvain Tesson, pour sa part, ne cherche pas à savoir ce qu’est le blanc, il recherche « le Blanc », avec sa majuscule, juste « le Blanc », parce qu’il sait ce qu’il est, la pureté, dans laquelle il veut errer jusqu’à se confondre avec elle comme on communie avec la nature – jusqu’à se dissoudre dans un monde qu’il répète « sans contours », à l’image du Christ, que l’orthodoxie répute lui aussi « sans contours ». Nul besoin d’insister sur la religiosité de l’auteur puisqu’elle est en vérité le motif principal de son écriture. « Mon rêve, longtemps poursuivi, s’accomplirait peut-être : du voyage faire une prière. » Telle est en effet l’ambition affichée par Tesson dans son avant-propos, intitulé « Que faire ? », une référence qui cite moins Lénine qu’elle ne suinte l’ennui. À peu près tout est là, dans l’ordre qui plus est : l’aspiration religieuse motive un texte dont le sous-texte ne cache rien de son orientation politique, tandis que le voyage n’est, tout compte fait, qu’un prétexte.
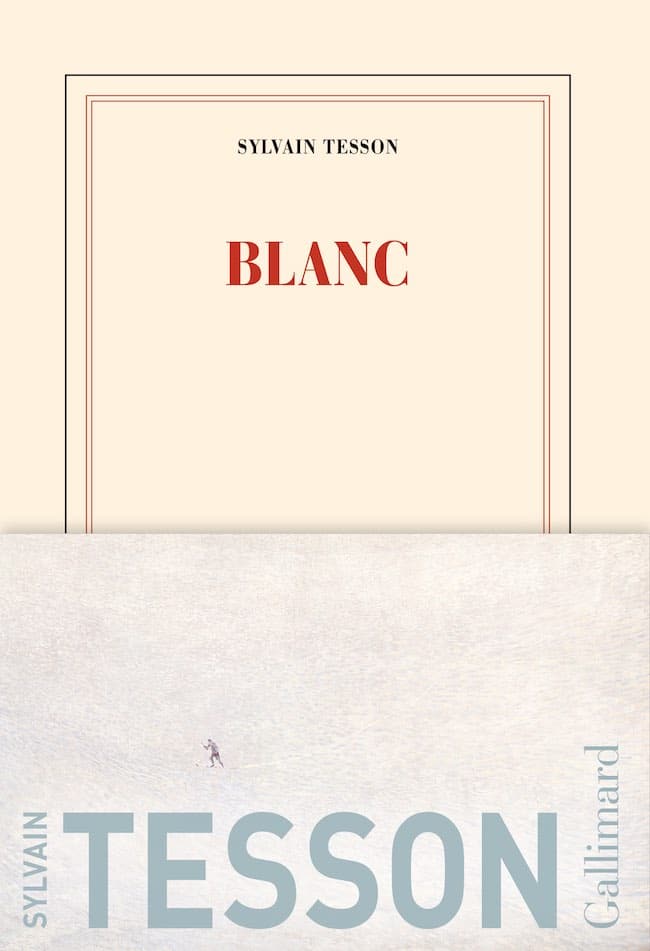
Un prétexte, parce que l’écriture de Tesson appartient avant tout à ce qu’il faut bien appeler la littérature d’émaillage, qui consiste à émailler sa relation de citations, que l’excursionniste dresse en listes. Le premier jour, par exemple, à peine a-t-il le temps de se lécher « l’index car la mer est le sel de la Terre » (dont on ne sait ce qui est le plus drôle, du geste ou de la phrase) que Daniel Du Lac, son ami guide, lui intime de prendre la route. À quoi Tesson ajoute in petto : « J’en connaissais moi aussi des phrases pour les départs », et de citer Rimbaud, Montaigne, « Mme Despentes » (pourquoi ?), Gide, et enfin, « la plus belle, du Christ, dans l’Évangile selon Matthieu : “Viens et suis-moi” », qui n’est pas sans rappeler le « Toi, suis-moi » (Jean, 21) qu’en son temps Mgr Barbarin s’était choisi comme devise cardinale.
Plus que des coïncidences, la véritable surprise provient de la facilité avec laquelle la littérature d’émaillage s’accorde avec celle de voyage, au point qu’elles sont tout près, désormais, de conformer un seul et même genre chez tous ceux qui, ayant beaucoup lu et beaucoup voyagé, s’estiment fondés à beaucoup écrire. L’inflation du mot « enquête » dans le domaine universitaire et celle du mot « quête » parmi les littéraires en sont un seul et même symptôme, chacun lorgnant de plus en plus ouvertement du côté de la police et de la prêtrise, quand ce n’est pas les deux, comme si toute la littérature était devenue « de voyage », quel que soit l’échelon auquel on se représente « l’aventure ».
Mais c’est chez Tesson que le genre assume sa véritable fonction extra-littéraire, celle de faire passer des idées, de les faire passer en passant, sans en avoir l’air, puisqu’on a celui de voyager, comme si l’on n’avait d’autres idées que celles qu’éveille la rencontre avec les éléments. Or, le blanc étant la teinte de l’élémentaire, la montagne enneigée revêt la valeur du lointain le plus désirable. Mais là encore, ce que l’auteur dit désirer diffère de ce qu’il vise, car le lointain de Blanc n’est finalement que le nom que son auteur a donné au passé, un passé sans plus de rapport avec l’histoire que l’émail avec ce qu’il rehausse, un jadis abstrait et absolu avec la blancheur pour emblème.
D’où sa manie de tout conjuguer au passé, qui confine au pastiche sans que l’on parvienne à déterminer ce qu’il pastiche, et la tournure immanquablement artificielle que prend sa conjugaison du passé, trahissant dans les deux cas qu’en réalité il ne parle pas du passé mais du rêve qu’il nourrit d’en posséder un. De cette manière et par elle, Tesson se fait le porte-voix de toute une génération qui, ayant joué dans sa jeunesse avec les repères, se croit perdue, et conçoit de ses échecs la nostalgie la plus mobilisatrice qui soit : celle qui n’a pas d’objet. L’écriture de grognard qui l’alimente, dont le charme vient de ce qu’elle allie au mode épique le style rédactionnel, résonne avec son époque – avec l’époque qu’elle n’est pas seule à fantasmer – parce qu’elle met à sa portée le mystère qu’elle entend protéger en rendant accessible l’inaccessible –, que le terme caractérise la haute montagne ou la haute littérature. Dès lors que le charme est brisé et les apparences sauves, pourquoi ne pas abuser de ce qui reste de l’art, en l’occurrence ses prétentions sur la réalité, puisque après tout il ne s’agit à travers lui que de « faire voyager » ?
Aussi peut-on baguenauder parmi les fortins de la frontière franco-italienne en écrivant que « dans ces sapinières pour reine des neiges, les batailles avaient servi à fixer les frontières d’une nation où vivaient aujourd’hui des citoyens tranquilles qui n’aimaient pas les frontières ». Le baroudeur ne se prononce pas plus avant sur les raisons de ce désamour, ni ne juge apparemment les « militants [qui] accueillaient les exilés du Sahel et du Proche-Orient » lorsque lui-même frayait dans les parages. En revanche, on comprend que le mot « exilés » n’est pas choisi au hasard, car « ces migrants ne migraient pas », explique l’écrivain-voyageur qui ne sait manifestement pas de quoi il parle, mais qui sait pourtant très bien ce qu’il dit : « Ils fuyaient à jamais la guerre d’islam. Seules les rives chrétiennes leur donnaient une chance. » C’est là une phrase qui mériterait qu’on s’y arrête. Ou, pour être tout à fait honnête, c’est une phrase qui mérite qu’on s’arrête là, page 23 de Blanc.












