Entre l’École navale et la rue d’Ulm, Michel Serres s’est longtemps cherché. À défaut d’une brillante carrière universitaire, il obtint la reconnaissance de ceux que ses livres et sa voix fascinaient, quelques groupes d’étudiants, puis de nombreux auditeurs de la radio et téléspectateurs. Via la Californie, cela le mena vers l’Académie française et la dignité de grand-croix de la Légion d’honneur. Bref, une position enviable de penseur officiel.
Michel Serres, Œuvres complètes 1. Cahiers de formation. Le Pommier, 1 515 et CLXIII p., 45 €
Outre son charme incontestable, la force de Michel Serres éclata lorsqu’il comprit qu’il ne devait pas hésiter à raconter la philosophie sur le mode d’une merveilleuse histoire. La majeure partie de ses auditeurs auraient été incapables d’évaluer la justesse de tel ou tel de ses brillants rapprochements. Il disait que le modèle scientifique de Lucrèce était celui auquel sont venues les modernes théories du chaos. Les auditeurs étaient séduits mais incapables d’en juger en raison. Tenu pour irrationnel deux millénaires durant, le clinamen devenait-il compréhensible avec le nombre de Reynolds qui mesure la viscosité d’un flux ? L’hypothèse était séduisante, mais que dire de plus ?

Michel Serres © Basso Cannarsa/Opale.photo/Éditions Le Pommier
La carrière éditoriale de Michel Serres peut être caractérisée par l’acceptation progressive du jeu de la narration fascinante. Lui qui avait commencé avec la technicité des 836 pages de son Système de Leibniz et ses modèles mathématiques (1968) conquit la notoriété estudiantine avec la série de ses Hermès (cinq volumes entre 1969 et 1980) publiée par Jean Piel, avant d’élargir son lectorat vers les auditeurs de France Culture qu’il régalait de chroniques présentées sous son seul prénom, son accent chantant d’Agen le rendant aisément identifiable pour qui l’avait déjà entendu. Et puis il partit pour l’Amérique et pour la télévision, avant d’être couronné immortel.
On ne peut même pas dire qu’il ait été un vulgarisateur. Avec lui, la « science de ce matin » devenait objet d’une fascination quasiment romanesque. Non qu’on l’ait mieux comprise, mais on se disait qu’il devait y avoir de ce côté-là des choses passionnantes. On peut lui savoir gré d’avoir donné cette image ensoleillée à un travail scientifique souvent perçu comme austère. Mais c’est aussi ce qui a conduit la philosophie universitaire à ne pas le reconnaître pour un des siens. Il faut dire que lui-même avait dit la « haïr ». Ses cours, qui s’apparentaient plutôt à des conférences, ont pu être donnés à Vincennes ou dans des lieux aussi prestigieux que la rue d’Ulm, mais toujours décalés par rapport à la Sorbonne. Il put certes être accueilli chez un Vladimir Jankélévitch qui, à défaut d’être connu pour ses travaux de philosophie des sciences, l’était pour son exceptionnelle ouverture d’esprit. Ce fut pour évoquer Jules Verne, dans la lignée intellectuelle de qui il s’est inscrit presque explicitement.

Banc offert au Jardin des Plantes par Michel Serres (2011) © CC3.0/Martin Greslou/WikiCommons
La publication de ces Cahiers de formation a quelque chose de particulièrement émouvant quand on sait combien Michel Serres a peiné à trouver la voie de ce qui allait devenir un grand et prestigieux succès. Faut-il voir une maxime dans cette sentence d’octobre 1962 (il a trente-deux ans) : « La rigueur est devenue l’alibi des idéalistes irrationalistes » ? Lorsqu’il dit haïr l’Université, il en donne pour explication que « ces gens estiment l’exploit », ils « estiment le difficile plus que le vrai ». Et il ajoute ce petit apologue (p. 526) : « L’auteur : voyez mon exploit, je lis l’allemand, je pratique Bourbaki […] je sais comment l’école polonaise écrit le russellien. Le lecteur : j’admire l’exploit puisque, si je voulais comprendre, il me faudrait six ans ». Le fond du problème, c’est que ce savoir extra-philosophique dont se vante le philosophe universitaire est « banal pour le mathématicien, le linguiste, le philologue ». Autant dire que « la philosophie qui est en jeu derrière ce paravent comique est évidemment inexistante : mais on fait carrière » et il nomme un professeur au Collège de France dont le nom n’a jamais été connu d’un très large public mais qui était fort estimé dans la profession du fait de cet exploit intellectuel : il n’aimait « que les livres écrits en anglais, allemand, italien, quelle que soit leur valeur ».
Un tel recueil a quelque chose d’ingrat pour celui à qui il est supposé rendre hommage. Beaucoup de remarques que l’on confie à un carnet intime peuvent apparaître naïves à un lecteur extérieur. Ainsi de cette page sur les supplices entre lesquels Serres voit comme point commun d’être des « retranchements », une « exclusion du groupe social ». Cette page non dénuée d’intérêt, qui attend un développement plus substantiel, se conclut sur cette note qui appelle un sourire vaguement méprisant : « J’ai écrit cela deux mois avant de lire la thèse de Foucault sur la folie ! » (p. 302-303). Il y avait aussi des naïvetés de cet ordre dans les Carnets de captivité que Levinas a remplis à peu près au même âge que Serres les siens, quoique dans de tout autres circonstances. Mais la naïveté, dans l’affaire, est moins du côté de qui confie ses hésitations et ses difficultés à un carnet intime que du lecteur qui s’étonne d’y découvrir des pensées juste ébauchées, des amertumes, des irritations – et aussi le désappointement de qui se voudrait un penseur original. C’est la publication même de pareils Cahiers de formation qui fait problème : sert-elle vraiment l’auteur ainsi célébré ?
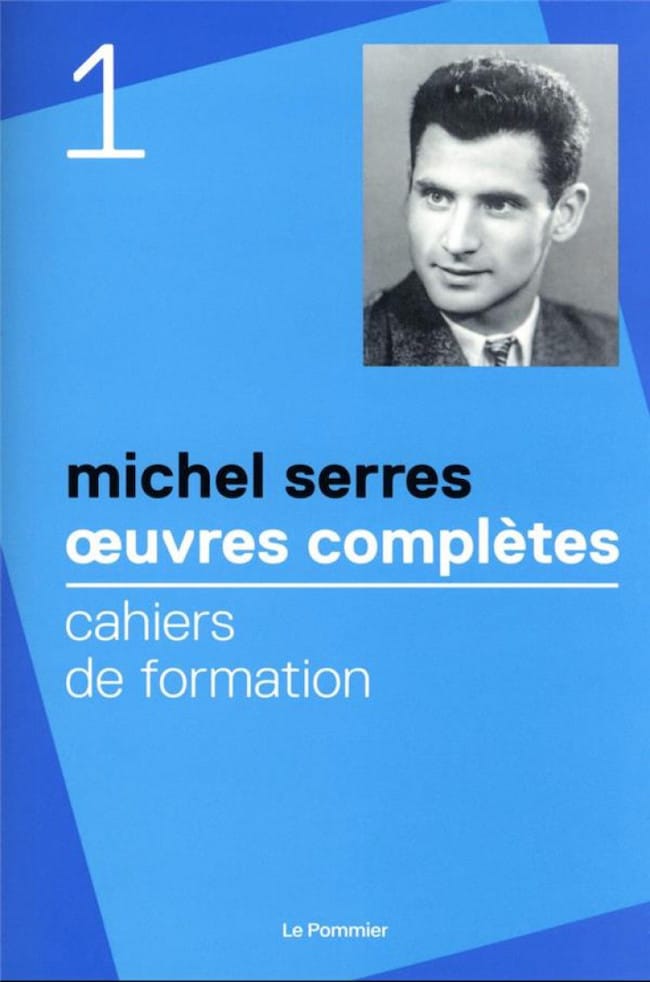
Sur un point au moins, elle apporte une clarté inattendue : la haine de l’Université. Déjà parce que l’on comprend que celle-ci était donc partagée et que, du côté de Serres, elle était bien antérieure au moment où il en subit le « retranchement ». Il se l’était formulée, certes pour lui seul, à un âge où l’on a encore des chances d’être appelé à y enseigner. Et surtout, les raisons qu’il donne à cette haine ont une portée fondamentale. Cette critique, qu’il n’a jamais émise publiquement avec une telle vigueur – pour ne pas dire violence – peut être partagée par de tout autres que Michel Serres. Non qu’elle doive forcément être approuvée mais il est de fait qu’elle touche là un point sensible. Elle le touche si bien que toute sa carrière d’auteur a été construite en réaction presque terme à terme contre ce qu’il dénonçait alors. Et son incontestable réussite éditoriale vaut pour preuve. Si le lecteur attentif avait senti cela, il n’avait pu deviner que les choses étaient si claires dans l’esprit de Serres, si précocement. Telle est l’émotion que suscite la lecture de ces Cahiers : nous faire découvrir en gésine ce que nous avions vu dans une forme accomplie.












