Impressionnant et remarquable, le livre que Yannick Le Marec publie sous le titre Le grand pillage n’est pas seulement une étude documentée et précise des pratiques de vol systématique auxquelles se livrèrent les Occidentaux, et parmi eux les Français, au cours de leur immense entreprise colonisatrice du XIXe siècle en Extrême-Orient (Indochine et Chine essentiellement). L’auteur de Constellation du Tigre y évoque notamment les figures des marins-écrivains Pierre Loti et Victor Segalen ; le second est également le sujet d’un récit de Christian Doumet.
Yannick Le Marec, Le grand pillage. Arléa, 208 p., 18 €
Christian Doumet, Segalen. Arléa, 112 p., 9 €
Rien de froid ou de simplement documentaire dans ces pages pleines du bruit de combats à armes inégales et de la fureur contenue qu’inspirent à Yannick Le Marec des actions authentiquement barbares mais que bien peu de gens, à l’époque, jugeaient scandaleuses. Un texte engagé, donc, accusateur, mais dépourvu pourtant de dérive polémique, tant il est porté par un désir patent de vérité.
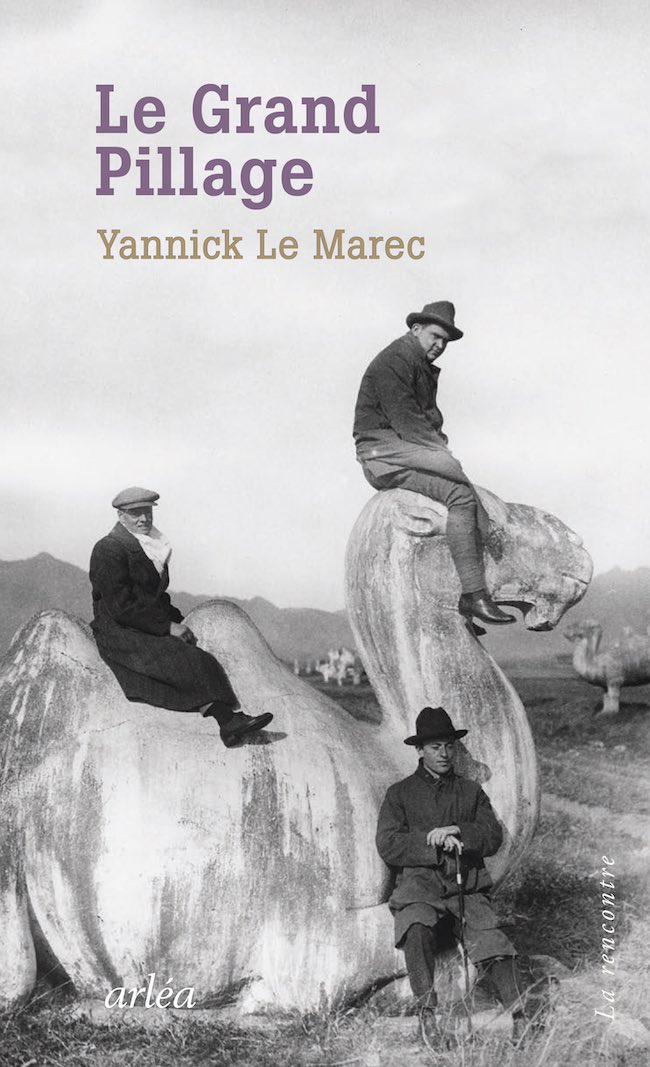
La Chine, notamment, dès que la faiblesse militaire de sa dernière dynastie, mandchoue, celle des Qing (qui avait vaincu les Ming en 1644), a été révélée par les guerres de l’opium menées d’abord par les Anglais seuls, est en proie aux convoitises occidentales. En 1859, le Yuanmingyuan, ou palais d’été des empereurs tout près de Pékin (350 hectares de jardins et de bâtiments somptueux), pris par le corps expéditionnaire franco-anglais, sa garnison massacrée, est pillé puis détruit (1860) par le valeureux lord Elgin, nommé deux ans plus tard vice-roi des Indes : toute une épopée de panache et de sanie qui envoya en Europe, par bateaux entiers, les trésors chinois volés.
Mais il est vrai que la Chine était alors un empire vermoulu, archaïque et féroce, où les mandarins profiteurs du régime sur le dos de la paysannerie n’aidaient en rien les rares réformateurs de l’entourage du jeune empereur à rafistoler à temps le système impérial, à la différence de ce qui se passa au Japon en 1868 avec la révolution de Meiji. La suite inévitable de la tentative de dépècement du pays par l’Occident en crue, c’est près d’un siècle de formidables soubresauts, jusqu’à la victoire de Mao et l’instauration d’une pseudo république « aux couleurs de la Chine », celles de la dictature, as usual. Processus dans lequel la responsabilité initiale de l’Occident est clairement engagée.
Outre son rappel de ce rôle funeste, et son enquête fouillée sur le sort des biens culturels arrachés par la force brute aux passés (fort peu égalitaires) des vieilles dynasties, l’intérêt principal de ce livre réside dans la mise en lumière de ce qu’a été réellement le colonialisme vécu, en partie fondé, dans la partie intellectuelle de la population diverse des colonisateurs, sur un dévoiement de leur amour prétendu pour l’autre, le différent, l’ailleurs.

« Canot en mer avec marins ramant ; l’un d’eux tire du canon ». Dessin de jeunesse de Pierre Loti © Gallica/BnF
Ce dévoiement est brillamment éclairé par l’examen psychologique bienveillant mais lucide des personnalités de deux écrivains français que beaucoup de considérations biographiques rapprochent (tous deux exemples de promotion sociale due au seul mérite ; tous deux provinciaux, Julien Viaud, dit Pierre Loti, né à Rochefort en 1850, Victor Segalen né à Brest en 1878 ; tous deux issus de la marine militaire, l’un comme élève de l’École navale, l’autre comme médecin).
Ce qui les meut l’un comme l’autre, à une génération d’écart, c’est l’obsession du départ, c’est-à-dire avant tout le désir d’échapper à l’étroitesse d’enfances enchaînées à l’environnement quotidien, à la répétition sempiternelle, au christianisme oppressant de la Bretagne (pourtant fortement païenne, mais les légendes et la statuaire locale n’ont jamais intéressé Segalen), au train-train des affections pesantes des chères tantes qui accueillent pourtant avec toute leur tendresse l’enfant-roi Loti à Saint-Pierre-d’Oléron. L’espace ouvert les attire, et aussi l’interdit, le travestissement pour Loti, et pour tous les deux l’opium.
Loti est plutôt sympathique : il aime et protège les animaux, plaint les pauvres, ne cache pas, dans ses œuvres de reportage, le caractère abominable des massacres auxquels se livrent, en rigolant, les commandos de marine qu’il dirige au moment où, en 1883, s’achève à Hué la conquête de l’Annam, dont il rend compte, dans Le Figaro, avec une telle objectivité journalistique que cela lui vaut un rappel et un blâme de sa hiérarchie. Et il n’est pas très fier d’avoir, dans ses débuts comme marin, participé au vol, à l’île de Pâques, de la tête d’un moa géant qui aujourd’hui orne l’entrée du musée du Quai Branly.
Au fond, Loti est un ingénu, et un fataliste, ce qui l’arrange bien. Que faire contre des soudards déchaînés, même et surtout si ce sont des compatriotes ? Ils contreviennent sans nul doute aux lois de la guerre et ça n’est pas bien. Mais c’est que lui-même croit aux lois de la guerre. Il lui faudrait être beaucoup plus intelligent (et cynique) pour comprendre que, tout comme la conscience universelle selon Anatole France, elles sont d’autant plus impératives (et utiles comme contrepoids virtuel à la bestialité humaine) qu’elles n’existent pas.

Photographie prise en Chine par Victor Segalen lors d’une mission archéologique à Baoji (1914) © Gallica/BnF
Segalen croit-il aux lois de la guerre ? Gageons que non. Lui est un intellectuel – et un artiste – de haut vol et il n’a que mépris pour Loti qui, mort en 1923, lui survivra quatre ans. Il exècre son sentimentalisme, ses descriptions, sa mélancolie fin de siècle à l’expression un peu faiblarde et, sur le plan littéraire, il est évident que le romancier des Derniers jours de Pékin (1902) et le poète de Stèles (1912) ne jouent pas sur la même marelle.
Mais il y a chez Segalen un aristocratisme de l’art et de la pensée qui, le plus souvent, masque en lui – il est vrai médecin, à une époque effroyable où il n’y a aucun médicament efficace, et où la chirurgie, qu’il pratique, ignore ou peu s’en faut l’anesthésie – ce que sa profonde aptitude à la tristesse pourrait recouvrir de capacité à l’empathie. Ce poète altier malgré une extraction basse n’avait cependant que répugnance pour « le peuple », ce qui se voit crûment dans son indifférence à l’égard des coolies chinois. Pour lui, la Chine, c’est l’empire fantasmé, la Cité interdite aux manants. Sincère, ce parti pris de grandeur serait odieux s’il n’était aussi et peut-être surtout enfantin.
On y repère tellement, par exemple dans certaines Stèles magnifiques concernant le Fils du Ciel (je vous demande un peu, et moi je suis la reine d’Angleterre !), un désir presque naïf d’échapper à la condition de petit médecin de la coloniale pour flotter, avec les merveilleuses chimères découvertes dans le loess chinois au cours de la fameuse équipée de 1909 en compagnie de son riche sponsor Gilbert de Voisins, dans l’empyrée de Mille et Une Nuits exotiques, que ce rêve en devient conte bleu malgré une organisation, sinon scientifique au moins rationnelle, du grand voyage aventureux.

Victor Segalen par Louis Talbot (vers 1904)
L’excellent écrivain et chercheur Christian Doumet, dont l’écriture à la fois limpide et poétique est un enchantement, publie aux éditions Arléa un Segalen de moins de cent pages où il donne de l’auteur un portrait aussi séduisant que convaincant. Il y fait la part belle à une sensibilité toujours aussi mystérieuse depuis la mort solitaire en forêt de Brocéliande du médecin qui avait seulement déclaré, un peu auparavant, courageux et sobre : « Je sens la vie s’éloigner de moi » et qui lisait Hamlet dans le coin sauvage où on le retrouva mort en 1919.
J’espère que Christian Doumet ne m’en voudra pas de montrer moins d’enthousiasme que lui envers le poète (indiscutablement majeur) qu’il a édité dans la Pléiade. Il raconte si finement l’étrange entrevue qui réunit à Bordeaux, le 21 octobre 1914 (la guerre a déjà produit du côté français d’horribles ravages parmi les pioupious joliment habillés de rouge par la stupide gloriole de nos généraux), l’ancêtre Claudel, Segalen et le débutant Saint-John Perse, encore Alexis Léger et qui n’aura jamais pour Claudel (je le comprends) la moindre sympathie !
Le talent littéraire du laudateur rendrait presque fraternel un homme qui ne se reconnaissait comme semblables que peu d’élus, et dont la participation au pillage des chefs-d’œuvre de Chine, bien que vénielle, fut effective.












