Disons-le tout de suite : voici un livre entraînant, qui vous embarque et qu’on ne repose pas avant de l’avoir terminé. Très bien écrit et traduit, il se lit comme un véritable « page turner ». La thèse qu’il porte est forte et séduisante, et elle est relativement neuve – en France du moins : entre les deux grandes périodes de colonisation de son histoire, celle de l’Ancien Régime et celle de la IIIe République enfin républicaine, entre 1815 et 1880 environ, ce ne serait pas le vide et l’abstention coloniale que l’on décrit d’habitude, mais une autre forme de domination impériale que la France exercerait dans plusieurs régions du monde. Un empire « soft », informel : un « empire de velours », propose l’auteur en jouant sur les différentes acceptions de ce mot [1].
David Todd, Un empire de velours. L’impérialisme informel français au XIXe siècle. Trad. de l’anglais par Joseph Félix. La Découverte, 318 p., 24 €
À la veille de la Révolution, la monarchie française ne conservait guère de son vaste empire colonial de jadis que l’île de Saint-Domingue, la perle des Antilles, pourvoyeuse des richesses sucrières : le traité de Paris de 1763, qui terminait la guerre de Sept Ans, lui avait enlevé le Canada, la Louisiane et l’Inde. Sous la Révolution, la France perdait encore Saint-Domingue, devenue la république indépendante d’Haïti en 1804 après l’échec de la reconquête tentée par Bonaparte.
Puis, tandis que Napoléon tentait d’édifier sur le continent européen un empire d’une autre sorte, les Anglais se saisissaient des dernières possessions coloniales françaises. Lors du retour de la paix en 1814, ils conservèrent l’île Maurice, de sorte que la France ne détenait plus outre-mer, en 1815, que des confettis : les deux îles des Antilles, la Guyane et l’île de la Réunion (Bourbon), ainsi que quelques comptoirs au Sénégal et en Inde.

25 octobre 1836 : l’obélisque de Louxor est installé sur la place de la Concorde © Gallica/BnF
Au cours de la période suivante, sous les régimes successifs de la Restauration, de la monarchie de Juillet et du Second Empire, cet « empire » résiduel allait s’accroître un peu cependant : de l’Algérie principalement, de 1830 à 1847, de Mayotte (1841), de la Nouvelle-Calédonie (1853), de la Cochinchine en 1862. Mais ce n’était rien de comparable aux immenses territoires américains de l’ancien empire, ou africains du nouvel empire. Le véritable empire de la France, dans cette période intermédiaire, n’était pas territorial ni conquérant, mais d’une essence plus subtile : doux et cynique à la fois, relevant d’une « cunning strategy » fondée sur la séduction, pour citer les prospectus des éditeurs du livre.
De cette stratégie, l’auteur décrit, au long des cinq chapitres thématiques de son livre, les intentions et les motivations, les moyens et les avatars, les conséquences, les impasses et les tribulations parfois, l’échec ultime enfin. Il mobilise pour cela des sources très diverses, économiques, littéraires, politiques, judiciaires, ainsi qu’une bibliographie impressionnante, de langues française et anglaise surtout. Il tire de cette vaste matière une foule d’exemples, de cas, d’anecdotes qui donnent vie à son étude : celle-ci, pour savante et systématique qu’elle soit, n’est jamais ennuyeuse.
Le chapitre d’ouverture traite de la Restauration et du règlement de la question d’Haïti en 1825, mais surtout de la mise en place des notions intellectuelles qui serviront à fonder et à justifier cet empire d’un nouveau type. Dans le rôle des inventeurs du « néocolonialisme », entrent ainsi en scène Talleyrand, l’abbé de Pradt, Guizot, voire des libéraux patentés comme Benjamin Constant et Jean-Baptiste Say, puis, au fil des décennies, Michel Chevalier et son gendre, Leroy-Beaulieu – le débat sur le libre-échange, objet d’un ouvrage antérieur de l’auteur, se déploie ici de nouveau [2]. Talleyrand, revenu depuis peu des États-Unis, et constatant le maintien de liens économiques puissants entre l’ancienne métropole et ses colonies récemment émancipées, en tirait argument devant l’Institut, dès 1797, pour proposer la création en Afrique de colonies d’un type nouveau, autonomes et sans esclaves : liées à la France par un intérêt commun, elles pourvoiraient à ses besoins en plantes tropicales sans lui imposer le poids du gouvernement, celui-ci étant délégué à l’élite locale. C’est la logique qui conduit Talleyrand, devenu ministre des Relations extérieures, à plaider avec force l’année suivante pour l’expédition de Bonaparte en Égypte. Ce schéma se retrouvera peu ou prou chez ses successeurs, à commencer par Pradt à propos des colonies espagnoles, avec des nuances tenant notamment aux préjugés relatifs à la capacité des Noirs à se gouverner.
La Restauration se termine en 1830 avec la prise d’Alger, et le second chapitre est consacré entièrement à la politique suivie en Algérie ensuite. Or, celle-ci semble défier la thèse de l’empire informel : après l’occupation de quelques positions côtières, présentée comme une simple mesure de représailles à de mauvais procédés du dey envers la France, c’est toute la régence d’Alger et son arrière-pays qui auront été conquis en 1847, au prix d’immenses souffrances humaines et de grandes dépenses. On est loin du velours ! Comment expliquer cette contradiction ? Todd répond de façon ingénieuse et convaincante à cette question. Seules les circonstances auraient fait obstacle à la mise en œuvre d’un projet qui s’inscrivait bien d’abord dans la logique informelle : sitôt le régime de Juillet bien installé, il avait tenté de fonder une sorte d’association avec l’émir Abdelkader, déléguant à ce dernier le gouvernement de l’intérieur, tandis que la France tiendrait les ports et les échanges, ainsi qu’une bande littorale vouée à une agriculture que l’on imaginait tropicale (traité de la Tafna, 1837). Des événements imprévus, dus surtout à l’émir, firent échouer cette politique. De sorte que cette anomalie, loin de contredire la règle énoncée dans le livre, représente finalement l’exception qui la confirme. Napoléon III devait d’ailleurs revenir en partie, sous la forme du royaume arabe, à la conception initiale, avant que la chute de l’Empire n’inversât à nouveau cette politique. Mais au bout du compte, que ce soit en termes de peuplement ou de résultats financiers, l’implantation algérienne se révélera un échec, justifiant a contrario le bien-fondé de la stratégie alternative.

Affiche du magasin Paris-Mode (1891) © Gallica/BnF
Cette objection préalable levée, l’auteur en vient aux formes et aux moyens que prend l’empire informel. D’abord, ce qu’il appelle le « capitalisme ostentatoire » (chapitre 3). Tandis que l’industrie lourde britannique domine le monde, la France a trouvé une sorte de niche très lucrative. Le champagne, les industries de luxe, les soieries, les « articles de Paris », connaissent une croissance très rapide – les échanges mondiaux s’intensifient rapidement entre 1840 et 1870, grâce au libre-échange, mais la valeur des exportations de la France progresse alors deux fois plus que celle des exportations de la Grande-Bretagne. Le prestige sans égal de Paris, qui a repris en quelque sorte le rôle de modèle tenu par la cour avant la Révolution, rayonne à l’étranger, créant un « désir » de produits français, de culture française, de séjours en France : facteur de prospérité difficile à quantifier mais indéniable. L’exposition universelle de 1867 en offre les derniers feux.
Le chapitre 4 traite d’un enjeu qui a fait couler beaucoup d’encre depuis longtemps : les prêts consentis par la France à des États étrangers, à commencer par les fameux emprunts russes qui ont ruiné tant de petits épargnants en 1919. Ces emprunts n’entrent pas dans le cadre temporel du livre, mais ils avaient été précédés de beaucoup d’autres assez comparables : mobilisation d’une épargne abondante, en impliquant des couches très larges de la population, au service d’intérêts politiques. Les sommes prêtées sont le moyen de s’attacher des gouvernants étrangers – mexicains, turcs, égyptiens notamment –, voire de leur tenir la bride courte en cas de banqueroute ou de restructuration. Politique hasardeuse néanmoins, très différente de celle préconisée par Londres, et qui ruina plus d’un épargnant longtemps avant le défaut de la Russie soviétique. Talleyrand lui-même, habile spéculateur pourtant, laissa des plumes en 1825 lorsque le règlement de l’affaire d’Haïti entraîna la faillite de la banque Paravey.
Le dernier chapitre est consacré presque entièrement à l’Égypte. Celle-ci, sous l’autorité d’un vice-roi (khédive) indépendant de fait de la Porte, Méhémet Ali jusqu’en 1849 puis Saïd et Ismaïl, avait tissé des liens étroits et amicaux avec la France, sur le fond des souvenirs napoléoniens. Des symboles comme la girafe de Charles X ou l’obélisque de Louxor les avaient renforcés, et Paris avait failli faire la guerre à l’Europe en 1840 pour soutenir Méhémet contre le sultan. L’ouverture du canal de Suez en 1869 sera le couronnement de cette idylle. La langue française avait remplacé l’italien, le droit français supplanté le droit musulman ; les échanges personnels étaient nombreux, étudiants égyptiens en France, spécialistes français « expatriés » en Égypte. Ce que montre Todd ici, c’est la tentation, du côté français, d’abuser de la situation au moyen de tribunaux particuliers, de consuls indiscrets, d’experts cupides, etc. En définitive, l’excès des dépenses incontrôlées et l’abus du crédit entraînèrent une banqueroute puis, à terme, l’installation, bien formelle celle-là, des militaires anglais sur le Nil en 1882.
L’empire de velours montre ses limites au terme de la période couverte par ce livre. La dépression commence en 1873, pour un quart de siècle. Le libre-échange fera place au protectionnisme. En période de contraction économique, le marché du superflu fait régresser le premier, et le créneau occupé par la France est affecté. Diverses évolutions techniques concurrencent de surcroît son monopole. L’heure des marchés protégés et des empires coloniaux revient alors, l’Afrique est partagée entre les puissances lors du congrès de Berlin de 1884.

Réclame pour les champagnes Debray (1891) © Gallica/BnF
« L’empire de velours » français n’aura-t-il été qu’une parenthèse due à la concomitance de facteurs aléatoires ? un lot de consolation reçu comme une aubaine après la déconfiture de 1815 ? Est-il au contraire le modèle reproductible d’une politique rationnelle et délibérée ? L’un et l’autre sans doute : le produit d’une analyse pertinente des chances et des limites inhérentes à ce moment de l’histoire.
Une contrainte impose sa nécessité : la domination britannique sur les mers. À défaut de pouvoir la renverser, comme Napoléon l’avait tenté, reste à en tirer avantage, à jouer le rôle d’une sorte de junior partner et à commercer sous la protection de la pax britannica. Il n’y a pas d’alternative militaire de toute façon sur le continent, où les vainqueurs de 1815 veillent jalousement, tandis que Londres, n’ayant plus rien à craindre, trouve intérêt à coopérer.
En contrepartie, la France suivra plusieurs fois la Grande-Bretagne sur le terrain militaire, à Navarin, en Crimée, lors de la guerre de l’opium en Chine, voire au Mexique ; tandis que Londres laisse faire la France, en Algérie, dans le Pacifique, comme plus tard en Savoie. Les vives tensions de 1840 seront surmontées. L’entente cordiale représente le versant diplomatique de l’empire de velours.
Autre limite manifeste, la démographie. La France n’a pas de colons à exporter par millions, à la différence de l’Angleterre, qui peuple alors l’Australie et la Nouvelle-Zélande. À défaut de peupler des territoires qu’elle ne possède pas de toute façon, il lui reste à vendre du luxe et à exporter du prestige.
Du côté des chances, en effet, le « désir de France » : il remonte à l’Ancien Régime, mais il a été renouvelé par l’aura de la Révolution et surtout de l’Empire – le droit nouveau, la langue diffusée partout, l’art, la littérature – et par les migrations humaines qui ont suivi ; mais renforcé avant tout, selon Todd, pour les élites solvables en tout cas, par l’image conservatrice et rassurante des monarchies françaises de la période.
Reste à se demander si la notion d’empire informel n’est pas un peu trop extensive, en ce qu’elle réunit des situations assez différentes. Laissons de côté l’Algérie. Mais peut-on considérer de la même façon le cas d’Haïti et ceux de la Turquie ou de l’Égypte ? En 1825, le gouvernement de Charles X met le couteau sous la gorge de la république noire pour lui extorquer les millions destinés à indemniser les planteurs : le message des canons des navires de Mackau est sans ambiguïté. On trouvera le même recours à la force dix ans plus tard dans le Río de la Plata. Le gros bâton très « formel » continue la politique de la carotte « informelle » si nécessaire ! Cette tradition se poursuivra longtemps, en Chine notamment, et jusqu’à Suez en 1956.
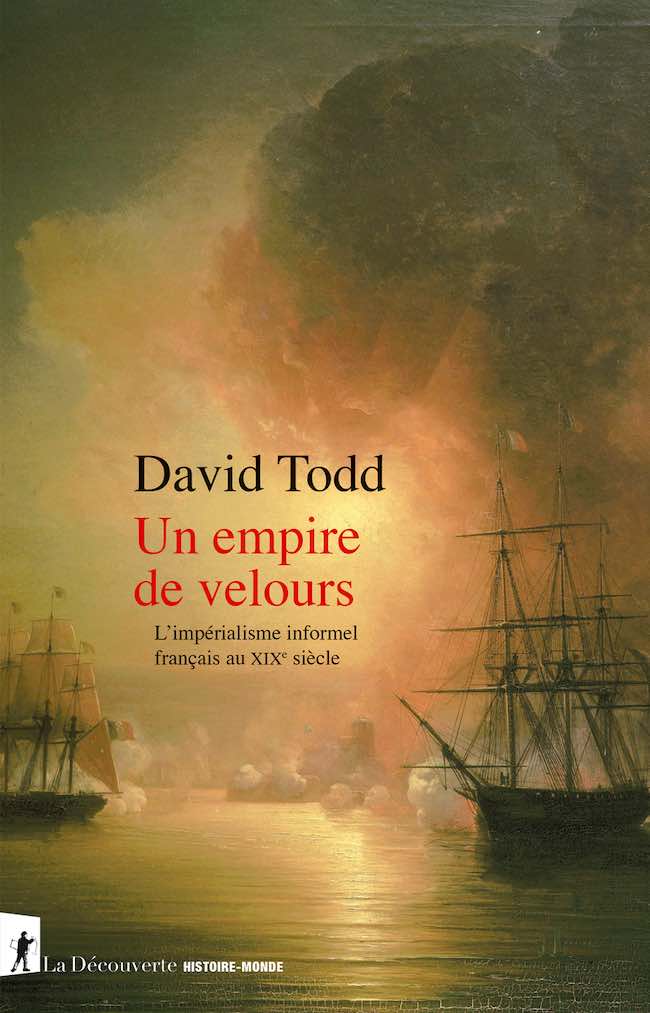
La notion de protectorat, explicite au Cambodge, implicite au Mexique, voire en Égypte, peut recouvrir aussi des réalités très diverses. Elle aurait pu s’appliquer, pour cette période, à la Grèce, devenue indépendante en droit en 1829, mais tenue de fait en tutelle à cause de sa situation financière : son cas aura été laissé de côté parce que la France n’est là qu’un acteur secondaire, en arrière de l’Angleterre.
Il faudrait sans doute distinguer encore, s’agissant de l’influence exercée au moyen des prêts à l’étranger, ceux que l’on consent d’égal à égal à une puissance comme la Russie, qui répondent à un intérêt mutuel, de ceux qui visent à assujettir dans le cadre de rapports asymétriques. Sans doute ont-ils le même effet dans un premier temps, servir le commerce français, mais peut-on parler d’empire dans le premier cas ?
L’auteur esquisse pour finir des parallèles, mentionnant la Françafrique et l’empire américain du XXe siècle. La Françafrique, soit. Mais l’empire américain ? À la différence de l’empire français, réduit au « velours », l’empire américain se caractérise par l’addition de toutes les composantes du hard power (militaire, économique) et de celles du soft power (langue, culture, désir). Si l’on devait chercher un élément de comparaison avec l’empire français, il faudrait peut-être regarder plutôt, mutatis mutandis, du côté de l’Union européenne, autorisée à prospérer sous le parapluie américain, et exerçant la séduction de sa prospérité tranquille du côté de ses voisins de l’Est. La fameuse « attraction » qu’elle exerce sur eux, le « désir d’Europe » qu’ils ressentent, lui ont permis de s’élargir puis d’amener dans son orbite d’autres pays encore. Elle leur consent des financements, forme des élites, envoie des experts, tout comme la France le faisait en Égypte au XIXe siècle. Mais le cadre global du monde a trop changé pour que le parallèle aille beaucoup plus loin.
Une leçon à méditer, tout de même : la précarité des investissements et des prêts à l’étranger en cas de banqueroute ou de conflit. Dans l’espace de temps de ce livre, les épargnants français ont été plusieurs fois durement affectés, sinon ruinés entièrement : en 1825, lors de la transaction d’Haïti, au Mexique, en Égypte. Lorsque le rapport des forces est défavorable, on ne peut contraindre un débiteur à payer : ni Juarez ni Lénine n’ont obtempéré. Quant à l’Égypte ou à la Turquie, il a fallu leur faire des concessions pour ne pas tout perdre. La France, de son côté, ne s’est pas fait scrupule de confisquer les avoirs allemands en 1914. N’assiste-t-on pas à des phénomènes du même ordre aujourd’hui lorsque l’Europe et les États-Unis saisissent les avoirs de la Banque centrale russe placés en Occident ? Les Chinois qui achètent le Pirée ou le port de Hambourg seraient-ils mieux protégés demain ? Bref, l’histoire comme le présent incitent à se poser la question : les seuls empires qui vaillent ne sont-ils pas de fer et de feu ? Le velours a tôt fait de se déchirer.
Peut-être la notion d’empire de velours n’est-elle finalement qu’un bel oxymore, un paradoxe provisoire. Le fait est que celui décrit ici n’aura constitué qu’une parenthèse. Demeure le récit passionnant d’une période foisonnante.
-
Pour la notion d’empire informel, l’auteur renvoie à l’article fondateur de John Gallagher et Ronald Robinson, « The imperialism of free trade », Economic History Review, vol. 6, 1953, et aux débats subséquents.
-
David Todd, L’identité économique de la France. Libre-échange et protectionnisme (1814-1851), Grasset, 2008.












