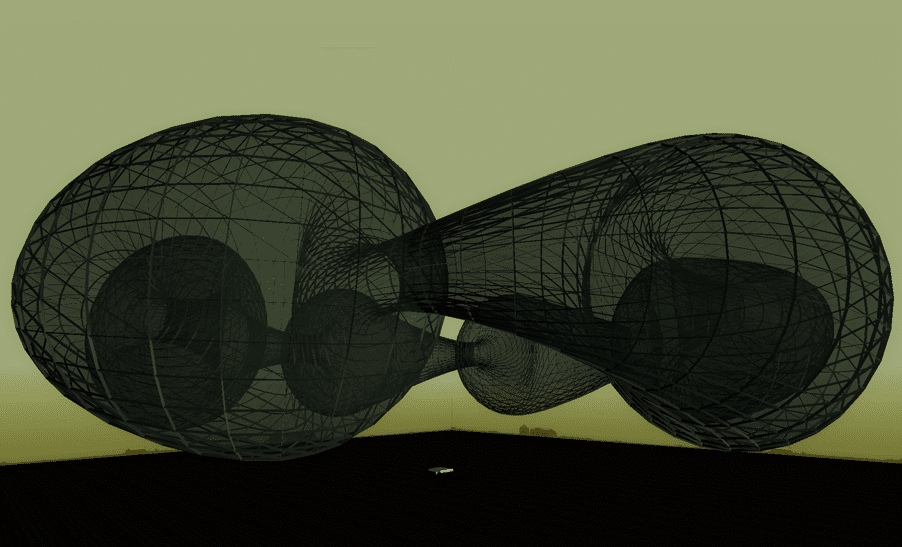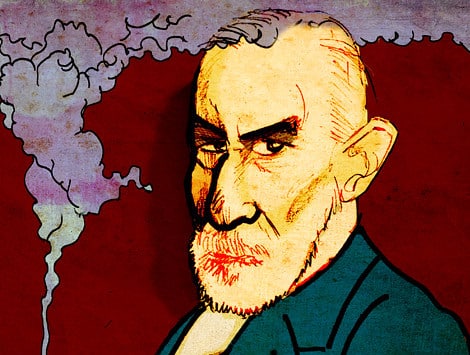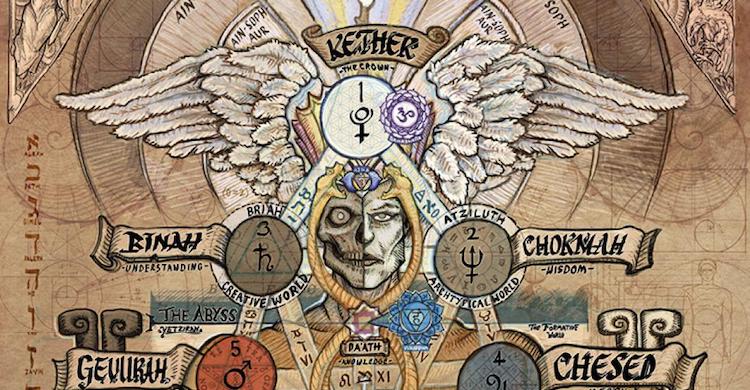La publication toute récente de la correspondance entre Marie Bonaparte et Sigmund Freud, qui remplit un volume de plus de mille pages (présenté et annoté par Rémy Amouroux [1]), a suscité une excitation bien compréhensible au sein de la communauté analytique française : en effet, « cette diablesse de Princesse », comme la nomme Freud dans une lettre à Ferenczi, a joué un rôle crucial dans la diffusion de la psychanalyse en France.
Marie Bonaparte et Sigmund Freud, Correspondance intégrale (1925-1939). Édition établie et annotée par Rémy Amouroux. Trad. de l’allemand par Olivier Mannoni. Flammarion, 1 084 p., 42 €
Cofondatrice de la Société psychanalytique de Paris, de la Revue française de psychanalyse, traductrice des œuvres de Freud en français, devenue son amie proche, Marie Bonaparte est également connue dans le reste du monde pour avoir, en 1938, réussi (avec d’autres) à sauver Freud des griffes nazies. Elle n’est en effet pas n’importe qui : arrière-petite-nièce de Napoléon Ier, mariée au prince de Grèce, sa carte de visite, à une époque où l’aristocratie jouit encore d’un certain prestige, lui ouvre toutes les portes, et elle met tout ce qu’elle possède, argent et entregent, au service de cette nouvelle science psychanalytique. Celle-ci, espère-t-elle, l’aidera à résoudre l’énigme de sa propre féminité – d’ailleurs le plus souvent réduite à sa sexualité dans ses aspects les plus opératoires – sans jamais renoncer, malgré l’analyse, à vouloir la corriger par la chirurgie.
La rencontre a lieu en 1925, lorsque, souffrant de grandes angoisses liées à ce qu’elle nomme sa frigidité, et après avoir déjà eu recours à la chirurgie du clitoris (consistant à le déplacer) pour « corriger » ce qu’elle pense être la cause de ses maux, Marie finit par se tourner vers Freud et la psychanalyse. Une rencontre, comme il apparaîtra, entre deux souffrances : celle, psychique, de Marie, et celle, physique, de Freud qui se bat contre un cancer de la mâchoire, souffrances que tous les efforts de la chirurgie, d’un côté comme de l’autre, ne parviennent pas à soulager.

La princesse Marie Bonaparte le jour de son mariage avec le prince Georges de Grèce, le 12 décembre 1907 à Athènes © Gallica/BnF
La demande immuable adressée à Freud par Marie de la « guérir » d’une frigidité toute relative, sa quête du Graal de l’orgasme vaginal, l’espoir et sa déception quant aux pouvoirs « magiques » de Freud et de la psychanalyse, sont la toile de fond d’une correspondance qu’on peut lire bien évidemment à plusieurs niveaux. D’un côté, elle s’inscrit dans la réalité externe, celle des péripéties du développement de la psychanalyse en France, de son institutionnalisation, des débats théoriques de l’époque, des traductions et des choix terminologiques, et, de l’autre, elle s’inscrit dans la réalité analytique, interne, psychique, celle d’un transfert passionnel, où s’exprime la violence pulsionnelle que la patiente Marie Bonaparte continue, tout au long d’une analyse soumise à de constantes interruptions, à adresser à l’autre et à retourner contre elle-même. La lecture de ces lettres en est d’autant plus compliquée que les limites sont constamment brouillées entre dedans et dehors, entre réalité psychique et réalité externe, les frontières du cadre analytique, encore mal défini à l’époque il est vrai, étant brouillées par les deux protagonistes du fait de ce mélange des genres. C’est la lecture analytique que je favoriserai ici, avec la contradiction interne (et peut-être la culpabilité) qu’elle implique pour celle qui s’invite dans une relation à deux, fondée sur une intimité qui lui échappe.
« Cher père […], je pense à vous et vous aime, j’aspire à vous revoir », écrit Marie, de lettre en lettre. Ces lettres, que nous lisons ainsi dans un après-coup empreint d’étrangeté, furent écrites dans l’entre-deux de leurs rencontres, dans les moments de séparation, d’absence, comme la face inversée de l’analyse proprement dite qui ne peut avoir lieu que lorsque les corps sont en présence. Même lorsqu’elle se rebelle contre Freud, c’est une rébellion qui s’entend principalement comme un reproche, celui d’être absent, de ne pas l’aimer autant qu’elle l’aime, une rébellion qui exige une réponse, qu’elle obtient. Les lettres, parfois quotidiennes, se croisent, Freud ne répond pas toujours tout de suite, mais il répond.
Toute correspondance, dans sa matérialité même, tente désespérément de combler l’absence du corps de l’autre. L’addiction de Freud à la correspondance, comme aux cigares, est peut-être une des sources inconscientes de la naissance de ce dispositif analytique si étrange, qui condense présence et absence de façon si puissante, si douloureuse – tout comme le rêve. Que Marie Bonaparte soit celle qui a sauvé de la destruction les lettres de Freud à Wilhelm Fliess, celui qui a été considéré comme le « premier transfert » de Freud, celui qui a accompagné l’écriture de L’interprétation du rêve, n’est peut-être pas un hasard. Freud avait peur de ce que l’on pourrait y lire : « notre correspondance était la plus intime que vous puissiez imaginer », écrit Freud le 3 janvier 1937 à Marie, « il eût été extrêmement gênant qu’elle fût tombée entre des mains étrangères ». Que dire alors de ces lettres où Marie Bonaparte laisse tomber toute pudeur, toute retenue, où elle apparaît dans toute sa nudité, sa démesure, sa toute-puissance, son mépris pour les interdits ?

« Professeur Sigmund Freud, fondateur de la Science de la psychanalyse », image diffusée par l’Agence de presse Mondial Photo-Presse en 1932 © Gallica/BnF
Marie Bonaparte écrit à Freud de façon compulsive, qui fait écho à la compulsion épistolaire de son correspondant. Il lui écrira ainsi en 1938 : « il existe une parenté intime entre uriner et écrire, et je ne suis certainement pas le seul concerné ». Marie se décharge, se soulage dans l’écriture épistolaire. Ce sont aussi ses compulsions qui l’ont amenée en analyse, particulièrement celle de faire subir à son corps toutes sortes de punitions en réponse au désir obsédant de percer à jour le secret de l’orgasme féminin. D’office, elle met Freud dans la position transférentielle de l’interdicteur, de celui qui refuse de lui donner la seule chose à laquelle elle aspire. Lorsqu’en 1932 Marie lui demande son autorisation pour lui faire une « infidélité analytique » avec Loewenstein (par ailleurs son ancien amant) pour que celui-ci l’aide là où lui a échoué, Freud, lassé, lui répond avec son humour caustique caractéristique : « en tout cas, vous n’avez pas à rester frigide pour l’amour de moi. J’ai pour vous une amitié cordiale, mais l’idée de faire valoir des droits de propriété sur votre personne ne me vient tout de même pas. Sur ce point, le transfert vous trouble le regard. »
Au fil des lettres, Marie Bonaparte se révèle sous un jour bien différent de celui qu’avait perçu Freud quand il écrivait à Ferenczi, en 1925, à propos de sa nouvelle patiente : « De telles personnes correspondent au mieux à mon intention de m’épuiser le moins possible ». Et pourtant, les réponses de Freud sont de plus en plus traversées par l’épuisement. Un Freud épuisé par son cancer, par les opérations de la mâchoire, opérations de la bouche qui font étrangement écho aux opérations génitales de Marie Bonaparte, un Freud qui perd patience mais que Marie vient aussi ranimer avec le récit de ses aventures.
Comment être présent quand on est absent ? Le corps (celui de Bonaparte et celui de Freud, mais aussi ceux de leur entourage, chiens compris) est omniprésent. Si les lettres à Fliess étaient tout autant traversées par les corps, de Freud lui-même comme de ses patientes, il s’agissait alors de corps excités, de corps hystériques ; trente ans plus tard, ce sont des organes souffrants, charcutés, mutilés, qui sont non seulement évoqués, mais dessinés (par Marie) ; un corps féminin décevant pour l’une (« Pourquoi la nature m’a-t-elle donné un utérus sous mon cerveau masculin ? Malheur de ma vie », écrit-elle à Freud en 1935), un corps vieillissant, une bouche gangrénée par le cancer pour l’autre.

Ce qui rend la lecture de ces lettres difficile, et qui interroge le sens qu’elles peuvent avoir pour nous, c’est précisément ce piège du transfert, qui nous « trouble le regard ». Marie s’adresse à un Freud qui n’est ici qu’une figure transférentielle, une extension d’elle-même ; à qui s’adresse-t-elle vraiment dans ces longues missives qui prennent parfois un aspect quasi délirant ? La biographie, l’histoire infantile peut donner des réponses, mais à quoi cela nous sert-il d’analyser la princesse « in absentia », à moins de répéter la violence de cette analyse « sauvage » à laquelle elle soumet ses enfants, avec laquelle elle se torture quand Freud n’est pas là pour incarner l’objet qui se dérobe à elle ? Dans l’après-coup, c’est-à-dire aujourd’hui que la pratique de la psychanalyse est soumise à des règles éthiques contraignantes, en particulier sur la confidentialité, qui faisaient encore défaut à l’époque, on peut se demander quel sens peut avoir la publication sans fard, à destination du grand public, de ce qui appartient à l’intimité du cabinet (même déplacé dans des lettres) et qui ne peut prendre sens que dans l’association libre et dans l’analyse du transfert, même s’il s’agit d’une personne décédée depuis longtemps. Cela change-t-il quelque chose qu’il s’agisse de lettres écrites par une princesse aux fortes tendances exhibitionnistes et voyeuristes, qui se doutait bien en les écrivant qu’elles seraient publiées un jour ? Cette publication vient aussi interroger ce conflit fondamental pour les psychanalystes entre exigence de confidentialité et exigence scientifique de publication.
Au fur et à mesure des années qui passent, et à mesure que Marie prend de l’âge, l’intimité épistolaire entre elle et Freud prend des tournures plus touchantes, plus tendres et apaisées. Les échanges théorico-transférentiels sont moins centrés sur l’enjeu de la sexualité féminine, moins empreints de rivalité ou de soumission-rébellion à l’injonction de Freud de sublimer ses pulsions. En 1938, alors que Freud est sain et sauf à Londres, Marie est en train d’écrire un article sur « L’Inconscient et le Temps ». Le 22 août, date à laquelle il écrit dans ses cahiers la phrase énigmatique, devenue si célèbre : « Psyché est étendue, n’en sait rien », il écrit aussi à Marie : « Il existe une zone frontalière qui appartient aussi bien au monde extérieur qu’au moi : notre surface de perception ». Trois jours plus tard, le 25 août, Marie lui répond : « Oui, on peut dire que le temps, l’espace, la causalité, etc. sont déformés à l’approche de cette frontière. Mais dans ce mélange de Moi et du monde extérieur, je ne peux pas me figurer que seul le Moi soit impliqué dans la construction du temps. Quelque chose du monde extérieur s’exprime là. Quoi, nous ne le saurons jamais… »
Le dialogue de Freud et Marie Bonaparte n’était pas à sens unique. Chez Bonaparte, par sa liberté de ton, sa folie, ses excès, son « utérus dans un cerveau masculin », son tempérament, Freud a aussi retrouvé ce qu’il avait rapporté de Paris et de la Salpêtrière, ce souffle de liberté, ce courage qui l’avait soutenu dans sa lutte contre le conservatisme viennois.
-
Auteur d’une thèse et d’un ouvrage intitulé Marie Bonaparte. Entre biologie et freudisme, Presses universitaires de Rennes, 2012.