Cristina Peri Rossi, qui titre son roman autobiographique, paru en 2020 et inédit en France, L’insoumise, se présente au lecteur qui fait ici sa connaissance comme une dame très indocile. Née en 1941, à Montevideo (Uruguay), après des études de biologie et de littérature comparée, une période d’enseignement, et des publications diverses, elle doit fuir son pays en 1985 parce qu’elle s’est opposée à la dictature militaire qui dirige son pays depuis 1973. Elle s’exile d’abord à Paris, puis à Berlin, enfin à Barcelone où elle s’installe en 1974.
Cristina Peri Rossi, Babel barbare et autres poèmes. Trad. de l’espagnol (Uruguay) par Stéphane Chaumet et Katia-Sofía Hakim. Seuil, coll. « La Librairie du XXIe siècle », 400 p., 26 €
Dès la parution de son premier livre de poésie, Evohé (1971), une déclaration d’amour lesbien qui fait la guerre aux puritains tant les termes en sont crus, joyeusement clamés, Cristina Peri Rossi fait scandale. Ce dont on ne peut juger, puisque l’ouvrage n’est pas traduit en France, que par comparaison et à partir du tout premier ensemble du présent volume, Babel barbare, qui célèbre les anges déchus d’un paradis lointain « à cause du grand vertige de la beauté » et de « religions désormais sans foi ».
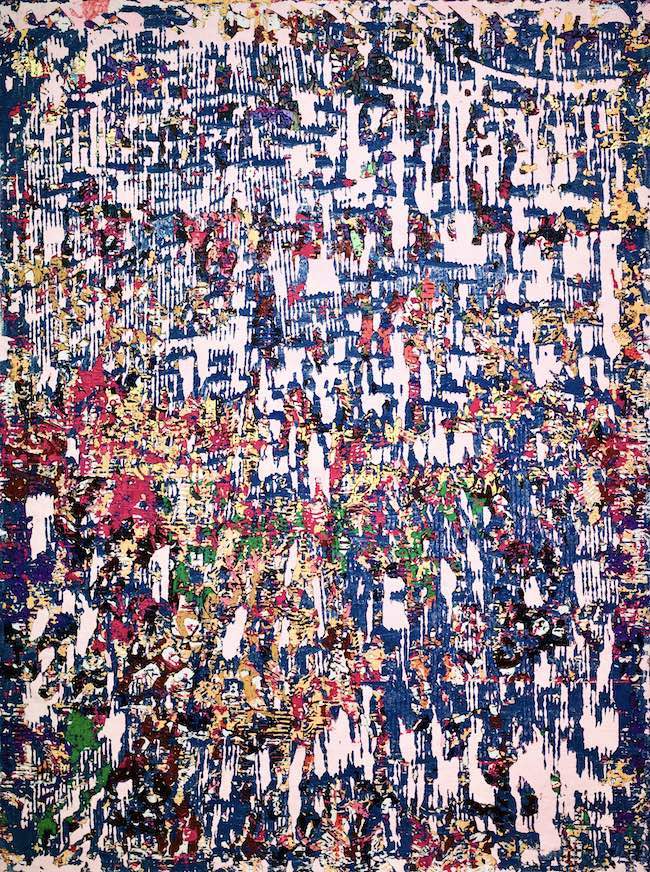
« The binding strand… # 3 » de Rui Miguel Leitão Ferreira © CC BY 2.0/Pedro Ribeiro Simões/Flickr
Les poèmes y sont parfois des instantanés, qui transforment la vision proposée en sculpture : « Elles sont là, immobiles, / comme venues d’un autre temps, / à se regarder fixement // tandis que les siècles passent ». Ils reprennent le langage de la Bible, sans pour autant en adopter la foi, « car celui qui gémit, au lieu de parler, / sera consolé » ; « je te maudis et je te bénis / je te nomme et je te fonde ».
L’humour, qui sera très présent par la suite, casse parfois l’excès lyrique en faveur d’une version plus prosaïque, presque burlesque, de la passion :
« On est ressorti de l’amour
comme d’une catastrophe aérienne
On avait perdu les habits
les papiers
moi j’avais perdu une dent
et toi la notion du temps »
De même l’allégorie, si toutefois le mot convient, lui permet d’introduire des figures animées sur le plateau de son théâtre personnel : « Ton plaisir, animal rare ».
Dès Babel barbare, l’écriture est pour l’autrice un moyen d’accéder au secret, au « mot unique / qui la nommera pour toujours » et qui n’a pas encore de place au sein des dictionnaires. Car l’écriture est un cheminement, un lent travail pour déchiffrer ce qu’on espère et qu’en même temps on craint, que l’on repousse, par crainte de la Révélation.

État d’exil commence par un distique digne du tragique racinien :
« J’ai une douleur là
du côté de la patrie. »
Les tout premiers poèmes sont brefs, comme des interjections adressées au néant, où l’exilée se sent retenue.
« A-t-il déjà existé une ville nommée Montevideo ? »
De temps en temps, ils laissent la place à une lettre de « maman » :
« Et si tout le monde s’en va, ma fille,
qu’est-ce qu’on va faire, nous qui restons ? »
C’est simple et vrai. Le langage est quotidien, pas du tout littéraire, enjolivé pour le lecteur. Comme noté au saut du lit, quand on n’est pas encore réveillé : « J’ai rêvé qu’on m’emmenait loin d’ici / pour un endroit encore pire. » La scène semble peinte par Edward Hopper :
« Une maison
un tableau
une chaise
une lampe
un troène
le bruit de la mer
perdus,
pèsent autant que l’absence de la mère »,
dans un décor échappé de la prose d’un roman :
« À autant de kilomètres de distance
Personne ne peut rester fidèle.
Ni l’arbre qu’on a planté
ni le livre abandonné
ni le chien qui vit dans une autre maison. »
En bonne narratrice, l’autrice possède l’art de la chute, qui fait de ses poèmes de petites nouvelles, et ce d’autant plus qu’ils lui sont inspirés par des histoires de tous les jours, comme celle de ce vieil homme « qui faisait la plonge dans un café de Saint-Germain » ou du type costaud qui a fini de pisser.
Domine dans cet ensemble la mélancolie du « jamais plus », « ils s’exilent de toutes les villes / de tous les pays / et ils aiment les images de bateaux », interrompue par des images de violence policière, souvenirs du pays d’origine : « Ils ont violé Alicia cinq fois / et ensuite ils l’ont laissée aux chiens ».
« Partir
c’est toujours se partager en deux ».
Faisons ici une parenthèse et abordons la traduction, non pour sa qualité, qui paraît excellente, tant le plaisir à lire est grand, mais pour sa position graphique. Contrairement à l’habitude, le texte d’origine ne figure pas en page paire, il apparaît sur la même page, en italique et en dessous, comme un reflet dans un miroir, ce qui augmente son volume, sa présence, son aura. La perception du texte en est changée. Impression renforcée par une des citations qui entament Stratégie du désir : « Aujourd’hui, parmi les corps prisonniers du miroir, j’ai vu ton visage fugitif » (Homero Aridjis, écrivain mexicain). Autre conséquence : la traduction prenant la place d’une partie du poème, ce dernier se poursuit à la page suivante, après un temps d’arrêt, presque comme si un autre texte nous était proposé.
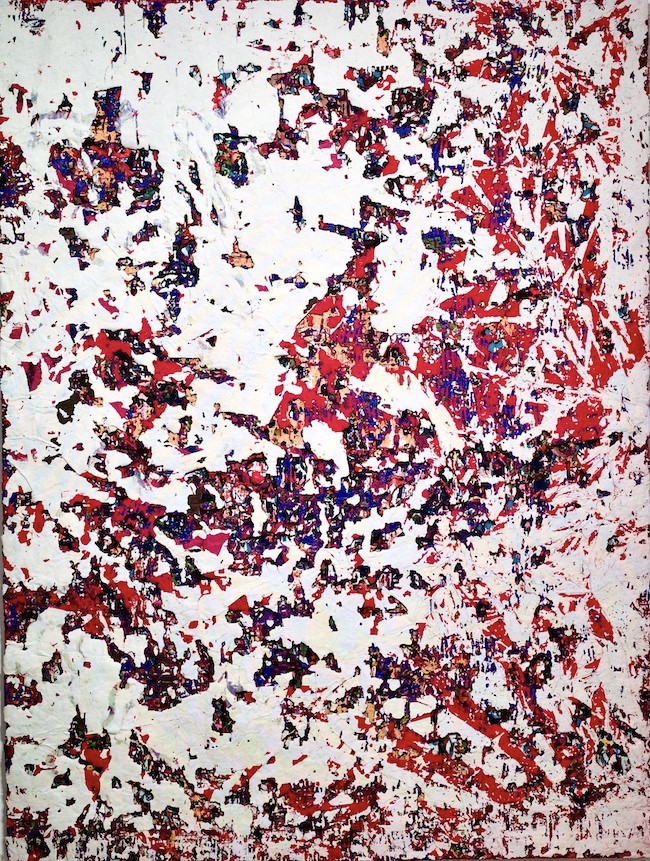
« The binding strand… # 5 » de Rui Miguel Leitão Ferreira © CC BY 2.0/Pedro Ribeiro Simões/Flickr
On trouve, dans ce troisième ensemble, le même pessimisme, associé, galvanisé par une même fureur de vivre : « Tout est perdu d’avance, / et pourtant, / comme des joueurs fous — Dostoïevski — / on continue à parier », la même suspicion vis-à-vis du langage, les mêmes chutes humoristiques. Et surtout, la lucidité à l’endroit de l’amour charnel, sur fond de cataclysmes et de misère urbaine.
Le désir est toujours insatisfait, puisqu’il revient après la jouissance, puisqu’il est contrarié par la distance qui sépare, l’indifférence qui peu à peu s’installe, et l’infidélité. « Dans l’amour est inscrit le désamour / comme la vie est inscrite dans la mort. » Reste la solitude dans le bar où le serveur amical travaille trop, « les médecins lui donneront des comprimés de potassium », mais « pas de meilleur salaire / pas moins d’heures de travail », « quand s’achèveront les quatorze heures il s’en ira / avec son salaire pourri / son sommeil pourri / convaincu qu’il n’y a pas d’autre système possible ». Restent surtout les livres, les poèmes à écrire.
Playstation, titre inspiré par la station couchée (l’autrice a eu un accident, elle s’est fait renverser par une automobile et doit garder le lit) paraît écrit avec désinvolture, tant le style en est simple, familier, presque parlé. Cristina y procède par séries, où apparaissent ses histoires personnelles – liaisons diverses, relations avec les éditeurs, les journalistes, et la littérature – et l’histoire collective, résumée, par exemple, dans le poème « Fidélité II », avec une insolence jouissive :
« Il y a eu un scandale pour une pipe qu’on a faite
à Clinton
quelqu’un qui n’était pas son épouse
les épouses ne font pas ce genre de chose »
Ou encore :
« On m’a dit que Google était meilleur
que l’Encyclopædia Britannica
mais je ne l’ai pas cru ».
Pourquoi ce titre, « Fidélité » ? Parce que, à travers l’actualité, l’autrice reste fidèle à ses amour : « Moi j’écoutais chanter Margherita / de Cocciante ».
Sa suspicion envers le savoir et les livres (qui entourent l’écrivain ou l’écrivaine « comme une armée de gardes du corps ») s’y exprime enfin avec détermination quand un journaliste l’interroge sur sa bibliothèque : Qu’avez-vous fait de vos 8 000 volumes ? Elle répond qu’elle les a offerts parce qu’elle « préfère les aimer à distance… pour ne pas être déçue » !
La plupart des poèmes s’achèvent sur une « chute », par laquelle elle affirme sa méfiance vis-à-vis des idées reçues :
« les psychanalystes aiment beaucoup
que les choses ne soient pas ce qu’elles sont
on les paie pour ça ».

Cristina Peri Rossi © D. R.
Un jour, elle découvre sur Amazon des tee-shirts à son nom, « I love Cristina Peri Rossi ». Elle les commande, pour vérifier : existent-ils vraiment ? À la réception, elle fait le compte : « deux pour cinquante dollars plus dix de livraison / Je me dis que m’aimer ne revient pas si cher / ça pourrait être pire ».
Cristina Peri Rossi, qui a reçu le prix Cervantès pour l’ensemble de son œuvre, est peu traduite en France. Dans leur brève introduction, les traducteurs expliquent que sa carrière y a été contrecarrée par la compagne de Julio Cortázar, Ugné Kavelis, qui avait à l’époque une grande influence dans le domaine de la littérature latino-américaine, et qui aurait été jalouse du « lien si particulier » qui unissait son compagnon à l’autrice. On veut bien les croire. Mais on regrette que l’éditeur n’ait pas proposé une bio-bibliographie plus consistante à la fin du volume : elle aurait permis, par exemple, de situer les livres qui figurent ici dans l’ensemble d’une carrière littéraire toujours en devenir mais déjà très abondante.
Néanmoins, on en sait suffisamment pour apprécier la modernité de cette femme qui, cherchant à échapper aux catégories des genres, s’estime aussi bien homme, femme, oiseau ou fougère et pour souhaiter avoir très vite entre les mains au moins son roman autobiographique, L’insoumise, dont on est très curieux. Et sachons gré à Maurice Olender de nous avoir offert ce livre, un des derniers de sa « Librairie du XXIe siècle » avant qu’il ne disparaisse.











