Décédé le 11 avril 2023, Jean-Pierre Salgas a longtemps collaboré à La Quinzaine littéraire, dont il fut le secrétaire de rédaction, et a mené plusieurs carrières : enseignant de l’art, commissaire d’expositions, critique de cinéma et de littérature, à la croisée de la plupart des grands courants contemporains. Il était aussi le plus grand connaisseur de Gombrowicz, auquel il avait consacré deux livres et de nombreux articles. Il était revenu dans le giron des attendeurs de Nadeau il y a quelques années, et il y a donné certaines de ses meilleures chroniques.

Jean-Pierre Salgas © D. R.
J’ai connu Jean-Pierre en khâgne au lycée Henri-IV, en 1973. Henri Thomas a décrit, dans La dernière année, l’atmosphère de ces classes de « première supérieure », sortes de Déserts des Tartares où les meilleurs élèves des lycées français attendaient l’élection par le concours (d’entrée à Ulm, sinon rien), se divisant en trois classes : les catholiques, qui œuvraient à leur salut en travaillant dur leur latin et leur grec, ou qui se préparaient déjà à Sciences Po et à l’ENA, les calvinistes, qui ne voulaient pas trop se fatiguer, tout en guettant les signes de leur élection, et les mahométans (Inch Allah !). J’étais parmi les seconds. Je ne suis pas sûr que Jean-Pierre n’ait pas été parmi les troisièmes.
Comme notre condisciple Alain Dewerpe, qui allait devenir l’un des plus grands historiens français, nous n’étions pas des héritiers – nous étions fils d’instituteurs – et nous nous frayions tout seuls nos voies politiques et littéraires, à une époque où les occasions de militer ne manquaient pas et nous commandaient, bien plus que les études. Nous étions fascinés par les avant-gardes littéraires et politiques du moment. Jean-Pierre en pinçait pour Tel Quel, moi pour Deleuze. Il n’appartint jamais formellement au groupe de Sollers, mais en suivait tous les soubresauts. Il m’emmenait aux manifs, et tantôt nous étions pour Mao, tantôt amis du PC, tantôt foucaldo-désirants, mais toujours passionnés par une scène littéraire qui avait ses défauts, mais n’était pas encore médiatique au sens où elle le fut à la fin des années 1970 après l’épisode des « nouveaux philosophes ». J’étais déjà à l’époque époustouflé par son immense érudition, sa connaissance de la littérature, des arts et de la philosophie et par sa curiosité, qui lui faisait écumer les librairies et guetter les parutions. Il était déjà passionné par la peinture et le cinéma, allait déjà dans les musées italiens, et voyageait avec ses amis en Cerdagne, à Saillagouse, son pays familial, puis en Espagne, à Barcelone, où il nous faisait découvrir les Ménines de Picasso.
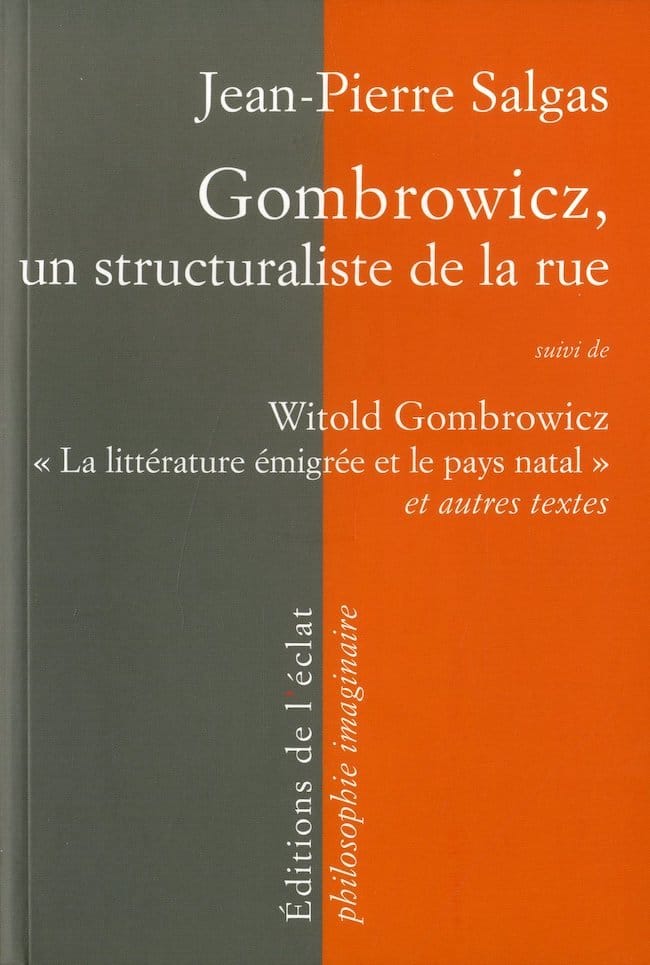
Jean-Pierre Salgas © D. R.
Nos chemins se sont un peu séparés dans les vingt années 1980-1990. Jean-Pierre a enseigné la philosophie et la littérature mais il a surtout été un franc-tireur des lettres. C’est pourquoi il s’est trouvé bien chez Nadeau, avec qui il partageait son amour de Gombrowicz, et a été de 1983 à 1990 le secrétaire de rédaction de La Quinzaine littéraire où il a écrit régulièrement, tout en enseignant dans les écoles d’art, puis à l’ENSAD (École nationale supérieure des arts décoratifs) depuis 2015. Il n’a pas cessé de travailler et d’écrire dans le domaine de la presse culturelle, à Art Press, au Centre Pompidou, et comme commissaire d’expositions, organisateur de colloques (sur Deleuze, sur l’art du monde, sur Schulz, Perec, Gary, souvent au MAHJ (musée d’Art et d’Histoire du judaïsme), sur Chantal Ackerman).
Au fil des années, ses intérêts se sont de plus en plus tournés vers la Pologne et les pays de la Shoah, vers des écrivains apatrides comme Gary, Perec, ou Schulz, et surtout Gombrowicz, sur lequel il a écrit deux grands livres, l’un au Seuil (2000), l’autre à L’Éclat (Gombrowicz, un structuraliste de la rue, 2011), dont il a donné une lecture systématique d’une grande profondeur, et dont on avait un peu l’impression qu’il se sentait le double, un peu comme Witold lui-même se sentait le double de l’étonnant Frédéric dans cette scène extraordinaire de messe effondrée de La pornographie. Salgas montre comment toute l’œuvre de l’auteur de Ferdydurke s’unifie autour de sa théorie de la forme, surgie du chaos pour y revenir. Métaphysique païenne, satire carnavalesque, mais aussi tellement morale, à son corps même pas défendant.
De même que Gombrowicz avait tendance à mythifier la vie quotidienne, Jean-Pierre avait tendance à mythifier la vie littéraire, même s’il l’analysait avec une grande lucidité (qu’on lise son panorama de la littérature française en 2002). Il connaissait intimement non seulement les œuvres, mais aussi les vies des écrivains, leur public, leurs vilénies et leurs gloires. C’est pourquoi, quand il est revenu, tel un fils prodigue, à la famille Nadeau, après un long exil, il se trouva parfaitement à sa place. Les lecteurs d’En attendant Nadeau ont pu lire, dans ces dernières années, ses chroniques remarquables – il faudrait plutôt dire ses essais – entre autres sur Gombrowicz, Perec, Huysmans, Ramón Gómez de la Serna, Genet, Gide, ou sur le cinéma de Bazin et de Truffaut. Jean-Pierre était un grand critique littéraire, dans le style de ceux dont chaque article est gros d’un livre. Quand on réunira toutes ses chroniques, on verra qu’on avait affaire à un écrivain désespéré, obstiné, et fidèle, comme le sont tous les grands serviteurs de la littérature.
Jean-Pierre fut transfiguré par sa rencontre avec Blanche, qui l’a accompagné et guidé si profondément, avec sa fille Sarah. C’est à leur douleur que nous nous associons.












