Trois publications récentes remettent au goût du jour Benito Pérez Galdós : 2022 voit paraître conjointement Trafalgar, Les romans de l’interdit (réunissant Tormento et Madame Bringas) avec une présentation lumineuse du meilleur galdosien français, Sadi Lakhdari, et enfin l’essai monumental que Mario Vargas Llosa consacre à Pérez Galdós, La mirada quieta. Comment ne pas nous laisser guider et découvrir, ou redécouvrir, ce géant des lettres espagnoles ?
Benito Pérez Galdós, Trafalgar. Trad. de l’espagnol par André Gabastou. Zoé, 224 p., 21 €
Benito Pérez Galdós, Les romans de l’interdit. Tormento, trad. de l’espagnol par Sadi Lakhdari. Suivi de Madame Bringas, trad. de l’espagnol par Pierre Guénoun. Le Cherche Midi, 768 p., 23 €
Mario Vargas Llosa, La mirada quieta de Pérez Galdós. Alfaguara, 352 p., 18,90 €
S’il est un auteur espagnol pour qui la barrière pyrénéenne a joué en sa défaveur, c’est bien Benito Pérez Galdós (1843-1920), et bien peu le connaissent en France. La hernie étranglée du franquisme, quarante ans durant, a contribué assurément à le laisser dans l’ombre et sans voix, lui qui fut socialiste (député aux Cortès), libéral, anticonformiste et anticlérical, et qui, pour cela même, se vit préférer en 1904, à l’attribution du prix Nobel de littérature, le néoromantique et grandiloquent dramaturge José Echegaray. En 1912, alors que cinq cents intellectuels espagnols demandaient que cette consécration lui revînt, c’est le dramaturge allemand Gerhart Hauptmann qui lui passa devant.

Portrait de Benito Pérez Galdós par Christian Franzen, publié dans la revue « Blanco y Negro » (9 février 1901)
Quelque peu oublié, en Espagne comme à l’étranger, et fort peu traduit en France, cet écrivain aux 100 romans, l’égal de Balzac pour l’ampleur de sa Comédie humaine, a été le miroir de la société espagnole qu’il a scrutée et dépeinte dans toutes ses strates, avec une profondeur sociale et psychologique, voire psychanalytique selon son exégète Sadi Lakhdari, le tout mâtiné d’un humour qui l’inscrit dans le sillage de Cervantès. Il a fallu le génie cinématographique de Luis Buñuel pour ressusciter ce talent, et l’on se souviendra longtemps de trois œuvres majeures du cinéaste aragonais : Nazarin (1959), Viridiana (1961) et surtout Tristana (1970) qui offrit à Catherine Deneuve l’un de ses plus grands rôles.
Trafalgar est le roman inaugural du cycle romanesque des « Épisodes nationaux » qui, complétant 28 romans et 24 pièces de théâtre, embrasse en 46 récits l’histoire de l’Espagne depuis 1805 jusqu’à 1880, constituant ainsi, selon la volonté de l’auteur, des histoires sur et dans l’Histoire. Il relate le désastre naval de la flotte hispano-française face aux Anglais, en 1805, devenu pour nous le mythe de la défaite et l’archétype du coup fourré : le fameux « coup de Trafalgar » Et quel est-il, ce coup ? Les navires espagnols s’alignent sur l’escadre française, le tout sous le commandement du vice-amiral Villeneuve, nommé là par Napoléon qui, dans son délire hégémonique, voudrait mettre l’Angleterre à genoux, tandis qu’il avance ses pions à l’est en battant à plate couture la puissance autrichienne – la victoire d’Austerlitz, le 2 décembre 1805, fera oublier la débâcle de Trafalgar deux mois plus tôt.
Pérez Galdós, lorsqu’il rédige son roman, sept décennies plus tard, est à jour de l’histoire et connaît bien tous les vaisseaux et ceux qui les commandent. Tout est rigoureusement vrai dans sa documentation, tout comme la manœuvre astucieuse de l’amiral Nelson coupant en deux l’alignement de la flotte adverse et détruisant méthodiquement chaque navire sous la puissance de feu de ses canons ultra modernes servis par des matelots admirablement formés : c’est cela, le « coup de Trafalgar ». À quoi s’ajoute la vraisemblance de son narrateur, le jeune Gabriel qui, à quatorze ans, participe au combat naval, et qui est peut-être inspiré par le personnage du Français Louis André Manuel Cartigny, dernier survivant de la bataille, âgé justement de quatorze ans et mousse sur le vaisseau Redoutable, l’un des narrateurs de cet affreux épisode. C’est ce petit mousse qui rapporta la mort de l’amiral Nelson, le héros de ce qui deviendra pour les Britannique The Trafalgar Day, qu’un coup de feu parti du Redoutable blessa mortellement.
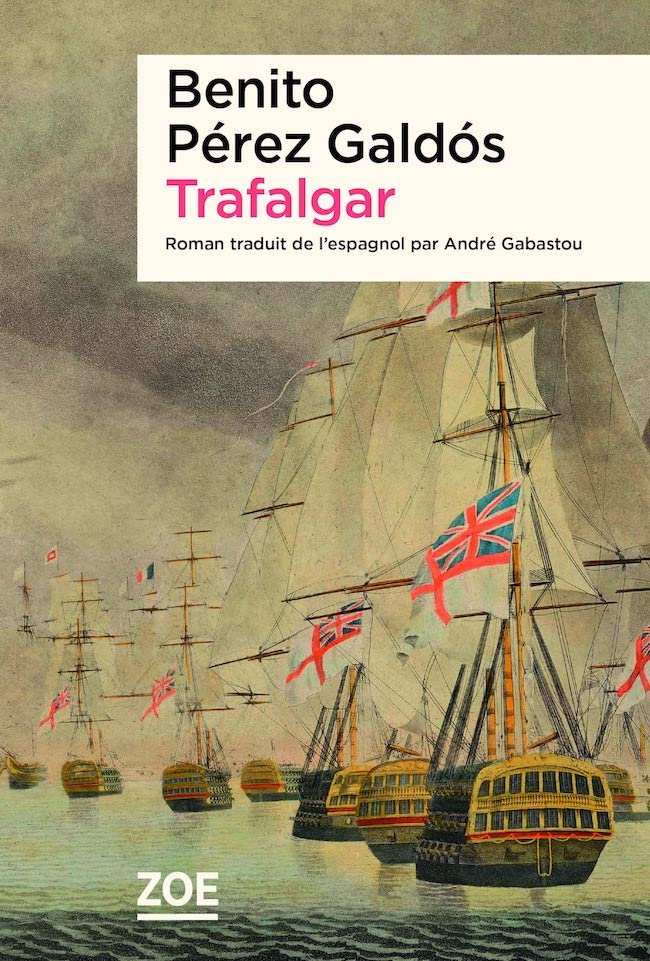
C’est l’originalité du récit galdosien que d’avoir choisi comme narrateur un enfant qui, orphelin et domestique, semble, sous sa plume et dans son encre, directement issu des gosses de la misère du peintre Murillo, à moins qu’il ne provienne de ces romans picaresques dont le prince était un enfant, comme le Pablos de Ségovie – El Buscón – de Quevedo. Et justement ce roman historique est bien plus proche, dans sa structure et, disons, son idéologie, du roman picaresque espagnol non seulement par l’aventure et l’accumulation des péripéties, mais surtout par la vision sociale et ce miroir du romancier décidément placé à ras de terre, ainsi que cela caractérise ou distingue déjà tout le roman réaliste européen, de Balzac à Zola en passant par Dickens (dont, par parenthèse, Galdós traduisit en espagnol The Pickwick Papers).
Cet enfant qui voit tout et, témoin privilégié de l’histoire, la juge avec une fausse naïveté qui autorise toutes les critiques, participe même un peu au combat – prêtant la main à un canonnier hors jeu et allant même jusqu’à tirer deux boulets contre messieurs les Anglais –, parcourant les ponts du vaisseau amiral, esquivant les charges, échappant aux plaies et bosses, secouru ici, sauvé là et touchant miraculeusement au port après avoir été ballotté comme toton. C’est donc lui qui donne à cette aventure son caractère épique et sa dimension relative en tirant le rideau : « Tout se termina quand j’ouvris les yeux et remarquai ma petitesse associée à la magnitude des désastres auxquels j’avais assisté ».
Le propos du romancier ne manque à aucun moment de rabaisser ces misérables oripeaux que sont, dans cette confrontation désastreuse, le patriotisme, le chauvinisme fanfaron, l’héroïsme et l’honneur – cet « honneur espagnol » que sanctionnent aussi Verdi et Schiller dans leur Don Carlos. Conjointement au regard ironique de Gabrielillo, Galdós fait donner de la voix à l’épouse du vieux capitaine de vaisseau, dont l’adolescent est le valet. C’est que le capitaine, attaché aux valeurs de courage et de patriotisme, entend, malgré son grand âge, gagner le vaisseau amiral et participer au combat naval – « L’honneur de notre nation est engagé », dit-il –, d’où il sortira avec de nouvelles cicatrices qui seront comme de dérisoires médailles ajoutées à son palmarès glorieux. « Tu es arrivé à soixante-dix ans et tu n’es plus en état de participer à des fêtes », lui dit son épouse en le traitant, par ailleurs, de « vieux machin ». Et dans de ce rejet et cette dérision des valeurs fondamentales du patriotisme, remontant l’échelle des responsabilités, comment s’étonner que le romancier s’en prenne à notre Napoléon et à sa folie hégémonique ? « Ce voyou de Premier Consul », se déchaîne doña Francisca, « ce petit monsieur qui bouscule le monde entier ». La cause est d’autant plus entendue que le désastre de Trafalgar prélude à la guerre d’Indépendance (1808-1814) qui verra l’Espagne balayer ce fantoche de Joseph Bonaparte, et léguer à la langue française ce joli mot de guérilla, et à la peinture universelle le génial Dos de Mayo de Goya.

Benito Pérez Galdós et les frères Álvarez Quintero, qui ont adapté ses œuvres pour le théâtre (1916). Photographie publiée dans « Mundo Gráfico »
« Cette série de mésaventures semblait absurde, n’est-ce pas ? Elle était comme la cruelle aberration d’une divinité s’obstinant à causer tout le mal possible à des êtres égarés… ; mais non, c’était la logique de la mer, associée à celle de la guerre. Ces deux éléments joints, n’est-il pas un imbécile, celui qui s’étonne de les voir engendrer les plus grandes mésaventures ? » Ainsi s’exprime le pacifisme de Galdós qui, dans ce premier volume des « Épisodes nationaux », sabre d’entrée de jeu la folie guerrière de l’Europe tout entière coalisée à sa perte. On en est encore là, aujourd’hui. Et Trafalgar peut aisément s’aligner à côté des grands romans pacifistes du XXe siècle, de Guerre et Paix à À l’Ouest, rien de nouveau.
Quel destin pour l’Espagne ? Pérez Galdós perçoit bien la fin de ce qui apparut depuis des siècles comme la grandeur de son pays. Le désastre de Trafalgar ne représente pas seulement une défaite militaire, comme pour la France – le vice-amiral Villeneuve ayant baissé pavillon dès les premières canonnades et Napoléon se dédommageant de toute humiliation par l’éclatante victoire d’Austerlitz. En effet, la suprématie incontestable de la marine britannique allait désormais entraver considérablement les échanges entre l’Espagne et ses colonies d’Amérique latine, qui peu à peu s’émancipèrent ; sans parler des pirates anglais, dont le plus célèbre, Jack Rackham, allait inspirer tant de films et de romans, dont le truculent Louves de mer (Gallimard, 2005) de Zoé Valdés. Et Galdós d’évoquer alors « cette oriflamme qui s’abat et disparaît comme un soleil qui se couche », ce qui n’est pas sans rappeler le fameux dicton En Flandes se ha puesto el sol / « En Flandre le soleil s’est couché » — un siècle plus tôt, on disait que le soleil ne se couchait jamais sur l’empire espagnol.
Reste le style du romancier capable d’user de poésie avec quelque accent hugolien quand il évoque la versatilité de l’océan : « Nous étions en mer, emblème majestueux de la vie humaine. Un peu de vent la transforme : la douce vague qui frappe le bateau mollement devient une montagne liquide qui l’ébranle et le secoue ; le son agréable qu’émettent dans le calme plat les légères ondulations de l’eau devient une voix rauque qui crie, injuriant la fragile embarcation. »

Caricature de Benito Pérez Galdós par Joaquín Moya, publiée dans la revue « Madrid Cómico » (3 décembre 1898)
Nous avons là un aperçu du souci descriptif et des réussites picturales ou euphoniques du styliste que veut être Galdós (bien qu’il n’ait mis que deux mois – janvier-février 1893 – à composer ce roman). Et au-delà, ce qui fait peut-être le prix de ce récit et constitue un apport appréciable du romancier à son art est son recours à l’oralité ainsi qu’a pu en user le réalisme français. Ainsi de ce personnage du vieux marin couvert de cicatrices dont le parler truculent permet au romancier de véritables trouvailles : « Parlant de la perte de son œil, il disait qu’il avait fermé la coupée et, pour exprimer la fracture de son bras, il disait qu’il s’était retrouvé sans le bossoir de bâbord. Pour lui, le cœur, siège du courage et de l’héroïsme, était la soute de la poudre comme l’estomac la soute du biscuit. » Et le romancier de multiplier les dialogues, avec un langage populaire, et beaucoup de mots estropiés comme, dans la bouche de celui qu’on surnomme Moitié d’homme, de parler d’internité pour éternité, et de « humée de poudre ».
Vargas Llosa, qui a lu tout Galdós à la faveur du long confinement et du covid qui n’a pas manqué de l’atteindre, a souligné ce qu’il appelle « le regard tranquille » du romancier : cette application à remplir d’histoires, benoîtement et systématiquement, l’histoire de l’Espagne et de l’Europe, tout en manifestant son retrait ou quelque distance par rapport au chaos politique et aux nombreux conflits européens qu’il contemple avec ironie ou dérision. Mais il ne manque pas de le qualifier – usant des mêmes mots qu’il applique à Flaubert, son modèle immarcescible – de « narrateur déchaîné et même un peu sauvage ». Au demeurant, s’agissant de Trafalgar, récit historique où Pérez Galdós, dans ses nombreuses réflexions et ses commentaires, a tant mis de lui, de sa pensée socialiste, libérale et anticonformiste, on pourrait lui prêter cette phrase emblématique : « Gabriel c’est moi ». Aucun doute, sans aller jusqu’à parler d’autofiction, on sent bien que Trafalgar est, d’une certaine manière, le miroir de ce Benito qui s’exila tout jeune de sa Grande Canarie natale pour, devenu Madrilène, courir l’aventure, celle des arts et des armes littéraires. Et ces premiers récits redécouverts nous mettent assurément en appétit.












