Avec Des îles, II. Île des Faisans, Marie Cosnay poursuit son exploration de la catastrophe en cours qui voit aujourd’hui nombre de « celleux qui ont eu l’audace de passer des mondes, mers ou océans » mourir chaque année à nos frontières fermées. Dans ce deuxième tome, l’autrice donne notamment corps à celles et ceux qui ont osé traverser le fleuve de la Bidassoa, près de l’île des Faisans, entre l’Espagne et la France, et qui y ont parfois perdu la vie. Ces histoires sans fin qu’elle porte et à travers lesquelles elle s’engage nous saisissent et nous posent les questions les plus essentielles, qui sont celles de la vie et de la mort. Dans le sentiment d’urgence qu’il dégage et les questions qu’il pose, le recueil de la poétesse Claude Favre, Ceux qui vont par les étranges terres, les étranges aventures quérant, fait écho aux histoires infinies qui peuplent Des îles.
Marie Cosnay, Des îles, II. Île des Faisans 2021-2022. L’Ogre, 248 p., 21 €
Claude Favre, Ceux qui vont par les étranges terres, les étranges aventures quérant. Lanskine, 86 p., 14 €
« J’ai dit : un mort et un enfant nous obligent de la même manière. J’ai dit : personne ne nous oblige comme un mort ou un enfant. » Ces phrases, notées dans les marges du deuxième tome de la trilogie Des îles, détachées typographiquement et spatialement du corps central du texte tissé de la voix des migrant·e·s, font résonner la voix de Marie Cosnay elle-même et témoignent de la puissance réflexive de son travail. « Très vite, au mois de 2021, j’ai su que c’était auprès des enfants et des morts que mon temps était requis. Les enfants et les morts ».

La Bidassoa à Irun (Pays basque espagnol) © CC2.5/Pablo Moratinos/WikiCommons
Deux histoires parallèles sont à l’origine de ce récit : d’un côté, les luttes administratives et judiciaires pour permettre à une enfant, Fatou – rescapée d’une paterá évoquée à la fin du premier tome de Des îles –, de retrouver sa famille à Paris alors qu’elle se trouve, seule, dans un centre d’accueil à Las Palmas en Espagne ; de l’autre, les luttes pour qu’Abdoulaye Coulibaly, mort noyé dans la Bidassoa entre la France et l’Espagne, puisse être enterré dans son pays, auprès de sa famille, en Côte d’Ivoire. À partir d’une enquête menée sur le terrain au plus près des corps et de la parole des migrant·e·s, Marie Cosnay tire les fils les plus ténus et les plus invisibles de ces deux histoires qui forment un point de départ, une trame, très vite dépassée par la multiplication des voix et des histoires des autres migrant·e·s.
Marie Cosnay fait place à chacun·e dans des chapitres qui portent sobrement leur prénom et parfois leur nom : Yaya Karamoko, Fatou, Sory, Souleyman, Mohamed Saoud, Seydou, Abdoulaye Koulibaly… À travers ces courts chapitres, ce sont leurs noms qui trouvent l’inscription qui leur est aujourd’hui volée. Ce sont aussi leurs voix, libérées du silence auquel elles sont contraintes, qui résonnent et circulent avec tant de vivacité qu’elles nous égarent. Petit à petit, on ne sait plus très bien qui parle, et l’on se rapproche, on sent l’égarement de l’autrice, dans le dédale des voix et des liens qui sans cesse se redéfinissent : « Il y a plusieurs Baldé : parfois, l’homonyme, le double, le multiple protège. Rend possible la confusion (celle dont, dans un monde de clandestinité forcée, j’ai besoin). Bientôt, je disparais sous les doubles. » Dans ces doubles et cette confusion, les sujets se perdent.
Marie Cosnay, déliant les « fils invisibles » par lesquels « les images, ou histoires, entre elles, sont liées », fait exister sans fard le trouble de ces vies et des nôtres. Cette entreprise infinie de (dé)liaison exige le courage de savoir imaginer et étreindre le doute et le flou. Si les histoires se délient peu à peu – et l’on peut parfois se prendre, presque coupable, à lire Des îles comme un roman policier –, c’est à partir du trouble sur lequel elles se sont bâties et que l’écriture prend d’emblée et pour le coup, sans doute, à bras-le-corps. Peu à peu, ces voix et ces histoires mêlées se découpent en bords plus nets et chaque sujet existe dans une forme d’individualité retrouvée. Les histoires de Fatou, celles d’Abdoulaye Coulibaly ou de Yaya Karamoko tous les deux morts noyés dans la Bidassoa, en sont un exemple criant.

On pense aussi à celle de Mohamed Saoud, « le rescapé » de l’accident de TER Hendaye-Bordeaux. Le 12 octobre 2021, à 4h45, ce train heurta de plein fouet les corps de quatre migrants allongés sur la voie de chemin de fer : « Se sont-ils endormis naturellement ? Le guide a-t-il pensé qu’ils se réveilleraient, seuls, avant l’heure fatale ? S’est-il endormi lui aussi ? Réveillé au dernier moment, sauvant sa peau ? A-t-il crié, crié, crié, incapable de rien d’autre, trop tard, le monstre de ferraille fonçait droit sur les garçons ? » Les questions crient si fort qu’elles font basculer le récit : « Je me souviens avoir pensé que la question n’était pas, cette fois, le rapatriement immédiat des trois corps. La question était de veiller à ce que l’enquête soit menée jusqu’au bout ». Ce jour-là, trois des migrants perdirent la vie et Mohamed Saoud survécut malgré des blessures corporelles et psychiques incommensurables. Sa voix, son corps hante Des îles jusqu’à la fin.
« Les histoires se racontent par fragments, morceaux, faufilages, reprises et variations. Elles sont des simulacres. […] Il se peut qu’une histoire se détache d’une autre. Ce n’est pas une métamorphose. C’est une addition » : telles des morceaux de terre sous le coup d’un tremblement, les histoires racontées par Marie Cosnay se superposent et se débordent mutuellement. Le lecteur y est pris, de même que l’autrice qui interroge avec pudeur sa position de « porteuse » d’histoires et son engagement, à égalité. Alors même qu’elles nous parlent de mort et de disparition, Marie Cosnay souligne le rapport de ces histoires à l’infini et l’incarne dans le corps même de son écriture qui « porte le signe de ce qu[‘elle] porte de plus lourd : le sentiment qu’on n’en finit jamais. Chaque fois que le corps d’un garçon tué à la frontière entre l’Espagne et la France repose en terre, un autre vient à mourir ».

Plan de l’embouchure de la Bidassoa. Carte attribuée à François Ferry (vers 1685) © Gallica/BnF
Autour de ces spirales haletantes de voix, l’autrice cherche sa place et, ce faisant, la trouve : à travers elles, se constitue une parole politique particulièrement claire et radicale. Ainsi, à la juge du tribunal de première instance et d’instruction d’Irun, qui a le pouvoir de faire d’un corps mort un disparu ou de le rendre présent, Marie Cosnay, avec ses camarades volontaires, envoie un courrier décrivant avec une lucidité glaçante ce dont il est question : « fabrication de fantômes tout autour de l’Europe, deuils sans consolation dans les pays d’origine, fosses communes qu’il faudra bien, en Espagne, comme on le fait pour celles des années 30, ouvrir un jour, suffisance des preuves ». La critique du travail de la police est elle aussi sans appel : « Le jour même de la mort d’Abdouramane, un garçon est tué à la frontière italienne. Les policiers, depuis quelque temps, tirent, à la frontière ou en plein Paris, devant un refus d’obtempérer. »
« Imagine, le nom des exils.
Le nom de la mort. De la mort sans nom.
Le nom de nos peurs.
Nos réserves, précautions, confortables.
Confortant. Nos ruses.
Le nom de la vie qui. Des noms absents des cartes.
Donner un nom est un champ de fouilles. »
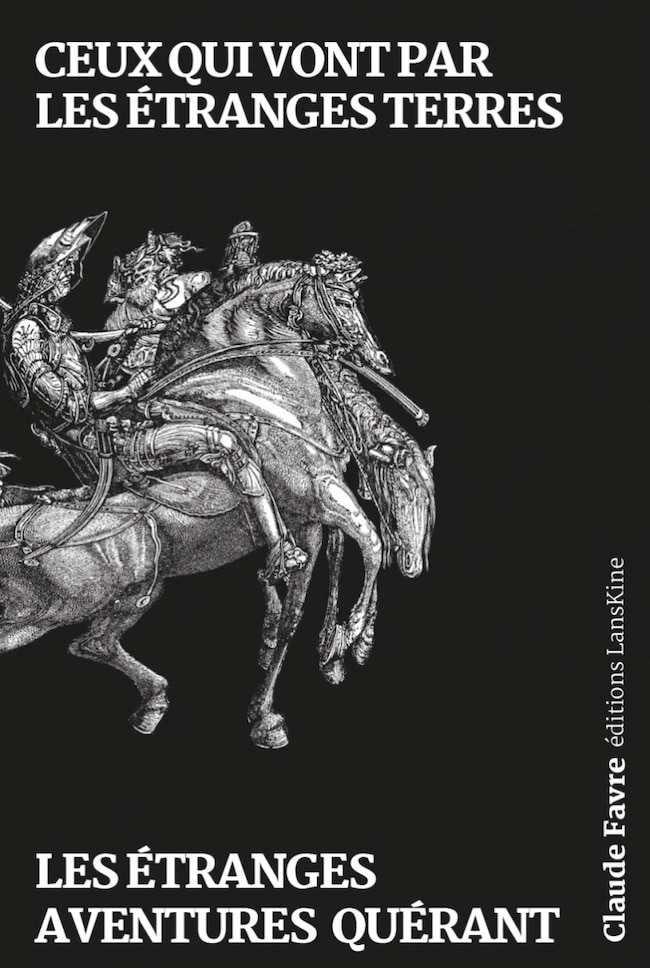
La poétesse performeuse Claude Favre nous invite dans un recueil saisissant, Ceux qui vont par les étranges terres, les étranges aventures quérant, à imaginer les routes, les corps, les visages et les voix de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants qui voyagent et dont on a fait des fantômes. Marie Cosnay, dans Des îles, nous ouvre les yeux sur ce « champ de fouilles » qui consiste à aller physiquement voir les corps pour mieux les imaginer, donner un nom à ces fantômes, inscrire et, quelque part, « installer leur histoire ». Claude Favre scande à l’infini son recueil d’« Imagine » et « N’imagine » où tourbillonnent et se brisent avec rage les images figées de « ceux qui vont par les étranges terres ». L’imagination, pour comprendre et pour voir ces histoires, est indispensable : on le comprend dans Des îles.
Marie Cosnay nous fait voir, depuis les étranges terres qui sont celles de toutes et tous, ce que Claude Favre nous invite à imaginer et qu’il est si facile de ne pas voir : ces images et ces histoires que les migrantes et les migrants éprouvent jusqu’à la douleur la plus intense, jusqu’à ne plus rien y voir, là où tout « est tellement plus grand que nous ».












