Dans son dernier essai, un ouvrage de métaphysique et d’ontologie, Tristan Garcia ouvre une voie vers la possibilité d’une pensée qui échappe au geste d’autorité. Parce qu’il refuse jusqu’au bout de s’imposer par principe, parce qu’il justifie et explicite avec vigilance les positions qu’il prend, l’ouvrage risque de décevoir une certaine tentation de « l’autorité ». Il réussit admirablement son pari.
Tristan Garcia, Laisser être et rendre puissant. PUF, coll. « MétaphysiqueS», 568 p., 29 €
L’ouvrage de Tristan Garcia s’inscrit dans une réflexion au long cours dans la philosophie française sur la question de l’autorité, et sur le lien historiquement entretenu par la philosophie avec celle-ci. Les ouvrages de Reiner Schürmann (notamment Le principe d’anarchie, reparu en 2022 aux éditions Diaphanes, ainsi que Des hégémonies brisées, chez le même éditeur en 2017) y ont largement contribué : « expert en ancrage profond », le philosophe, selon Schürmann, se devait traditionnellement de fixer et de justifier les connaissances et les valeurs du monde et des hommes en un ordre cohérent à partir de principes. Autrement dit, de fonder l’autorité de ces connaissances et de ces valeurs en posant des principes, non sans exclure de cet ordre, par le même geste, un grand nombre d’autres objets, de valeurs et de connaissances. Poser un principe, ce n’est pas le justifier, c’est l’imposer d’autorité. C’est cela qu’il nous semble, aujourd’hui, parfaitement légitime de ne pas accepter : pourquoi ce principe, et pas un autre ? Et pourquoi cet ordre serait-il le seul possible ? En imposant un ordre possible, parmi bien d’autres, le geste d’autorité dissimule son caractère particulier et arbitraire sous le masque de « l’universel » et du « nécessaire ».
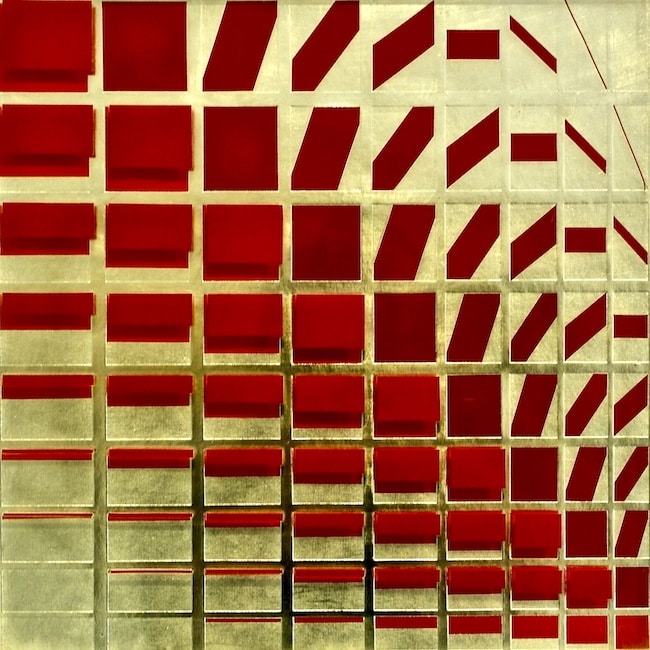
« Sans titre » d’Artur Rosa (1973) © CC BY 2.0/Pedro Ribeiro Simões/Flickr
Laisser être et rendre puissant part de ce constat, teinté de mélancolie : les conflits, les désaccords et les guerres au sujet de l’ordre du monde sont légion, au point même de nous faire douter qu’on puisse établir quoi que ce soit d’universellement partagé. Et ces conflits vont bien au-delà des luttes politiques et des conflits entre morales : la connaissance scientifique, loin d’imposer sans contestation l’image qu’elle élabore de la réalité, est également suspectée de biais, de préjugés, ravalée au rang d’un point de vue comme les autres. Tous les discours et toutes les positions s’affrontent dans un chaos qui semble impossible à ordonner. Et ce constat même quant à notre situation ne fait pas consensus pour les partisans, fort nombreux encore, de l’autorité – et, avec eux, la vieille tentation de ressurgir : ne faudrait-il pas imposer un ordre au chaos ? Comment des connaissances partagées seraient-elles possibles, si même les constats descriptifs qui servent de point de départ sont contestables ? Peut-on se passer d’un geste d’autorité fondateur, celui d’imposer le constat, de faire valoir « son » point de vue pour « l’universel », l’ordre ultime, « objectif » et indiscutable ?
Mais jamais la mélancolie ne sombre dans la nostalgie. Plutôt que de regretter les ordres passés, Tristan Garcia prend en charge la difficulté même que nous éprouvons à ordonner et à mettre en mots la réalité. Si celle-ci est chaotique et désordonnée, que nous éprouvions des difficultés à l’ordonner par crainte d’être contestés dans cette prétention même par autrui, peut-être alors faut-il renoncer à produire un ordre commun à tous, parfois proclamé sous le nom d’« universel ». Renoncer aussi à se convaincre que « l’universel » existe quelque part, par-delà nos mots et nos gestes. Que « l’universel » soit appelé « nature », « monde », « univers », « réalité » ou même « société », peut-être la difficulté que nous, êtres pensants, éprouvons à l’établir sans l’imposer constitue-t-elle le signe d’une insuffisance de cette recherche même. Ce sera la thèse majeure du premier mouvement de l’ouvrage (dans les livres 1 et 2) : il n’y a pas d’ordre commun à tous les êtres, donc pas d’universel. La seule chose qui peut être dite « commune », c’est le fait même d’être possible.
Pourquoi ? Parce que considérer un être comme possible n’a de sens qu’en suspendant provisoirement notre volonté d’ordonner les êtres dans un même ensemble universel. Mais comment pourrait-on dire qu’un produit de l’imagination (un fantasme, un rêve, une utopie) serait la même chose qu’un être matériel (cette pierre, ce nuage) ? Ne faut-il pas les séparer, et dire que l’un est plus que l’autre : plus « réel », plus « concret » ? Car ceci (le rêve) n’est pas autant que cela (la pierre). Et de là, insidieusement, nous en venons à décréter que le rêve est illusoire, faux, et finalement impossible, que seule la pierre est (réelle, concrète, matérielle…). Mais c’est là, par excellence, un geste d’autorité. En déclarant que ceci est moins que cela, l’autorité rend impossibles certaines choses. Elle hiérarchise les êtres, de manière à distinguer des êtres et des non-êtres. Et on comprend pourquoi ce geste nous paraît d’abord inévitable : ne faut-il pas distinguer, ordonner le chaos, pour pouvoir seulement nous repérer ? Le geste d’autorité n’impose pas seulement aux autres ce qu’il faut faire et savoir : il s’impose cela à lui-même. C’est ainsi qu’on en vient, comme certaines variantes réductionnistes du réalisme contemporain, à refuser que l’espoir, par exemple, soit autre chose qu’une réaction chimique. L’espoir serait une illusion, un être faux qui se donne pour vrai. À proprement parler, il n’existerait pas – à condition de considérer que ce qui existe est ce qui est « matériel ». Donc de décréter que les émotions sont des êtres faux, impossibles. L’autoritaire est celui qui « construit un être qui n’est que le nom de cette force à laquelle en se soumettant [ici, la matière] il veut tout soumettre ».

« L’avénus de Milo » (1983) de Jean-Michel Folon © CC BY 2.0/Pedro Ribeiro Simões/Flickr
À ce geste d’autorité, souvent implicite, Tristan Garcia oppose un geste de libéralité : plutôt que de hiérarchiser et de classer, pour expulser certaines choses de la pensée, il faut d’abord considérer que tout ce qui est – dans toute son extension : choses matérielles, immatérielles, sociales et rêvées, passées et futures, individus et sociétés – est possible. Y compris, donc, les points de vue que nous rejetons, les conceptions que nous combattons. Il n’y a que du possible – pour la pensée. Cela signifie que rien de ce que nous pouvons penser ne s’impose à nous comme une autorité. Ce qui est possible n’est ni nécessaire ni impossible, au sens traditionnellement donné à ces mots en philosophie. Cela signifie qu’aucun objet de pensée ne s’impose à la pensée sans choix, sans geste de pensée qui le constitue comme une autorité, et qui, par là même, choisit de rendre impossibles certaines choses.
Mais la libéralité se révèle vite intenable dans le temps – c’est l’objet du livre 3. Si elle permet bien de révéler que chaque être se nomme « possible », elle se trouve inévitablement confrontée, à un moment, à la tentation de l’autorité. Pourquoi ? Parce que certains êtres menacent le geste de libéralité lui-même. Appliqué à la démocratie, définie comme régime de la libéralité politique par excellence, cela signifierait qu’il faudrait aussi laisser être des positions politiques hostiles à la démocratie elle-même. Ou, autre exemple, qu’il faudrait admettre, dans une discussion, la position de quelqu’un qui refuse la discussion elle-même. On voit bien l’actualité du problème posé par Tristan Garcia, et ce pourquoi il finit par qualifier d’hypocrite une telle conception de la libéralité : à force d’admettre toutes les positions possibles, une telle libéralité finirait menacée par certaines d’entre elles, et donc par vouloir les rendre impossibles, sous le prétexte de la nécessité de la discussion elle-même, ce qui contredirait son projet originel. Même bien intentionné, un geste d’autorité reste un geste d’autorité – il rend impossible, il pose des nécessités, il empêche donc de voir que tout être est possible.
Il faut donc admettre la chose suivante. Si le résultat obtenu par le geste de libéralité (qui, à force d’admettre que chaque chose est, découvre que chaque être est un possible au même titre que les autres) est incontestable, ce geste lui-même est intenable dans le temps. On ne peut pas rester libéral perpétuellement, à moins de faire revenir l’autorité qu’on tentait de conjurer. Il faut, à partir de ce résultat, revenir à l’autorité une dernière fois et saisir ce qui la rendait si efficace, si séduisante. Et l’analyse de découvrir que la tentation de l’autorité réside dans le fait qu’elle est puissante.

« Seul », de Jean-Michel Folon (1984) © CC BY 2.0/Pedro Ribeiro Simões/Flickr
La puissance, au sens de Tristan Garcia, c’est ce qu’on obtient en se passant de certains possibles, en les « sacrifiant » : c’est donc ce que certains êtres ont en commun, parce qu’ils ont rejeté d’autres possibilités d’être. C’est là la ressource secrète de l’autorité, ce pourquoi elle est capable, périodiquement, de s’imposer de nouveau. Plus on renonce à des êtres, plus on en décrète de faux, d’impossibles, plus, alors, les êtres que l’on obtient sont valorisés, distingués, rendus puissants. Si je décrète que les émotions sont des illusions de la matière, je vais alors ignorer les émotions et me concentrer sur leur substrat chimique : j’en tire un avantage en ce qui concerne les observations que je vais mener parce que mon observation sera cadrée. De la même manière, si je décrète, par ma conviction totale et inébranlable, que j’ai raison dans le cadre d’une discussion, alors cela signifie que je rends impossible la possibilité que j’aie tort, et l’attitude de doute qui s’ensuivrait si cette possibilité demeurait sur la table. J’en tire un bénéfice d’assurance, au niveau psychologique, qui est indubitable – mais au prix de l’impossibilité de mon doute. Plus les êtres sont considérés comme possibles, moins ils sont puissants ; moins il y a d’êtres possibles, plus ceux qui restent sont puissants : voilà le résultat complet de l’enquête libérale.
Et le projet de l’auteur se reformule donc ainsi : comment penser de façon plus puissante que l’autorité ? Le geste autoritaire est-il la seule voie pour rendre des choses puissantes ? S’il n’y pas d’ordre commun à tous les êtres, pas d’universel, si nous ne pouvons accéder au savoir de ce qu’ils ont en commun que par un geste d’impuissance radical, qui refuse de renoncer à quoi que ce soit, alors il faut admettre qu’il y a différents ordres possibles, inégalement puissants ; des ordres communs, mais pas à tous les êtres, donc pas universels. Ces différents ordres peuvent être compatibles ou incompatibles, et être pris à des échelles extrêmement diverses, telles que l’univers, ou simplement le fait d’être situé dans une même pièce.
Au plus haut niveau d’abstraction, quand on considère les caractéristiques les plus communes, on construit des « métaphysiques », moyens de concevoir et de déterminer ce que sont les qualités, les défauts, les identités et la place des êtres. Il y en a plusieurs possibles, parce que les métaphysiques incompatibles se distinguent en ce qu’elles ne renoncent pas aux mêmes choses, ne définissent pas les êtres de la même façon. Certaines mettront ainsi l’accent sur la stabilité des identités, des places, de l’ordre ; d’autres, au contraire, sur la mobilité de ces identités, de ces places, le désordre. Chacune a des critères qu’elle valorise davantage que d’autres. Mais il n’y a pas de critère absolu qui permette de trancher, que ce soit entre métaphysiques ou entre ordres communs. Aucune autorité extérieure aux conflits ne fournira la clé permettant de les résoudre. Il faut assumer et choisir un critère, en toute subjectivité, qui permettra d’avancer : fournir un cap et s’y tenir en l’assumant explicitement. Le critère choisi par l’auteur sera donc le suivant : la « fidélité au possible », au savoir précédemment obtenu que chaque être est un possible, comme clé d’une pensée plus puissante que l’autorité. Ce à quoi il s’agira de renoncer, pour se rendre puissant, ce n’est pas à tel ou tel être, mais à des métaphysiques précédemment constituées, et à leurs gestes d’autorité.

« Underwater » de Manuel Caeiro (2004 – 2005) © CC BY 2.0/Pedro Ribeiro Simões/Flickr
Le second mouvement de l’ouvrage, aux livres 4 et 5, se consacre à la résolution de ce problème à travers l’élaboration d’une métaphysique que l’auteur appelle « résistante », à partir de l’exploration d’un grand nombre d’objets traditionnels de la pensée : le temps, la politique, ou encore ce qu’est une subjectivité. On laissera au lecteur le soin de lire l’ensemble de ces développements riches et fouillés, piochant dans une très grande variété de références philosophiques, anthropologiques, ou scientifiques. Essayons de la donner à voir dans deux cas particuliers.
S’il est entendu que laisser parler celui qui refuse le débat, au nom d’une libéralité qui laisserait la parole à tous, ouvre à la tentation autoritaire de lui refuser peu à peu le droit de parole, puis, subrepticement, d’être là, tout court – on oubliera au bout du compte qui il est, puisqu’il ne participera plus –, alors la solution suggérée par Tristan Garcia consisterait à résister aux puissances qu’il incarne, à résister à la métaphysique implicite que celui qui refuse de vraiment discuter veut imposer. Parce qu’il menace la discussion elle-même, qu’il réduit à un rapport de forces, il se rend à terme incapable de concevoir ce qu’est la parole, l’échange, ou l’argument. Il serait donc plus puissant de résister à cette métaphysique, à cette puissance qu’il porte dans ses gestes et ses paroles, parce qu’ainsi on ne la dénie pas d’un geste impatient, mais qu’on constate son incompatibilité avec la possibilité de dialoguer sans se faire la guerre — la guerre désignant chez l’auteur l’absence de « commun distinct ». Et, en ce cas, après lui avoir répondu, il faudra empêcher les mots qui portent cette métaphysique, tant qu’ils la portent, pour renforcer la puissance de ceux qui discutent, au nom même de la discussion. Celle-ci n’est pas rendue nécessaire ni sa contestation impossible, mais on tranche au nom d’un critère assumé et explicité par un nous qui ne se dissimule pas derrière une autorité extérieure à lui-même.
Pensons aussi, au-delà de la simple discussion, à une société imaginaire d’où toute tentation pour un régime autoritaire serait absente. Ne serait-il pas plus puissant, si l’on suit l’auteur, que ses habitants ne soient pas tentés par un tel régime parce qu’ils y résistent activement, en lui opposant un ordre des choses incompatible, dans chaque parole et dans chaque geste, et non pas parce qu’ils l’ignorent ? Personne n’est obligé de rendre impossible pour penser ou agir. Pour échapper au geste d’autorité, il faut sans relâche traquer ce qu’il se rend incapable de faire ou de voir : lui résister, lui répondre, et ainsi se renforcer, contre lui.
Résister, c’est donc refuser l’oubli, constitutif du geste d’autorité, qui rejette au loin ce qui le menace, par impatience ou refus de se justifier – c’est donc refuser une puissance, parce qu’elle menace des possibles qui forment un ordre incompatible avec elle. C’est montrer sans cesse son impuissance, ce qu’elle est incapable de distinguer, de concevoir, parce qu’elle l’a oublié ou rendu impossible. Résister est plus puissant que rendre impossible, parce que c’est renoncer à une puissance, mais pas la décréter impossible, et ce au nom de possibles à préserver. C’est ainsi à une attitude éthique que convie en dernière instance une telle métaphysique, qui substitue au nécessaire et à l’impossible les désirs explicites d’un sujet, qui veut résister aux puissances menaçant les possibles auxquels il s’attache.












