À la toute dernière page de L’écrivain, comme personne, l’essai de Patrick Kéchichian (1951-2022) publié à titre posthume par l’éditrice Claire Paulhan, son épouse, nous lisons cette information apparemment anodine qui a tout de suite retenu notre attention : « S’il avait en effet renoncé à composer un essai sur la disparition de la Critique ». Sans chercher à apprendre pourquoi le projet évoqué ne fut pas entrepris, nous regrettons profondément qu’il ne se soit pas concrétisé. Si quelqu’un, à notre sens, avait la légitimité requise pour écrire un essai sur « la disparition de la Critique », c’était bien Patrick Kéchichian.
Patrick Kéchichian, L’écrivain, comme personne. Essai de fiction. Préface de Didier Cahen. Claire Paulhan, 160 p., 18 €
Car non seulement poser le constat que « la Critique » avait disparu de l’espace littéraire constituait un diagnostic assez peu partagé autour de lui, mais en avancer les preuves et les raisons eût exigé de sa part une réelle prise de risque. Or Patrick Kéchichian avait sans conteste la fermeté d’esprit souhaitable et la gentillesse suffisamment désarmante pour accomplir l’un et l’autre objectif.

Comme maint autre poète de notre génération, nous guettions chaque semaine les commentaires critiques qu’il confiait aux pages littéraires du journal Le Monde. Il y avait là pour nous tous une fréquence rassurante, une sorte de rituel à la fois apprécié et craint qui, à mesure que se succédaient les semaines, avait fini par conférer au journaliste un statut quasi mythique, dont les bienfaits rejaillissaient sur le journal lui-même. Je ne saurais dire si les membres de la rédaction mesurèrent alors à quel point la qualité des partis pris du jeune critique dont ils avaient si justement promu la carrière en leur sein, de simple garçon d’étage à rédacteur littéraire, confortait la fidélité d’une bonne partie de leur lectorat.
Patrick avait cette particularité de traiter la poésie comme un art majeur, voire essentiel à la santé profonde de la littérature. Certes, il en vint aussi progressivement à parler du roman et à faire partager ses goûts en la matière à suffisamment de personnes autour de lui pour mener quelques œuvres vers les prix littéraires nationaux les plus prestigieux. Mais son nom reste attaché, pour nous, à ses critiques de poésie.
Le contraste avec la critique d’aujourd’hui est flagrant. La poésie n’a plus droit de cité dans la presse quotidienne, sauf, disons-le avec netteté, par accident. Quelques « blogs » ou journaux numériques, dont le présent journal, laissent certes le soin aux poètes eux-mêmes de parler de leurs pairs, à leurs pairs, mais le genre « poésie » semble devenu totalement étranger aux intérêts financiers de la « grande » presse nationale. Laissons le temps faire son tri, semble être la philosophie courante, et conduisons au mieux le cercueil poétique vers nos rubriques nécrologiques.
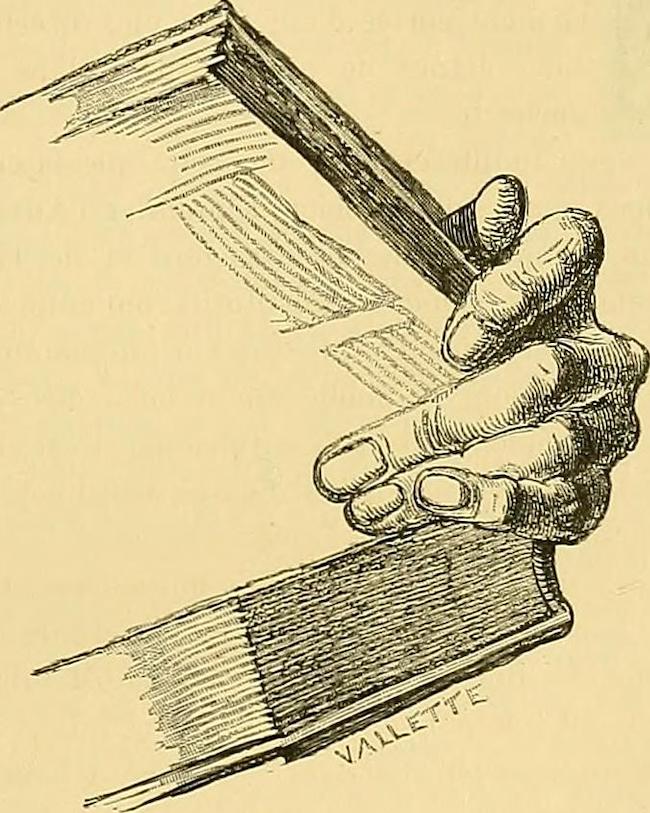
« Gazette des beaux-arts » (1859)
Or le temps poétique, c’est vrai, est celui de la longue durée, et se prononcer sur la qualité d’un recueil demande que le jugement s’engage à terme. C’est cela que Patrick Kéchichian savait et osait faire, juger au risque de l’injustice. Donc risquer de déplaire. Il maniait à cet égard une pratique subtile de l’équilibre, louant ici tel ouvrage avec générosité quitte à dévaluer le suivant du même auteur, pour mieux redistribuer sa « faveur ». « La défaveur » n’est-il pas le titre d’un de ses tout derniers essais (Ad Solem, 2017), dont la lecture éclaire intelligemment le livre posthume vers lequel nous nous acheminons ?
Ce qui nous frappe, en effet, dans le cas de l’écrivain Kéchichian c’est sa maturation dans le temps, sa lente prise de conscience de tout ce qui jouait en sa « défaveur », à commencer par ses origines familiales et nationales. Il se sera presque agi dans son cas d’une réussite en une seule génération, une réussite à l’« américaine », quasiment, quoique s’étant déroulée exclusivement en Europe. Le jeune garçon timide mais souriant dont nous parle l’auteur de L’écrivain, comme personne est aussi celui que nous avons nous-même connu, lors de telle ou telle brève entrevue dans un café, où nous nous faisions notre propre agent littéraire ou, pour citer notre interlocuteur, « gesticulions pour tenter d’attirer l’attention ». À notre décharge, en l’occurrence, nous faisaient alors défaut et agent et diffuseur. Patrick, quoique non dupe, écoutait patiemment sans jamais se départir de son sourire d’enfant, courtois et légèrement ironique.
Nous, poètes, sommes devenus aujourd’hui orphelins d’une telle écoute. Car, plus que jamais, le poème demande une lecture auditive aussi bien que visuelle. Ne serait-ce d’ailleurs pas l’audace de ses engagements qui aurait valu à notre ami critique la « défaveur » de ses collègues journalistes, voire des poètes eux-mêmes, refusant ses partis pris, à moins que le « genre » poésie ne se soit peu à peu évaporé dans une confuse « poétique généralisée » appliquée à la littérature.

© D. R.
C’est de cette désaffection que semble nous entretenir, en partie, son dernier essai. Indéniablement, le critique s’y montre écrivain – « l’écrivain » du titre. Il a cessé d’écrire sur les autres, devenant leur égal à force de les écouter avec « une magnanimité, une indulgence obstinée, favorisées par un état de veille permanente, une attention constamment offerte à autrui, au premier venu ». La façon dont le métier de critique littéraire se dépasse en celui d’auteur est d’ailleurs l’une des leçons originales de cet essai écrit dans une langue ou plutôt une prose qu’on qualifiera de classique. Car Patrick est délibérément passé à l’écriture de la prose, n’ayant pas, à notre connaissance du moins, franchi le pas vers le poème. Cette prose, dans notre jugement, est une prose française noble, très serrée, très attentive dans sa démarche et sa progression, avec quelquefois des emballements surprenants, de véritables bousculades de mots ou de concepts qu’on croirait inarrêtables.
Pour ce qui est d’interpréter le titre de l’essai, L’écrivain, comme personne, prenons nous-même un risque. La formulation s’avère manifestement plurivoque, en raison de la place de la virgule. Cette dernière absente, le sens eût consisté à réaffirmer la position incomparable de l’auteur. Rien à voir avec la modestie de Patrick Kéchichian ! Placée juste derrière « l’écrivain », la virgule permet qu’on considère celui-ci en tant que personne, ou en tant qu’il n’est personne. Cet usage suprêmement habile de la langue française, employant le même mot personne pour dire quelqu’un ou son inexistence, marque bien l’accès définitif de Patrick Kéchichian à la grâce de l’écriture.
Car le mot « grâce », lui aussi, est conjonction des sens, désignant aussi bien un don du ciel ou du travail qu’une conversion religieuse ou spirituelle. La conversion au catholicisme à laquelle Patrick fait référence, aussi discrète que constante dans son dernier ouvrage, n’a assurément rien de la foudroyante révélation vécue par Paul Claudel près de son pilier à Notre-Dame. On comprend en revanche qu’elle aura « sublimé » les faiblesses douloureusement ressenties dans l’enfance comme les mélancolies assumées par l’adolescence en une lumineuse justification. À partir de là, semble nous dire « l’écrivain », il a commencé de marcher au-dessus du vide, encordé à la phrase comme l’alpiniste au-dessus du sien. « En somme, je suis quelqu’un pour la seule et unique raison que je (ne) suis personne. Une aporie n’est pas toujours un cul-de-sac, je peux vous le garantir. Vous me suivez ? »












