Pour le printemps, paraissent trois livres de Philippe Beck. De cette écriture, on retiendra plusieurs traits, et l’unité : vers et prose, réflexion-incubation des événements, écriture de lettré partageur, lignes hypersensibles. Surtout : « Art mnémonique d’Inquiet ».
Philippe Beck, Idées de la nuit suivi de L’homme-balai. Le Bruit du temps, 184 p., 18 €
Philippe Beck, Une autre clarté. Entretiens 1997-2022. Le Bruit du temps, 496 p., 22 €
Philippe Beck, Ryrkaïpii. Flammarion, coll. « Poésie », 296 p., 20 €
Avec, en couverture, un tableau, Séléné et Endymion, et le beau cachet rond des éditions Le Bruit du temps, on trouve dans Idées de la nuit presque deux livres. L’homme-balai, à lire absolument, est un journal (très peu intime) du confinement. « À partir d’aujourd’hui, je tenterai de comprendre le sens de notre expérience », écrit Philippe Beck. La situation (être assigné à résidence, dans des conditions inégales, en raison de l’air empoisonné) appelle un regard aiguisé et non abusé.

L’expérience est vite peuplée de livres. Deux premières pages : on passe de la chambre de Pascal aux fenêtres de Baudelaire. Elle est expérience de langue : « l’air libre devient enfin une idée ». L’expérience est sensible : le silence domine, « comme si chaque appartement malgré tout attendait de nouveaux locataires ». Attendait une habitation nouvelle ? Sans doute. Et plus sérieuse que l’annonce « d’un monde d’après ». Mais c’est aller plus vite que la musique… Dès le début, pourtant, troisième texte, l’ouverture est là : « l’apparition du besoin d’agir autrement, dedans et dehors, est un possible réel ».
L’extérieur s’invite : avec les nouvelles et l’avidité générale de savoir, qui pourrait s’émousser : « les âmes relativement confinées […] par un surplace risquent leur peau et la peau du commun ». Après une remise à l’endroit – lumineuse – de ce qu’est l’information, Philippe Beck le voit : « le confinement aggrave la possibilité de manquer le réel ». On pourrait paraphraser : se manquer soi-même ; pour chacun, manquer le poème possible de ces jours. Rien à voir ; non, rien à voir avec l’intention d’ajouter un peu de poésie au monde, comme certains « praticiens du poème » se proposent de le faire : « le monde sait qu’il en manque au moins ». Tout comme il sait sans doute combien « le manque de naturel vivant affecte l’existence commune ».
Le souci du commun est constant dans ce texte, qui passe sa navette de tapissier à « chacun », et inspire par exemple la question : « À quelles conditions le foyer est-il une sphère pré-politique ? » Ou : « Quand la vie qui est faite à un nombre d’hommes a-t-elle détruit le travail de l’imaginaire, qui, non seulement empêche de devenir fou, mais peut donner sens à ce qu’Aristote appelait “l’invraisemblable nécessaire” ? » L’imaginaire et l’imagination sont ici des mots clefs. Ils ouvrent. Et Philippe Beck affirme, déplaçant Mandelstam : « l’imagination est une cigale. Elle ne parle que du monde et de son destin. »
On suit le calendrier qu’on a soi-même vécu : la distinction des activités indispensables et celles qui ne le sont pas, « le tri des uns et des autres » ; alors qu’à rebours du théâtre social, du contresens de la figuration, on devrait « donner le premier rôle à chacun ».
Les applaudissements aux soignants sont « paroles des mains », comme les mots « sont des mains retrouvées autrement ». On lit un très beau texte sur les masques. On rit (jaune, comme sur le moment) à l’évocation des porte-paroles du gouvernement, pour le bilan quotidien : devant le visage, « dont les yeux ne brillent pas », et les éléments de langage : doctrine d’usage des masques, filets de sécurité, déroulé, pic, plateau, boussole… On respire à observer la « distanciation sociale » : depuis la distanciation de Brecht jusqu’à « l’écart devenu société et non plus uniquement le fondement du lien entre les êtres ». Et c’est bien là un tour de Beck : rendre un égarement à son point de départ, une justesse, qu’il trahit. Une remise à l’endroit, après le mouvement de marcher sur la tête que symbolise l’homme-balai, repris de Swift. La remise à l’endroit est question de poésie ; réponse, comme à la comptabilité des morts, d’une phrase-énigme de Novalis. Et grandeur. Ainsi, « chaque être est Thémistocle… Son nez mesure les forces en présence… et ce n’est pas une autre histoire ». Dans les villes désertes, bientôt entre l’animal, « le même et l’autre de l’humanité ».

« A Horse With No Name » © CC BY-SA 2.0/Roan Fourie/Flickr
Mais le coup de semonce de cette expérience commune menace de ne rien semer : « nous risquons de passer au-dessus du passage, d’ignorer les ponts que dessine un monde où tout se donne et se reprend, les colombes pascales, les portes et les toits qui attendent nos pensées… ». Et la pensée politique se relance, interroge « les symptômes d’époques », ainsi, la lecture faible que la nôtre fait des défaites et des victoires ; ainsi, la compréhension de « la guerre froide entre la Filière Humaniste et la Filière Antihumaniste », avec « trois types d’écrivains-symptômes ». Feront rire le lecteur les Empédocles pâlots, prêts à se jeter dans l’Etna, et qui « laissent leur points de suspension comme des sandales au bord du volcan ». Dans la grande étendue des tons, la tendresse aura le dernier mot et le remerciement au dehors qui attend d’être, libéré, lui aussi : « Il y a le non encore noté des lauriers coupés, le visitable, et j’ai presque envie de répéter cet / “Il y a” comme la formule d’un poème londonien, de transistor à transistor, un logiciel de / traduction intégré à l’œil qui écoute. » La menace – plus que dans l’air – accentue un état de veille, où se relancent et se repoussent pensée politique et poésie.
Dans Idées de la nuit, ensemble de 51 textes courts, l’enjeu est donné d’emblée : « Tant que domine l’ordre de l’époque, qui repousse l’autre clarté alors dans l’espace de / pensée le réel, ensemble d’apparitions qui s’imposent, risque d’être manqué […] ; et c’est la / Nuit qui, en maître absolu, règne sur le pensable ».
Plus loin. « La nuit absolue […] désigne l’infini du pensable qui a sacrifié l’apparaître ». En outre, « le monde multiplie les voiles : la Nature vit de crypter […] et la société des hommes […] fait comme la Nature ». « L’autre clarté » est « celle que des poèmes espacés appellent de leurs vœux ». Elle vient d’un poème de Hölderlin, « Fête de la paix ». On citera les vers, pour éclairer le lecteur, malgré le risque des bords déchiquetés :
Un Sage pourrait m’éclaircir bien des points,
mais,
Là où un Dieu par surcroît paraît
Règne une autre clarté.
Philippe Beck ne les cite pas en entier. Et, sauf deux occurrences significatives, « Dieu » ne figure pas dans le livre. Seul est nommé « le Soleil qui n’a pas commencé », « il est le vieux dieu fraternel et noble, nous dispensant miraculeusement, comme au monde autour de nous, la force de son esprit ». Ici, c’est Hölderlin qui parle. Philippe Beck l’a mis à l’abri. Ou plutôt, nous a mis à l’abri : si « l’autre clarté est chassée dans l’ordre de l’époque, est comme un voile voilé… », sans doute ne faut-il pas en rajouter. Avec des mots qui l’éloignent ?
L’affaire n’est pas abstraite. Les conséquences sont mortelles : « avant le conflit qui déchire les corps, il y a la guerre quant à la lumière ». L’affaire n’est pas non plus visite attardée de « la Grotte Platonique ». Que le lecteur ne se détourne pas : dans Idées de la nuit, les phénomènes pleuvent et le demi-jour de la poésie – ici toujours présente – éclaire, oriente, accommode. Le très proche est là : avec les rêves, qui sont « les signes de la présence du jour dans la nuit » ou avec le soleil, « qu’on commande à l’enfant de tracer à l’angle impassible de sa feuille blanche », avec l’été ou encore ce qu’est flâner.

Un second livre paraît au Bruit du temps : Une autre clarté, qui rassemble des textes d’entretiens de 1997 à 2022. On ne peut ici que conseiller au lecteur d’aller voir ce panoramique, où passent, de Garde-manche hypocrite à Traité des Sirènes, livres de Beck, références à d’autres livres inspirants – table ouverte ; questions d’époque : de poésie ; invention d’un autre rapport poésie/prose ; heure de l’impersonnel, inhumanité, « jeu des destructions organisées »… Ce livre est le nôtre. Devant ce qui a lieu, devant les inventions du « génie du mal », « que fait la poésie dans le jeu ? Problème. Elle ne distribue pas les cartes, mais une partie des cartes sont des poèmes ».
À côté des grandes différences entre les voix qui s’entretiennent, on remarque la ligne égale de celle de Beck ; dans le propos, l’écoute du « battement du vrai » ; dans la reprise des mêmes thèmes, le but : « non pas dire toujours la même chose de différentes façons, mais […] dire différentes choses en précisant toujours mieux l’unique façon qui compte ».
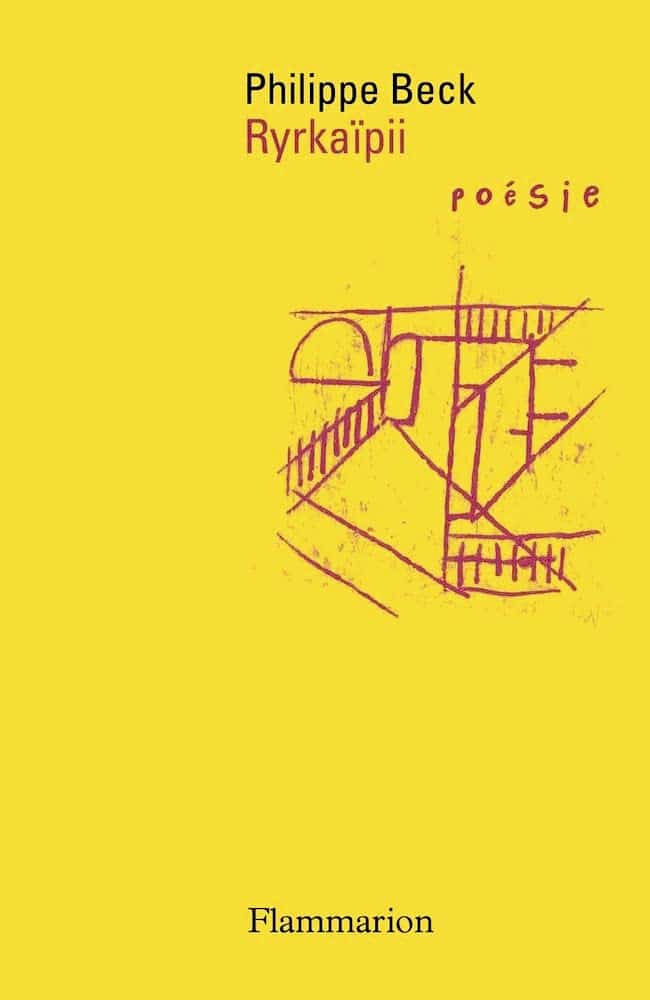
Huitième livre de Philippe Beck aux éditions Flammarion, le dernier en date a un titre étrange : Rykaïpii. Dommage qu’on n’ait pas eu ce livre pendant le confinement : avec ses cent poèmes, on aurait eu cent jours d’évasion. Le chiffre évoque une anthologie, un florilège du réel. La quatrième de couverture donne le prétexte : « En décembre 2019, écrit Philippe Beck, un article consacré aux ours blancs qui approchaient inhabituellement du village de Ryrkaïpii […] m’a fait écrire une hilarotragédie sensuelle. Jusqu’au printemps 2020, l’ours en est devenu le héros ».
Le lecteur doit être prévenu : il ne va pas lire un poème écologique. Et l’ours est un héros parmi une multitude d’autres car le générique est hallucinant. On entre dans une superproduction – poétique, s’entend. Elle est pleine d’animaux littéraires, réels et peints : de « l’âne dithyrambique » à celui de Balaam ; pleine de personnages réels ou de contes, Bimbamboulor et Tom-Tit-Tot ; allégoriques (le Regardé, l’Absent-qui-regarde, mais aussi Maquette d’Avion et Fourrure Pirckheimer) ; de noms célèbres et d’hommes de science ; de guerriers, de mannequins de paille, et de dieux anciens… Et si l’on cherche parfois à mettre un visage sur un nom inconnu, on trouve, comme pour Sheela-na-gig, une chanson de P. J. Harvey ou – étrange circulation – sur Google Books, la phrase où se trouvait ce nom que l’on cherchait. Mais il faut cesser de trop penser les noms comme des renvois, des re-présentations, quand la vie est tout autre :
« Vivre sans rien représenter ni copier
Pour savoir, c’est la magie.
Magiquement, Vivant
N’est pas enfermé dans une forme :
Il s’écoule comme fleuve étrange. »
Le livre est ce fleuve. Il « est plein de questions : non désertées […] / Elles ne sont pas calmées et rayonnent d’un même centre ».
Le livre, un courant alternatif : tragi-comique, lyrique-froid, action de « démêler des fils et d’en relier d’autres »… hésitation entre la musique et les lettres, oscillation où « le drap Suzanne » pourrait être aussi bien un nom commercial que l’étoffe d’un tableau de Rembrandt ; va-et-vient entre la présence de la terre et du ciel et les inventions techniques (neurones-miroirs ou Outil d’Accès à Distance)… Le livre a bientôt rapport à « la barbarie inévitable, synthétique, enfantine » qu’évoque Baudelaire à propos de la peinture (Philippe Beck cite l’expression dès le début). Elle vient du besoin de « voir les choses grandement » et concerne la tension entre la vision d’ensemble – ce qui veut être gardé par la mémoire – et les détails, toujours prêts à l’émeute. Ryrkaïpii travaille cette tension.

Philippe Beck © Philippe Matsas/Opale
Pour finir : au reproche d’obscurité qu’a déjà attiré sa poésie, Philippe Beck a plus d’une fois répondu. On pourrait envoyer Mallarmé ajouter : « Il doit y avoir quelque chose d’occulte au fond de tous », sinon, on ne reconnaîtrait pas l’obscur aussi jalousement, en le trouvant si vite en dehors de soi ; et, poursuit Mallarmé, on ne renverrait pas au poète un « Comprends pas ! – l’innocent annonçât-il se moucher ». Ne pas comprendre est aussi dans l’ordre. L’obscur est l’autre, l’indispensable, du lumineux. Il est aussi l’allié du simple. Et il n’est rien de plus simple et de plus savant que ces vers-ci :
« Les trois choses dont l’existence
est imperceptible sont unies
d’un lien banal et secret :
la musique qui ne résonne pas,
l’urbanité qui ne prend pas forme
et le deuil déshabillé. »











