Approcher l’Amérique, saisir l’insaisissable, retranscrire les faits et gestes de l’enfance, dire l’impermanence des choses, percer les mystères du vivant, traduire le langage des oiseaux : voilà le programme de ce onzième épisode de notre chronique de poésie, coordonnée par Gérard Noiret.

Dans ce recueil du poète breton Paol Keineg, l’Amérique est approchée à travers le prisme de l’évocation qui « caresse » (le terme est de Jean-Claude Leroy) plus qu’elle ne décrit, suggère plus qu’elle ne restitue. « Il ne s’agit pas d’embellir les jours américains », prévient le poète, mais de les garder « au chaud dans leur perfection d’ennui ». Keineg connaît bien les États-Unis pour y avoir étudié, travaillé et voyagé. Parfois aphoristiques, les fragments de sa poésie en prose sillonnent et se remémorent le pays. Une roulotte dans le Nouveau-Mexique, un potager en Caroline du Nord, des champs de patates dans l’Idaho : l’Amérique déploie les lieux d’une « vie contemplative » qui révèle autant de paysages intérieurs.
Écrire, c’est « affûter à la meule » des instants du quotidien et tout miser sur « l’instabilité des mots » pour nommer l’écart ou l’ambivalence. Méditative et pénétrante, tendre et caustique, la poésie de Keineg est un lent apprentissage, un dialogue subtil avec soi-même dans le miroir de l’autre, souvent féminin. Plus qu’un pays, l’Amérique est ce désir de renaître, cette quête de mots et de vérités qui tend, presque toujours, vers « l’informe absolu du bonheur ».

Peut-on saisir l’insaisissable ? C’est ce que tente Yves Leclair dans Miniatures. Ce poète qui a très largement contribué à faire connaître Pierre-Albert Jourdan et qui a su, comme ce dernier, s’inspirer d’une expérimentation proche du bouddhisme chan et du taoïsme, avec un zeste de Silesius, nous invite à célébrer l’instant, tel qu’il se révèle dans « ce reflet orangé du soleil / dans la baie vitrée du matin », « le jeu des brumes / qui gomme la montagne » ou « Le soir allant / admirer l’oie / qui se dandine dans la boue ».
Il y a dans ces poèmes un bonheur d’exister dans l’impermanence des êtres et des choses, d’aller son « chemin dérisoire / entre l’immense ravin / et les neiges éternelles », parmi les petits riens du quotidien qui font du sans-pourquoi de la vie un harmonieux bouquet. S’ouvrir au silence, à cette « heure béante » en soi où le vide résonne, c’est ce que fait ce livre où rôde l’esprit du haïku et qui appelle à l’éveil.
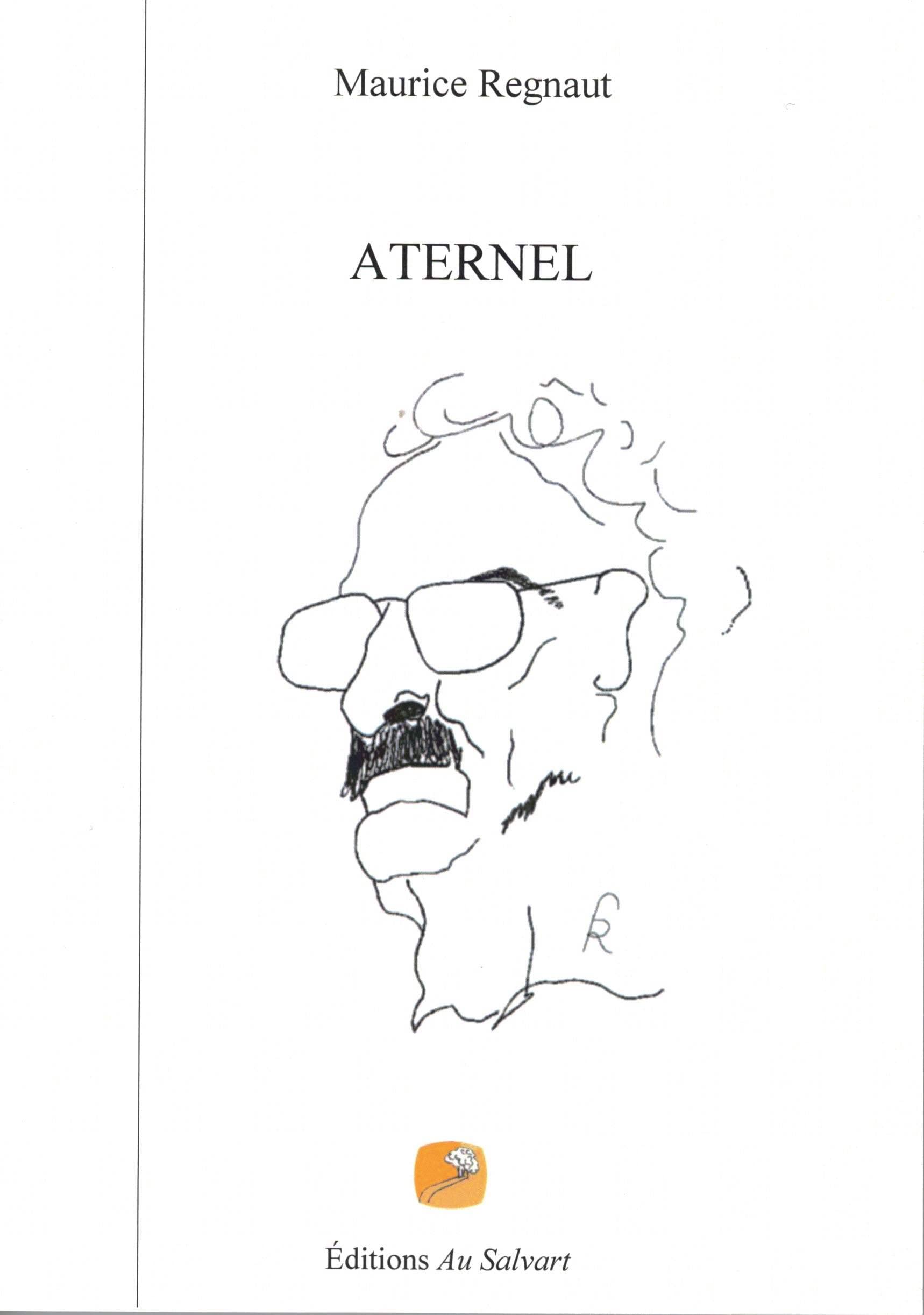
Le poète est un éternel enfant et vice versa. Si d’aventure le lecteur l’avait oublié, qu’il lise et se délecte d’Aternel de Maurice Regnaut (1928-2006), petit recueil consacré à ses cinq enfants (+ un désiré, mais jamais né…). Aternel est un bout de mot bien pratique qui fait suite à mat + frat + pat, trois degrés d’être bambin-au-monde.
Il y a là une façon de porter attention, enregistrer et retranscrire les faits et gestes de l’enfance, qui se rencontre rarement dans la poésie. Voici un hoquet qui déclenche une inquiétude avant de se transformer en loquet puis en bilboquet avant de se terminer en un : « tout est OK ». Voici encore un geste qui n’est que d’ouvrir les bras et qui pourtant se multiplie : « en criant », « en riant », « en courant ». Voici maintenant une porte qui « prend la route », qui bientôt « a pris la route » « et le futur passe et passe et le futur est passé ». La poésie de Regnaut est notation brève, intense émotion, incessante(s) question(s). Les mots du poète se faufilent entre les mots de l’enfant : écoute et couture. Mais laissons-leur le dernier mot, uniment : « — L’enfant et le poète, ils sont effectivement, eux, de ceux qui savent. — Qui savent quoi ? — Qu’ils sont des enfants ». CQFD.

Comment un recueil qui dit l’impermanence des choses nous conduit-il à ne plus pouvoir le lâcher ? Par fascination. On oublie, le cas échéant, qu’on ne connaît rien au ballet « Blue Lady » de Carlson qui a provoqué cette écriture. On capte un regard artistique commun entre chorégraphe et poétesse. Dans un autre ballet de Carlson se danse la « victoire des signes ». Ici, c’est celle des signes écrits, les mots transforment la chorégraphie en image magistrale (1). Victoire du « crire », du corps et de l’écriture ensemble. « Crire » pour mieux écrire, mieux danser d’une page à l’autre, avec ces mots-couleurs, posés comme des pas japonais dans un jardin, qui nous font traverser.
Ce recueil nous implique. Apaise nos craintes de lecteur. « La poésie qui ne s’explique pas », « la réponse émerge de la terre », « la poésie combine la présence à l’espace ». Celle de Laurine Rousselet utilise une syntaxe souvent ternaire, fait un large emploi de l’article défini. Cela donne des images dont le surréalisme fait du bien. On avance dans une chaude douceur, hors des passages cloutés.
Marie-Pierre Stevant-Lautier
- Ce livre a donné lieu à un temps scénique avec la danseuse Sara Orselli le 23 mars 2023 au musée Jean Lurçat à Angers.
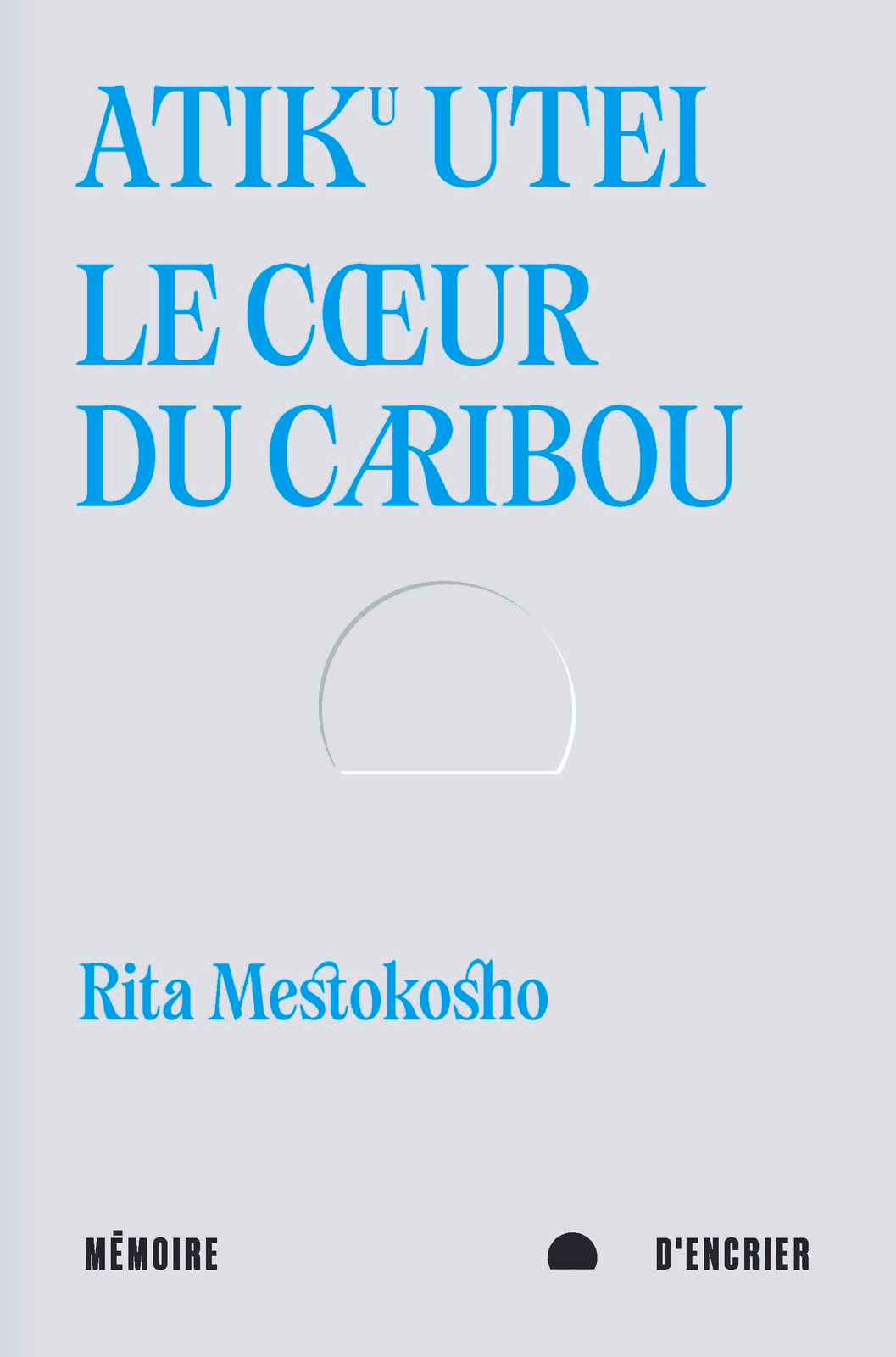
Il y a des livres, rares, qui nous rendent plus humains parce qu’ils nous aident à percer les mystères du vivant et à repousser les vieux carcans de nos barrières mentales. Avec Atiku Utei. Le cœur du caribou, Rita Mestokosho, jeune autrice innue, nous entraîne en des terres qui lui sont familières. Ici, aucune opposition entre le passé et le présent, le temps est comme suspendu. Pas de séparation entre les générations non plus. La « parole poétique », dans sa fragilité apparente et sa diversité constante, mêle la géographie des forêts aux rivières encyclopédiques. Montagnes et plaines se confondent aussi.
Le volume est par endroits bilingue. Et, dans sa seconde partie, Un jour Madiba m’a dit, l’univers innu tend, par-delà toutes les frontières, réelles et imaginaires, la main à l’univers sud-africain pour tenter de dire le ciel, l’eau et la terre. Peut-être une manière, en vers, de rejoindre le pays de la liberté.

Quel mystère peut-on guetter depuis le seuil ? François Lerbret s’abstient de pénétrer, de déranger l’ordre, ou le désordre, des choses. Simplement, il regarde, se livre à la contemplation de ce qui apparaît soudain, puis disparaît, comme ces « fumées lointaines » ou la « migration des nuages et du vent ». Ce qui l’appelle se situe à la lisière de l’œil, « dans l’indécision du regard », vers des ombres et des crépuscules où la mésange tourne vers la nuit « des couleurs qu’on ne peut plus voir ». Les lieux qu’il affectionne sont des lieux oubliés, telles ces anciennes gares avec « les voies sans voyage / où patientent les wagons », devenus inutiles.
À la façon du rouge-gorge, ce « familier des heures désertes » préfère l’attente « plutôt que chercher », et, s’il aime autant les goélands, c’est parce que « leur vol blanc / quand il n’est pas ombre filante sur le mur / reste sur le visage du ciel ». D’ailleurs, de nombreux oiseaux l’accompagnent au fil de ces poèmes, célébrant l’éphémère. Peut-être même que son écriture est, dans le secret des mots, la traduction de leur langage.











