Après avoir mené avec Valentin Merlin une enquête historique inédite dans les archives de la police où elle montrait que les « nomades » se dressèrent vigoureusement contre la répression politique (Les nomades face à la guerre), Lise Foisneau engage une ethnographie sur des aires de stationnement dans le sud de la France. Son livre cherche à répondre à cette question : qu’est-ce au juste qu’une Kumpania, cette espèce de rassemblement de caravanes qui, au détour d’une route (sur un parking, sur un stade, dans un champ), ressemble à une petite société à l’écart et tous à l’unisson ? De quoi est fait cet agencement de familles ? Un pays d’origine, une descendance, un mode de vie, une généalogie ou une lignée rassemblée, une classe de métiers ou quoi encore ? Quel est ce « nous » qui fait tenir ensemble ce lieu ?

La façon d’entrer sur un terrain joue un rôle crucial pour la suite d’une enquête. Pour acquérir le statut de nomade, Lise Foisneau et son ami Valentin Merlin avaient loué une caravane, s’étaient installés sur une aire d’accueil et avaient commencé à « voisiner » des mois durant pour apprivoiser les lieux, les femmes et les hommes séparément, repérer les moments partageables sans casse. Mais cela ne suffisait pas. Les accusations de « surveillance » et d’espionnage policier qui collent à toute présence étrangère ne s’éteignent pas aisément. Il faut trouver d’autres points d’accréditation. Il faut mettre en place des espaces de garantie pour « entrer dans la place ».
Et soudain l’historienne a sorti une carte maîtresse : quelques vieilles photographies issues d’une recherche antérieure sur « les gens du voyage ». Au hasard, mais il fallait y penser. Avec en main quelques vieux clichés photographiques de l’aire d’accueil de Saint-Menet, dans le XIe arrondissement de Marseille, pris en 1980 par l’anthropologue Marc Bordigoni, Lise Foisneau réveille immédiatement les souvenirs, avive soudainement la curiosité, revitalise la mémoire même si ce ne sont pas les mêmes familles qui sont sur les images. La succession des portraits, les cérémonies des célébrations, fait lien à partir de cette unité de lieu.
L’un des bonheurs de l’enquête, c’est la photographie d’archive qui brusquement fait crédit. Le courant passe. Car le cliché est entouré d’estime, de considération au point de faire tomber les doubles et triples langages qui sont comme des pièges à enquêteur. Une fois le statut de gens du voyage acquis (bien que gadjé), l’accréditation photographique fait tomber les dernières réserves.
Changement d’atmosphère. Les femmes apportent tables et chaises, demandent à voir encore d’autres « vieilles photos », les hommes debout et fiers montrant du doigt l’ordinateur, c’est qui ça ? On ouvre un dossier nommé « Anthropométrie, 1940 ». Un nom de famille apparait à l’écran : « Delore » ; Marco reconnaît l’homme sur le cliché, c’est un de ses grands-oncles paternels. « “O papo Vosho ! [C’est le grand-père Vosho !]”, s’exclama-t-il. Marco s’enquit ensuite du contenu des autres dossiers pour savoir si j’avais des photographies analogues sur mon ordinateur. Je lui répondis que j’en avais plus d’une centaine, le support d’un de mes devoirs d’étudiant ». Les demandes s’enchaînent. Un monde s’ouvre. L’enquête débute sérieusement, la sympathie circule, il faut du temps pour démailloter les préjugés réciproques.

Lise Foisneau et Valentin Merlin vivront ainsi trois années dans différents lieux du sud-est de la France, avec des regroupements différents, pour saisir les multiples sens de la « définition de soi » que chacun donne suivant les circonstances. Soudain, une femme s’épanche dans un récit, « là c’était une bonne compagnie ! ». Cette femme voulait dire que la combinaison des familles, des lieux et des activités collait à merveille, et que ce n’est pas joué d’avance — tant de variables jouent dans ces collectifs éphémères. Ce n’est pas un groupe identique qui se déplace pour aller de place en place, au fil des mois, mais des assemblages singuliers, des rencontres heureuses ou pas, qui formeront justement une Kumpania sur un parc public, le bord d’une autoroute, collée à une centrale thermique ou autre zone industrielle riche en terre délaissée.
Devant Lise Foisneau et Valentin Merlin, ou à l’occasion des visites de services municipaux ou de commerçants gadjé, chaque membre d’une kumpania se dira « Gitan » ou « Tsigane » ou encore faisant partie des « gens du voyage ». Tandis qu’au sein du « monde du voyage », on pourra se présenter comme « Hongrois » pour se déclarer « Rom ». En ajoutant être « de Marseille », « de Montillon » ou « de Labarque ». En tournant le dos soudain dans le petit enclos de la compagnie, ils se nommeront en utilisant leur romano anav ou en nommant la relation qui les unit les uns aux autres.
Combinaison d’identité ? Elle est renforcée par l’attribution pour chaque personne d’un prénom, jamais prononcé en présence de gadjé, un romano anav à l’usage exclusif des Roms. De sorte que le prénom des papiers d’identité n’est pas celui qu’on utilise pour désigner l’un de ses membres. On sépare le « nom d’école » et le nom quotidien, le « nom de papiers » et le nom « entre nous » que l’on ne donnera jamais aux enseignants, à ses médecins, son infirmière, ou à un gadjo avec qui on entretient des relations.
Nos préjugés tombent. Rien à faire, les compagnies ne sont pas plus des « familles » que des « groupes familiaux » et ne forment pas davantage des « communautés ». Rien de tel. Car elles se constituent, s’assemblent, testent la cohabitation, se fragmentent, se séparent, reforment un agencement quelques kilomètres plus loin. Les manières de s’adresser à l’État, aux administrations, rassemblent ou disloquent les alliances. Les métiers et les rapports aux commerçants font varier les ententes. Les manières de chiner des voitures et des chantiers aussi. Les élagueurs en pavillonnaire se séparent des chaudronniers des villes. Et l’on aurait tort de croire que ces couches d’identité parviennent à protéger suffisamment des contraintes et des menaces.
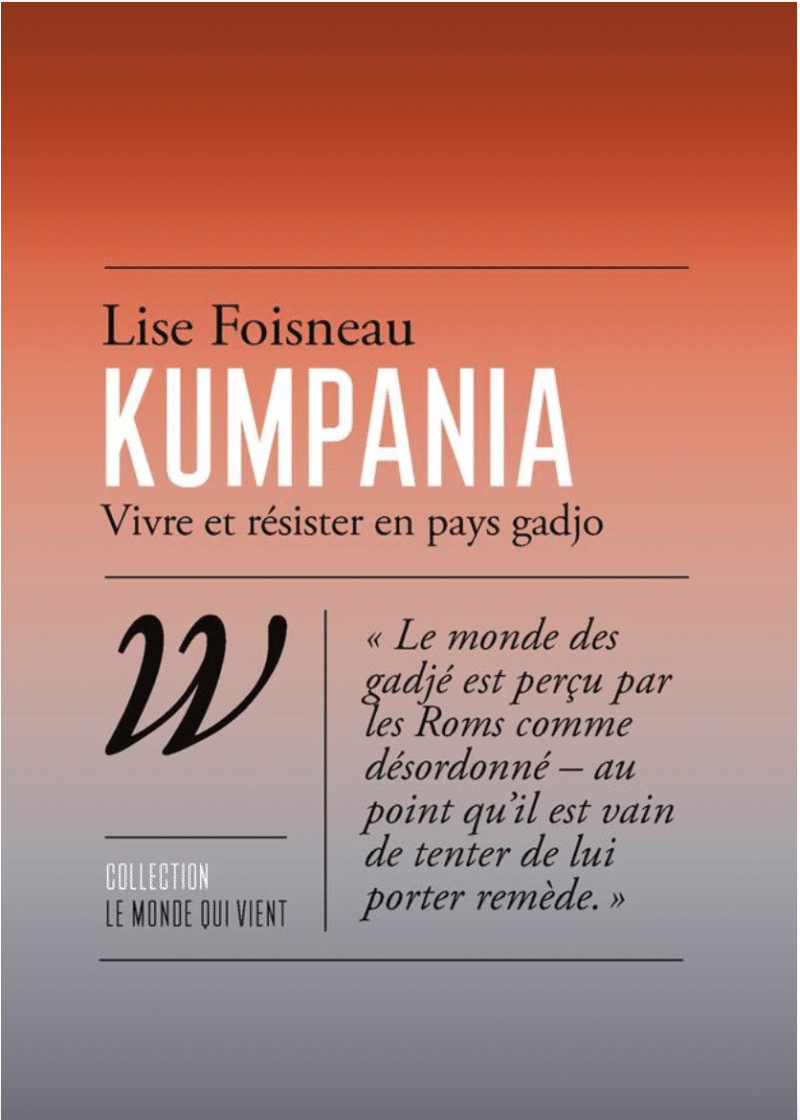
On a beau composer avec les espaces serrés des aires d’accueil, les lieux interdits, l’appropriation est toujours à refaire, la propriété privée à transformer en propriétés collectives et tournantes. La violence des lieux et les assignations sont difficiles à contrer. L’insalubrité n’est jamais bien loin. Et les relations entre caravanes parfois hautement tendues qui amène à de micro-déplacements, des sortes de « roulement de voisinage », notamment lors de l’arrivée de nouveaux camping-cars, conduisant à fabriquer une nouvelle kumpania. Les mésententes existent et conduisent à prévenir les conflits par de subtils mouvements, des changements de place, des départs. Mais ces brouilles sont aussi déplacées par les enfants et adolescents qui ont leurs propres solutions aux conflits, dessinant d’autres zones d’autonomie pratique.
À la suite de Patrick Williams et d’Henriette Asséo, cet ouvrage déchire toute image d’un monde fermé et clos sur lui-même. Mosaïque d’appartenances, fragmentation des liens, pluralité de « nous », la kumpania tend à se dissoudre sur un temps plus ou moins long, il n’y aura pas d’au-revoir, chacun ira de son côté en toute autonomie, pour une autre rencontre, parfois des retrouvailles sur des activités communes, reformer un réseau d’intelligence sur un temps donné, sans craindre la désagrégation, un autre assemblage renaîtra plus loin. Les espaces relationnels l’emportent sur les lieux, l’extra-territorialité sur l’enclave, la déambulation sur l’assignation. Et Lise Foisneau d’enfoncer le clou : « Fondamentalement, la structure du collectif des Roms de Provence est individualiste, au sens où chaque caravane forme une entité autonome, et égalitaire, dans la mesure où aucune caravane n’est considérée comme supérieure aux autres, et qu’il n’y a pas de chef de la kumpania. ». L’important n’est pas où l’on va mais vers qui.











![Collectif[1], La condition intérimaire, La Dispute, 2024, 164 pages. Delphine Serre, Ultime recours. Accidents du travail et maladies professionnelles en procès, Raisons d’agir éditions, 2024, 154 pages. Éric Louis, Casser du sucre à la pioche, chronique de la mort au travail, Rennes, Éditions du Commun, 2024, 140 pages.](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2024/10/1600px-A_Warning_To_Be_Careful_While_Working_Eine_Mahnung_zur_Vorsicht_bei_der_Arbeit_MET_DP344663.jpg)
