C’est au plus révélateur, au plus caché, au plus souillé des miroirs, que Poubelle, le roman de Sylvia Aguilar Zéleny, confie le reflet du monde violemment contrasté de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Non pas celui du désert, tout proche, mais celui de Ciudad Juárez et El Paso, villes qui se mirent dans leurs dissemblances d’une rive à l’autre du Río Bravo ou Río Grande. Marge dans la marge, la décharge municipale de Ciudad Juárez condense les maux ou les symptômes de cette frange territoriale où, malgré la ligne de démarcation, s’entremêlent le Mexique et les États-Unis. Y confluent rebuts et ordures des deux villes. Mais n’allez pas croire que c’est là un lieu terminal, car cette gigantesque « poubelle » convoque aussi les forces de vie ou de survie de ceux qui en tirent leurs ressources – et qui l’habitent.

Lorsque plus rien ne vous tient, ni famille ni foyer, le plus exposé des territoires devient un refuge voire un royaume, comme l’entend la très jeune Alicia, l’une des trois narratrices du roman. Gris ou Griselda, médecin qui vit dans le confort matériel et l’inconfort existentiel à El Paso, se rend jour après jour à la décharge de Juárez pour y étudier le rapport des pathologies à l’environnement. Mexicaine et orpheline, élevée avec sa sœur Norma par une tante célibataire qui, sur le tard, perd la mémoire, Gris peine à soigner le monde et à s’y situer, se distinguant de ses collègues gringos tout en demeurant étrangère à l’univers qu’elle a dû quitter enfant. Dans le quartier Azteca qui jouxte la décharge, Reyna, la troisième de ces diseuses de la frontière, régente une maison close où règne, non sans bisbilles, la solidarité entre femmes trans – à sa propre image – et « femmes biologiques et écologiques », comme elle s’amuse à dire.
Les histoires des trois femmes sont, certes, liées par leur rapport, dissemblable, à la décharge : l’une vit sur place, sur le sol meuble et pestilent que forment les déchets ; l’autre visite les lieux depuis la ville prospère sise « de l’autre côté » ; la troisième prétend ignorer les effluves qui émanent de cet immense dépôt d’ordures, si proche de son propre refuge ou de son royaume. Mais, qu’elles se croisent ou non, et quand bien même leurs histoires seraient plus intimement mêlées qu’elles ne le sauront jamais, Alicia, Gris et Reyna partagent d’abord une manière de traverser toutes sortes de frontières : celle qui sépare la position d’objet ou de victime de celle de sujet, celle qui différencie la force de la faiblesse ou la certitude bornée de l’incertitude féconde, celle qui distingue entre genres masculin et féminin. Ce qui les rapproche, c’est leur vaillance.
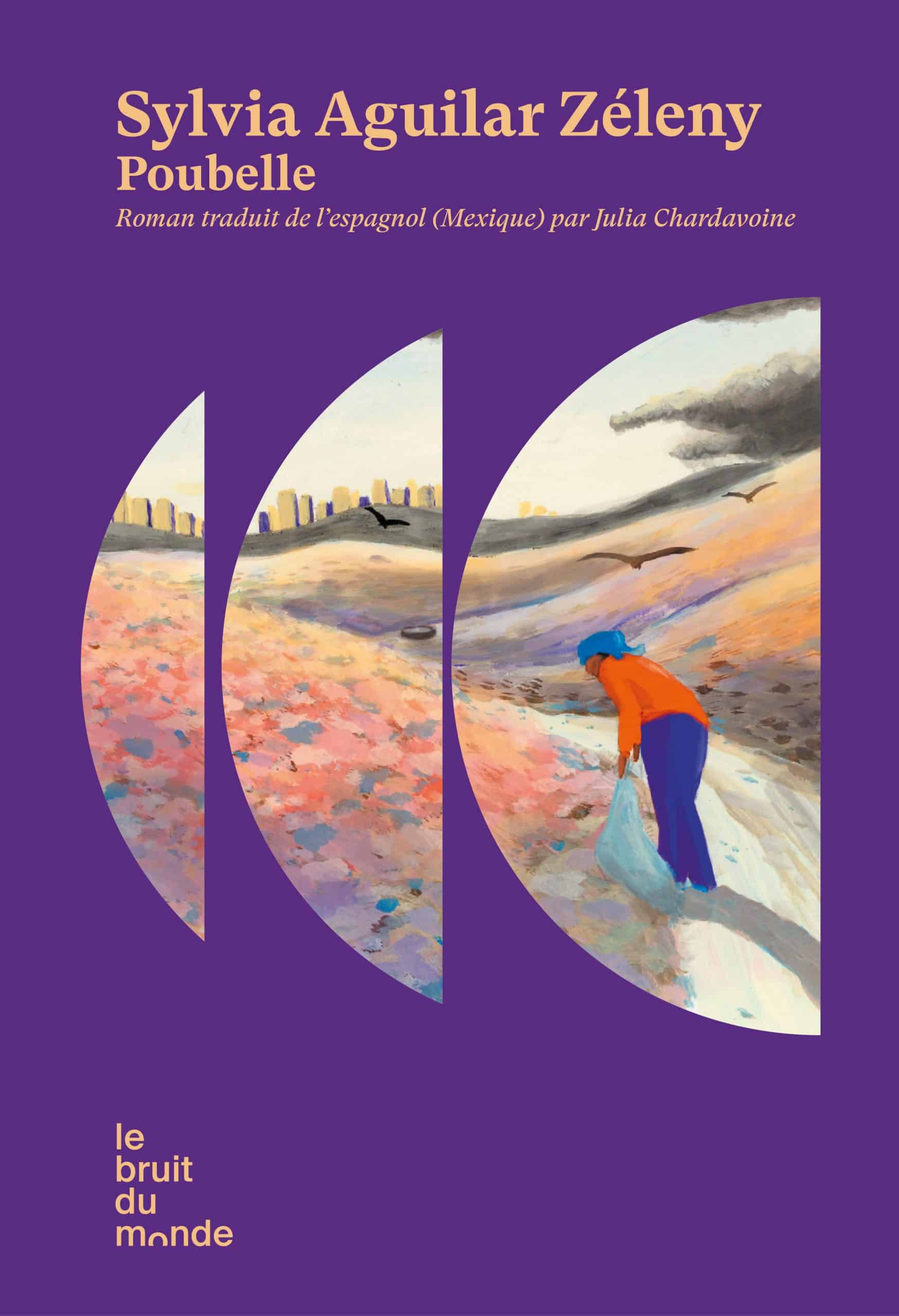
Et de la vaillance, il leur en faut dans ce monde frontalier où les femmes sont à la merci de prédateurs de tous acabits. Comme tient à le rappeler Sylvia Aguilar Zéleny dans divers entretiens, tandis que dans les années 1990 et 2000 El Paso était jugée la deuxième ville la plus sûre des États-Unis, Juárez était célèbre pour les meurtres de femmes qui s’y commettaient impunément et pour la violence liée au crime organisé, les deux phénomènes étant inséparables. On sait comment, dans 2666, Roberto Bolaño a fait de Santa Teresa, où se cache le secret du mal, le double de Ciudad Juárez ; comment la découverte de cadavres de femmes y scande « La partie des crimes » où des corps sont jetés dans une décharge sauvage qui se nomme El Chile : le Chili ou le chili. Poubelle, écrit quinze ans plus tard par une autrice mexicaine qui vit à El Paso, n’évoque les féminicides de Juárez qu’en filigrane. Comme apportant une réplique locale, réaliste, féministe au récit global, historique et métaphysique de Bolaño, le roman donne la parole à des femmes. En habitantes de Juárez accoutumées aux pires des dangers, Alicia et, surtout, Reyna, qui veille en mère sur ses « filles », font allusion à la violence meurtrière contre les femmes, reprennent des rumeurs, mettent en garde leurs proches. Mais Alicia, Reyna et ses pupilles vivent d’autres violences de genre, que l’on pourrait dire « ordinaires » : domestiques, sexuelles et quasi incestueuses, ou encore socio-professionnelles entre clients et prostituées. Pour s’en protéger mais aussi pour réchapper d’une condition d’orpheline, de la perte de mémoire d’une tante, de l’abandon commis par des femmes elles-mêmes désemparées, chacune des trois narratrices tente de réinventer la maternité, la famille, le foyer. Fût-ce, comme s’y voit réduite Alicia, par le biais du plus farouche des rejets envers ces valeurs si traîtresses. Lapidairement, l’enfant-femme de la décharge, nouvelle Alice au pays des ordures, confie ainsi à Gris, qui cherche à gagner sa confiance : « Les chiens sans nom sont ma seule famille ».
Ce qui rapproche les trois personnages féminins du roman, c’est leur vaillance.
Poubelle leur construit un abri verbal, traversé de courants d’air, d’altérités, de secrets de famille à peine éventés, en tressant patiemment les brins de leurs récits au long des quarante-cinq fragments où elles prennent tour à tour la parole. La natte s’achève ou s’interrompt sur le nœud d’intrigue qui lie deux d’entre elles, Alicia et Reyna, pour un sort partagé quoique incertain, tandis que la troisième cesse d’être la seule fille adoptive de sa tante pour devenir tante à son tour. Sylvia Aguilar Zéleny a doté chacune des trois narratrices du roman d’une éloquence propre, d’un talent narratif différent, de circonstances d’élocution particulières. Leurs trois récits alternés font entendre divers registres de l’oralité, maniés avec virtuosité : phrases brèves et précises de la jeune lectrice d’Alice au pays des merveilles qu’est Alicia ; discours à la syntaxe plus élaborée de Gris ; capricieuse logorrhée ou jouissance du dire de la Grande Reyna, éblouissante d’aisance verbale, d’inventivité, d’humour irrévérencieux voire gentiment salace. Réticente, avare d’épanchements, l’adolescente de la décharge s’adresse à Gris, qui recueille son témoignage bien au-delà de ce qu’exigerait son travail d’enquête. Méditative, Gris, en quête de son désir et de son identité, se laisse aller à une interlocution avec elle-même. Lors de ses entretiens successifs avec les nouvelles pupilles qu’elle entend former au métier, Reyna fait les questions et les réponses, se riant de sa tendance à raconter sa vie à la moindre occasion.

Mais pour tresser ces monologues, il fallait aussi savoir couper chaque tirade au moment opportun, ménager une forme de suspense, laisser résonner le dire de chaque narratrice dans une interruption qui en accentue les effets, qu’ils soient poignants, comiques ou empreints de dérision. Il fallait faire une place au non-dit de chacune et donc chatouiller l’oreille de la lectrice ou du lecteur. Il fallait que l’histoire se contât, non par épisodes, comme dans un roman-feuilleton, mais par pièces présentes – et, pour les personnages, pièces manquantes – du puzzle que reconstituera cette lectrice ou ce lecteur. Cet art de la composition, Sylvia Aguilar Zéleny le pratique avec une grande sûreté. Poubelle n’est certes pas le premier de ses romans, mais l’autrice — inspirée par Trash de Dorothy Allison — confie volontiers avoir d’abord songé à écrire un recueil de nouvelles condensant l’image de la frontière autour de la décharge de Juárez avant d’opter pour une forme qui relie ces trois histoires sans trop en resserrer la trame commune.
Comme dans un roman-feuilleton, les liens de sang les plus insoupçonnés unissent les trois femmes. À la grande différence près que les dévoilements des secrets de famille, cette autre « poubelle » que l’on cache soigneusement sous les tapis, n’auront pas lieu pour les intéressées. Foin de tout mélodrame ! Point de scènes de reconnaissances ou de retrouvailles, mais de tâtonnantes intuitions des trois femmes, des hypothèses, de troublantes impressions de familiarité. On l’aura compris, à travers l’exemplarité de ces histoires d’ardue résilience, Poubelle interroge la notion de famille fondée seulement sur des critères biologiques. Le modèle familial traditionnel cesse d’être exclusif pour figurer aux côtés des familles alternatives et symboliques qui font communauté. Tout comme la trame du récit se veut subtilement lâche, les liens et les identités, qu’elles soient familiales, nationales ou de genre, demeurent à inventer ou à traverser dans ce roman de la frontière dont le maître mot serait, je vous le donne en mille, non pas poubelle, mais devenir.












