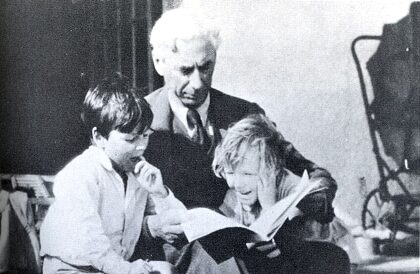Avec ce sixième tome de la Correspondance de Nietzsche, voici la fin de la traduction française de la monumentale édition de Colli et Montinari. Et aussi la fin du penseur lui-même. Après deux volumes, la traduction de ses centaines de lettres avait été suspendue durant une vingtaine d’années. Remercions notre ami Jean Lacoste de l’avoir menée à son terme. Grâce à lui est enfin couverte la petite quinzaine d’années durant lesquelles le porte-parole du cercle wagnérien devint Nietzsche.

Les deux dernières années de Nietzsche ont quelque chose de tragique qui serait perceptible même si l’on ignorait la manière dont elles se sont conclues, sur ce silence total d’une décennie qui le vit plus que mort puisque son corps vivait encore. Il est d’ailleurs difficile de se faire à l’idée que l’on sache si peu de choses de ce que fut sa survie après le 9 janvier 1889. Était-il incapable de prononcer la moindre parole ? Incapable même de formuler une préférence alimentaire ? Un cerveau anéanti, abruti de médicaments ? L’abîme, sur ce point, est aussi celui de la documentation. Pendant ce temps, sa sœur, revenue de la colonie paraguayenne de Nueva Germania, travaille au tri des papiers d’où sortira la Volonté de puissance.
Cet effondrement nous paraîtrait peut-être moins total s’il n’avait succédé à une année d’une intensité tellement extravagante que cela ne pouvait mener qu’à une telle destruction. En 1888, donc, Nietzsche a rédigé cinq livres, lesquels ne s’apparentent pas tout à fait à des transcriptions d’entretiens enregistrés au magnétophone ou au moyen de notes tironiennes. Voilà donc Le Cas Wagner, le Crépuscule des idoles, L’Antéchrist, Ecce Homo, Nietzsche contre Wagner. Des livres issus de lectures variées et d’une réflexion approfondie, dont nous sont parvenues les traces dans les cinq cents pages des fragments posthumes jetés sur le papier cette année-là. Ajoutons les lettres pluri-quotidiennes écrites à des dizaines de correspondants pour se plaindre de sa solitude turinoise, niçoise ou à Sils Maria qui, toute proche d’un Saint Moritz déjà célèbre, n‘était pas tout à fait un désert intellectuel.

Et puis, plus rien, le silence absolu d’un cerveau qui a éclaté. Le 4 juillet 1888, il décrivait pour Overbeck son « état lamentable », ses douleurs diverses « dissimulant un profond épuisement nerveux qui fait que la machine se bloque ». La lucidité dont témoigne cette lettre impressionne. Est-ce un tel « blocage » qui s’est produit six mois après ? Une année marquée par une productivité démesurée dont témoignent ces lettres, dans leur abondance même.
Certaines des dernières lettres de Nietzsche étaient déjà connues. C’est notamment le cas de celle du 6 janvier 1889 dans laquelle il écrit qu’il aimerait « bien mieux être professeur à Bâle que d’être Dieu » mais qu’il n’a « pas osé pousser [son] égoïsme privé au point d’abandonner la création du monde ». André Breton l’a recueillie dans son Anthologie de l’humour noir, non parce qu’elle a « recommandé » Nietzsche à la « vigilance des psychiatres », mais parce qu’il y voit « la plus haute explosion lyrique de son œuvre. L’humour n’a jamais atteint une telle intensité, aussi ne s’est-il jamais heurté à de pires bornes ». Breton dit qu’elle est adressée à « un professeur ». Ce n’est pas faux mais il n’est pas sans importance pour un lecteur de Nietzsche que ce professeur soit précisément Jacob Burckhardt, ni qu’elle ait alerté le maître bâlois sur l’état de santé mentale de celui en qui il avait précocement reconnu un grand esprit.
D’autres lettres n’étaient jamais citées – elles n’étaient d’ailleurs même pas traduites en français ou très imparfaitement – alors qu’elles éclairent des prises de position qui ont pu paraître hautement paradoxales, d’autant qu’elles ont été formulées peu de temps avant la démence de leur auteur. Le lecteur de Nietzsche qui ne s’interdit pas de se rendre à Bayreuth peut comprendre, et même approuver, la plupart des critiques formulées à l’endroit de Wagner, de même que l’abonné de l’Ensemble intercontemporain est accessible à des critiques contre Boulez. Mais pas au nom d’une préférence pour la musique industrielle. Carmen n’est certes pas une opérette mais est-on bien au même niveau qu’avec le projet bayreuthien ? Nous avons oublié ce qu’avait été la mode du wagnérisme dans les années qui ont suivi la mort du compositeur, au moment où paraissait le Zarathoustra. Cet oubli explique qu’il ait pu paraître étrange que Nietzsche ait d’abord été connu par ses ouvrages sur Wagner. Il n’a jamais assisté au festival de Bayreuth, ni en 1876 ni à la réouverture de 1882 – mais il est allé à maintes reprises écouter Carmen, à Gênes en 1881, puis à Nice, à Turin. Dans Par-delà bien et mal (254), il fait l’éloge d’une France en laquelle il voit « le siège de la civilisation européenne la plus spirituelle et la plus raffinée, et la grande école du goût : mais il faut savoir découvrir cette France du goût ». Il en trouve une illustration dans Bizet, « le dernier génie qui ait su découvrir une beauté et une séduction nouvelles, qui ait gagné à la musique un fragment de sud ».

Quelque estime que l’on puisse avoir pour Carmen, un des très rares opéras en langue française à être parmi les plus joués dans le monde, on peut s’étonner de voir Bizet mis sur le même plan que Wagner. Et l’on ne peut soupçonner Nietzsche de n’avoir pas mesuré l’ambition dont la colline de Bayreuth aura abrité le théâtre. Adressée à Carl Fuchs, un musicien qui a lui aussi écrit un livre contre Wagner et de qui il attendrait volontiers un Cas Nietzsche, une lettre du 27 décembre 1888, écrite donc une dizaine de jours avant l’effondrement, situe bien les choses, sans provocation ni quoi que ce soit de fou. Nietzsche explique tranquillement que « Bizet ne compte pas par lui-même mais comme antithèse ironique par rapport à Wagner » car celui-ci était « furieusement jaloux de Bizet : Carmen est l’opéra qui a eu le plus grand succès dans l’histoire du genre et le nombre des représentations dépasse de loin celui des opéras wagnériens pris ensemble ». Nietzsche est tellement attaché à cette figure de Bizet que, le 14 octobre précédent, il confiait à « Peter Gast [Heinrich Köselitz] son intention d’envoyer Le Cas Wagner à la veuve du compositeur, que Brandes lui a présentée comme « la plus charmante femme », dont l’enfant « est d’une beauté et d’une gentillesse idéales ». Cela allait de soi après le vibrant éloge de Bizet sur quoi s’ouvre ce livre : « Hier – me croira-t-on ? – j’ai entendu pour la vingtième fois le chef-d’œuvre de Bizet […] Et chaque fois que j’ai entendu Carmen je me suis senti plus philosophe, meilleur philosophe ».
Dans la récente livraison de Critique, Paolo D’Iorio, héritier de Colli et Montinari, insiste sur l’importance de la coupure de 1876 et du séjour à Sorrente dans le cheminement de Nietzsche. Auparavant, celui-ci défend les positions du cercle wagnérien, y compris contre ses convictions profondes. Ensuite, à partir d’Humain trop humain, Paolo D’Iorio voit une grande continuité, dont un des ressorts est précisément la prise de distance d’avec le germanisme (wagnérien) au profit du sud méditerranéen (que symbolise Carmen).
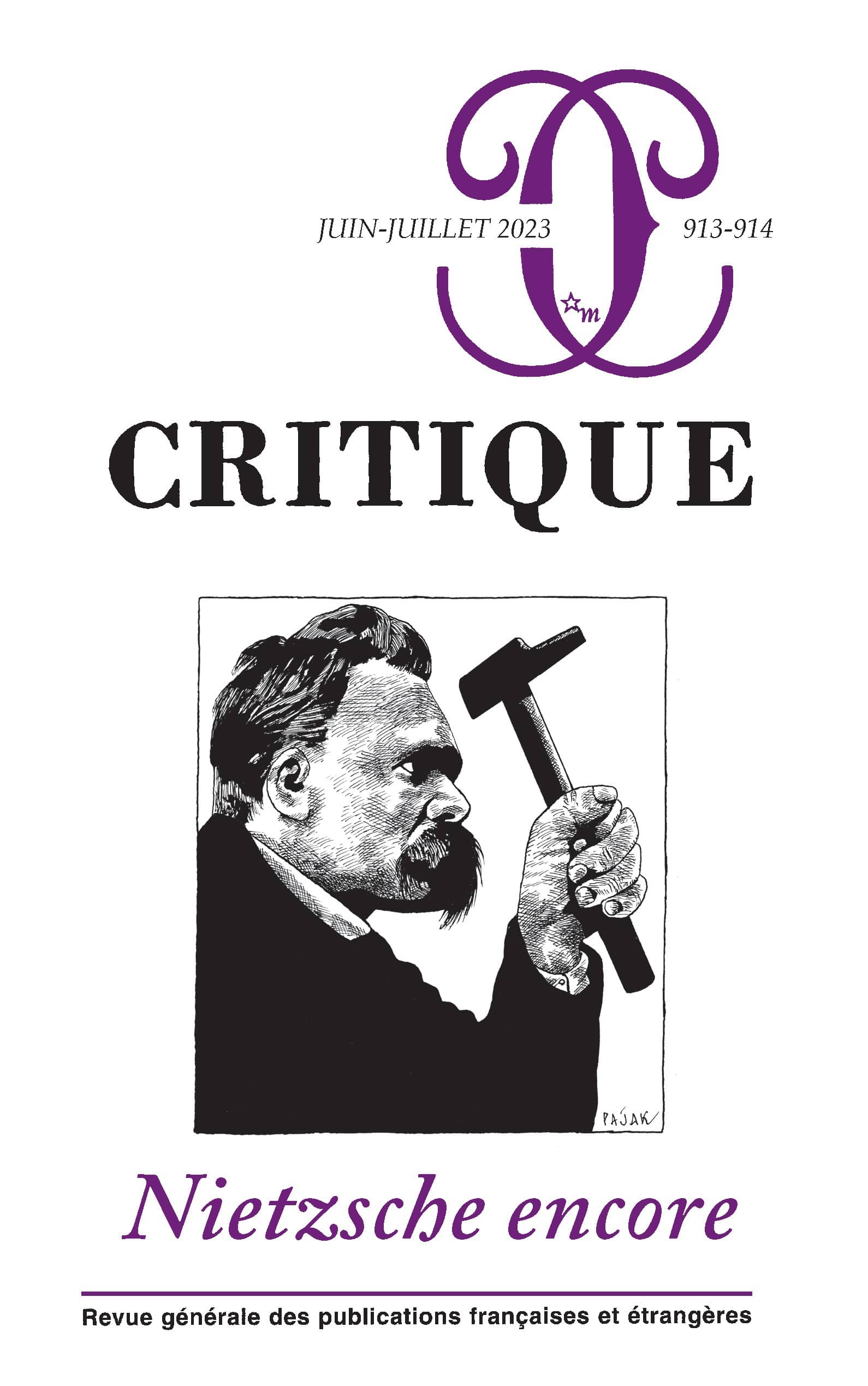
La Correspondance donne aussi un éclairage sur l’état d’esprit de Nietzsche dans les mois qui ont précédé son effondrement, et déjà sur son état moral. L’apologie répétée de la lumière méditerranéenne porte inséparablement sur cette part de la civilisation européenne, que résume la formule sur la « France du goût », et sur l’effet que produisent en lui les conditions climatiques. Au printemps, il est sensible à la belle lumière turinoise et à la clarté de l’air ; l’été venu, le mauvais temps que subit l’Engadine – cette année-là, il y neige en juillet – le déprime. Sa plainte porte alors sur la solitude dans laquelle il serait enfermé et dont une des manifestations les plus pesantes est l’ignorance universelle où est tenu son travail philosophique. Le lecteur de sa Correspondance voit la multiplicité des interlocuteurs, avec qui s’est engagé un véritable dialogue, dont Nietzsche trouve parfois les lettres trop longues. Et surtout, il voit qu’à Copenhague Georg Brandes prononce un cycle de conférences consacrées à l’auteur du Zarathoustra, qui rencontre un vif succès, avec « trois cents auditeurs » à chaque séance et de larges échos dans la presse. Ce succès, Nietzsche n’omet pas d’en faire part à plusieurs correspondants. Il insiste sur ce nombre de trois cents et ne se plaint pas que ce soit trop peu.
La lecture de cette Correspondance laisse souvent l’impression mitigée d’un homme qui passe de l’euphorie au découragement, de la douleur à la joie, qui se plaint d’une solitude intellectuelle et affective alors même qu’il ne manque pas de correspondants attentionnés ou respectueux, des amis fidèles comme Overbeck, des personnalités aussi illustres que Taine, Burkhardt ou Strindberg qui le félicite d’avoir « donné à l’humanité le livre le plus profond qu’elle possède ». D’un autre côté, comment ne pas prendre au sérieux son propos à Overbeck sur le « profond épuisement nerveux qui fait que la machine se bloque », six mois avant l’effondrement ? Hormis dans quelques cas, cet homme qui va sombrer paraît encore d’une grande lucidité.