Deux romans de Claude Kayat et Horacio Castellanos Moya disent, à leur manière et en deux voix, l’une française et l’autre salvadorienne, les actuelles voies de la violence dans le monde. Et ils ont en commun de renvoyer, incidemment, à une ville du Nord apparemment à l’abri de cette plaie, Stockholm, en Suède, ce pays si séculairement pacifique qu’on y a fondé un « Institut international de recherche sur la paix ».
La violence est désormais la chose du monde la mieux partagée, à l’égal de la bêtise, « formidable et universelle » selon Flaubert. La terre entière vit dans la guerre ou l’insistante menace de la guerre. L’une des facettes les plus odieuses de la violence est le terrorisme, étendu comme la lèpre sur toute la planète. Et l’on se retrouve démuni pour le cerner, pour le comprendre ou le combattre. Albert Camus, marqué par la guerre d’Algérie qui a vu se développer terrorisme et violence, entend séparer le bon grain de l’ivraie et distinguer deux termes qu’il oppose : « Si je peux comprendre et admirer le combattant d’une libération, je n’ai que du dégoût devant le tueur de femmes et d’enfants… Ce n’est pas la révolte ni sa noblesse qui rayonnent aujourd’hui sur le monde, mais le nihilisme. »

Tuer femmes et enfants c’est attenter à la Création, vouloir détruire l’espèce humaine en annihilant les jeunes pousses prometteuses et celles qui les enfantent. Le nihilisme renvoie à cet absurde dont Camus se fit le théoricien. Le monde est absurde, mais si l’Église des premiers temps entendait y mettre bon ordre en revendiquant la foi libératrice (Credo quia absurdum, je crois parce que c’est absurde), notre monde actuel, qui a vu peu à peu s’effondrer les utopies, semble n’être régi désormais que par la force aveugle et la violence, toton fou tournoyant dans le vide. Eh quoi, dirait le sage post mortem, l’humanité est-elle promise à l’anéantissement ? Notre siècle — Camus en faisait le constat en 1946 dans Combat — est « le siècle de la peur ».
Claude Kayat, qui s’est constamment penché sur le conflit judéo-arabe, depuis son premier roman au titre allégorique, Mohammed Cohen (Seuil, 1981, prix de l’Afrique méditerranéenne), réunissant en un seul être cet absurde antagonisme, y revient pour son dixième récit, La voix du terroriste, en campant une histoire que l’actualité a rendue banale : la prise d’otages, l’irrépressible peur et la sanglante tragédie. Deux narrateurs se partagent ce récit : un jeune Juif, Ludovic Lévy, pris en otage dans l’attaque d’une synagogue par trois islamistes, et un jeune islamiste, Mourad, chef du trio terroriste. Chacun faisant valoir ses droits et ses devoirs. Mais, dès le départ, on a la curieuse impression d’une affaire familiale, d’un règlement de comptes entre gens de même terre : « Que ces preneurs d’otages eussent opté pour cette obscure synagogue, fréquentée au premier chef par des originaires d’Afrique du Nord et leurs descendants, m’étonnait au plus haut degré. À la réflexion, il n’était guère surprenant que ces militants eussent jeté leur dévolu sur ce temple, dont on ne soupçonnait, de l’extérieur, pas même l’existence. Il ne bénéficiait de ce fait que d’un dispositif de sécurité des plus restreints. »
Nous savons depuis longtemps que les lieux de culte en France, comme en maints endroits de la terre, exigent une protection policière et il n’est pas aujourd’hui une seule synagogue française sans cordon de sécurité, voire quelque blindage de protection. Le récit progresse dans ces instances alternées, et tout est affaire de voix : Ludovic, pris en otage avec la centaine de fidèles de ce lieu de culte pendant l’office de Kippour – le Grand Pardon – par trois terroristes cagoulés et armés, se voit curieusement écarté des victimes promises par le chef du gang qui, le reconnaissant, veut l’épargner et lui intime l’ordre de sortir du rang et de s’en aller, à la grande stupéfaction de tous, et d’abord de l’intéressé. Car Ludovic ne connaît pas ce géant blond, cet hercule menaçant, mais il entend sa voix sourde et lourde qu’il ne reconnaît pas. Ce sera le fil narratif : rechercher la voix qui correspond à ce terroriste. L’inspecteur Lefebvre, selon l’usage, lui proposera diverses photos d’identification, mais en vain : comment reconnaîtrait-il le cagoulé ? Dès lors, tout est dans ce timbre de voix qu’il cherchera et finira par identifier. Livrer ici les fils de l’intrigue serait frustrer le lecteur de cet étonnant suspense, d’autant plus fort et riche de rebondissements que l’auteur note, au détour de cette enquête : « Ludovic répéta, hébété, qu’il avait peine à y croire, que cette histoire lui semblait au plus haut point invraisemblable. »

Beaucoup de sang sur le carreau, de nombreux corps criblés de balles ou victimes de grenades : l’horreur est partout, la peur est immense, mais l’intrigue, dans un style des plus dépouillés, est menée de main de maître, dans le droit fil d’une enquête à la Simenon. Dans sa quête implacable, le jeune Ludovic, qui a perdu son frère dans l’attentat, et bientôt père et mère, va doubler la police pour faire justice lui-même, avec pour justification cette phrase emblématique : « Les survivants se reprochent souvent d’être restés vivants. » Et lui, que cette tragédie atteint au plus intime et qui se sent tellement coupable d’être un rescapé de l’horreur, entend faire justice lui-même, « prendre Lefebvre de vitesse », dit-il, dans ce que Louise, sa sœur aînée, la seule sage de ce récit, elle qui a fui toute religion et tout fanatisme, qualifie de « vendetta démentielle ».
Ce récit nomade nous mène de Belleville à Stockholm, où l’auteur, qui s’est attardé sur le couscous, plat royal commun à ses Maghrébins arabes et juifs, arrosé pour ces derniers d’une bonne bouteille de « boukha – cette eau-de-vie tunisienne », ne manque pas de mettre en balance le fameux et terrible « hareng fermenté, notoire spécialité du Nord de la Suède, redoutable épreuve pour les odorats peu exercés ! ». Ceci pour la couleur locale dans la cité où se conjugue le crime. Il se trouve que le chef des preneurs d’otages est un grand blond au teint clair, un musulman au physique atypique que ses camarades surnomment « tête de Normand », « gueule de roumi », « tronche de Gaulois », et qui court au-devant de sa mère, dont il vient de redécouvrir l’existence, à Stockholm – où, par parenthèse, réside Claude Kayat, franco-tunisien et suédois –, et, peut-être au-devant de la mort… En revanche, Ludovic, un beau brun, a tout du Maghrébin, et d’ailleurs – ce qui le rend suspect aux yeux de la police – il entretient de solides amitiés arabes. Le romancier ne manquera pas de souligner, justement, que ce terrorisme aveugle est le fait des seuls fanatiques ; aussi donnera-t-il la parole aux voisins tunisiens de ces Lévy : « Moi qui vous parle, dit M. Hahicha, je suis un bon musulman. Depuis mon enfance, à Sfax, je prie aussi souvent que je peux. Mais je suis contre toute violence au nom de la religion. Et quelle que soit la religion. »
Face à l’horreur terroriste, aux discours haineux, aux odieux amalgames vouant les Juifs aux gémonies et les Arabes au rejet, Claude Kayat, fidèle à son parcours romanesque, jalonné notamment par La synagogue de Sfax (Punctum, 2006) – où l’on voit un Isaac, as du oud, interpréter avec son ami Moktar qui l’accompagne au qanoun la plus belle musique orientale – et par La Paria (Maurice Nadeau, 2019) – les amours de Fatima la Bédouine et de Yoram le jeune Israélien ressuscitent Roméo et Juliette en Galilée –, deux récits unissant étroitement, et en dépit de tous les avatars, Juifs et Arabes, Kayat nous donne, une fois de plus, sur le thème le plus angoissant de notre époque, une vision humaine et humaniste, dans le droit fil de la pensée d’Albert Camus.
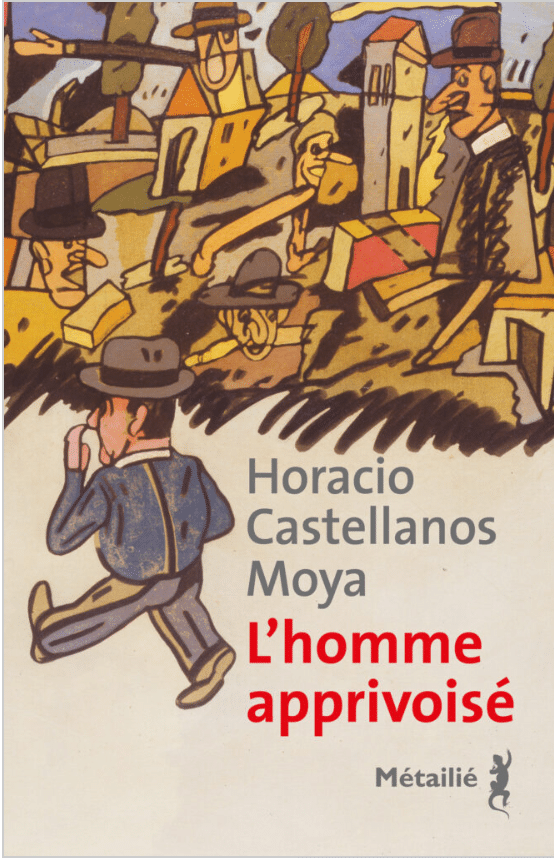
Aussi actuel et essentiel apparaît cet autre roman qui lui fait écho, entre exil et déprime, en s’attardant sur la solitude d’un Latino. L’étonnant et bref roman de Horacio Castellanos Moya, L’homme apprivoisé, se lit d’une traite, comme shooté par un style percutant et grisant. Voilà Erasmo, le protagoniste qui porte le nom du célèbre humaniste hollandais auteur de L’Éloge de la folie (1511), qui vient de sortir de l’hôpital psychiatrique après bien des avatars. Né au Honduras, élevé au Salvador, journaliste au Mexique et professeur aux États-Unis, victime d’un heureux exil à Stockholm, il finira, bouclant la boucle, par retourner aux Amériques et se vomir au Guatemala où « le merdier bouillonne, un vrai bonheur », au terme d’une vie chaotique.
Ce nomade permanent est aussi un éternel déprimé, qui ne survit que grâce aux anxiolytiques, antidépresseurs et psychotropes tels que la Paroxétine et le Lexomil : « Qui aurait dit qu’il terminerait sous cachets contre la dépression, l’anxiété et la panique ? Sa vie durant, il a méprisé psychologues et psychiatres… Jusqu’au jour où le monde s’est effondré sous lui. »
Le récit débute à Stockholm, en plein dépaysement, « assis à la terrasse du café, face à l’esplanade… après des mois de froid, de neige, de pluie, de déprimants ciels gris ». Le ton est donné et, pour la note d’exil, voilà ici quatre ivrognes « abîmés, déguenillés, la peau blanche et crevassée », deux Chiliennes, « toutes les deux de vieilles peaux » et, comme issus du précédent livre, trois Arabes barbus qu’il prendra pour des talibans. Dans la cité babélique, chacun parle sa langue, et le narrateur est complètement dépassé par la circonstance qui l’a débarqué dans cet étrange pays de froidure et de grisaille. Mais aussi pays de son salut, sous la protection d’une grande Suédoise qui le dépasse d’une tête, l’infirmière qu’il a connue alors qu’il était interné en hôpital psychiatrique et elle en stage de spécialisation à Merlow City. Cette femme est tombée amoureuse de ce beau Latino et l’a fait sortir des États-Unis où il n’était plus persona grata, accusé, certes à tort mais quand même, d’un viol sur une adolescente. On avance dans ce récit comme dans un brouillard, l’état de confusion qui caractérise cet Erasmo qui se déplace partout comme s’il était traqué et vit dans une perpétuelle panique avec sa « peur de tomber dans un piège… et de se retrouver à visionner une fille mineure, à la merci des enquêteurs qui traquent les pédophiles sur les réseaux ». La bureaucratie et la police américaine sont pour lui une éternelle menace.
Depuis Érasme de Rotterdam, on sait que la folie est la meilleure façon d’apprécier le monde par le biais d’un regard critique et de dénoncer le délire humain, trop humain. Et cet homme assis dans cette ville étrange n’est pas sans rappeler la célèbre Dame assise de Copi qui fit, naguère, les beaux jours du Nouvel Observateur. Observateur pareillement attentif et critique, Erasmo n’est pas tendre pour notre monde, ou plutôt notre univers mondialisé : les médias « lui paraissent tellement malhonnêtes » ; quant à la télé, « il a l’impression qu’une puanteur se dégage de l’écran » ; et surtout « il abomine le politiquement correct qu’il considère comme un rejeton du puritanisme déguisé en progressisme ». De telles phrases parlent évidemment à notre esprit et disent la profondeur de ce récit d’un nomade déprimé. Ne vivons-nous pas dans le people quotidien fait d’accusations, de harcèlements, de dépressions, de suicides, et aussi de violences terrifiantes ? Est-on surpris que ce récit se situe en Suède ? Ce pays modèle et prospère n’est certes pas à l’abri du mal et si le narrateur traverse, précisément, la rue Olof Palme – du nom de l’ancien Premier ministre mystérieusement assassiné en 1986 –, son pas n’est pas rassuré pour autant, lui qui voit partout s’étendre autour de lui le chancre du terrorisme. Et de rappeler la mort de la meilleure amie de sa protectrice, « victime de l’attentat à la voiture piégée qui a eu lieu dans le centre-ville quelques jours avant le dernier Noël ». Tout barbu, toute femme à la burqa, personnifie pour lui la menace, ce qui est absurde, ne manque pas de lui dire Josefin, sa protectrice. Les deux romanciers, Castellanos Moya et Kayat, entendent mettre en garde contre les généralisations à tout-va et le racisme.

Ce miroir que nous tend le romancier salvadorien, qui a déjà publié en français des ouvrages aux titres aussi évocateurs que Le dégoût, Le bal des vipères, Effondrement : roman et dernièrement La diablesse dans son miroir (Métailié, 2021), nous renvoie à nous-mêmes, à nos problèmes sociétaux, politiques, historiques, et à cette violence qui, désormais, secoue la planète entière. Comment s’étonner que cet Erasmo, parcourant le monde dans un effroi permanent, ne puisse survivre qu’à coups de psychotropes ? Au départ, le Salvador qu’il a fui est un marigot de maras, ces truands et assassins qui l’ont harcelé et dont, désormais si loin et se sentant presque à l’abri, il revit, avec son ami Koki pareillement traumatisé, la menace : « Il passe des heures sur Internet pour naviguer sur les sites de la presse salvadorienne, pour être au courant de ce qui se passe. Sa haine est viscérale. Les membres des gangs ne l’ont pas seulement racketté et menacé de mort, ils lui ont aussi piqué sa maison. Il faudrait tous les tuer… »
Et maintenant qu’il se voit forcé à un nouvel exil, sa belle infirmière le chassant de sa vie et de son hébergement, il y retournera, là-bas, au Guatemala cette fois, et cet autre exilé en Suède qui est son seul ami sur la place, naguère victime de ces gangs, l’éclaire sur ce retour désastreux à la case départ : « Tu es fou… Tu vas te faire pourrir l’existence par les maras, être obligé de vivre au jour le jour… » Et la conclusion signe sa défaite : « Aucune image ne lui revient en mémoire de ses séjours dans ce pays, en dehors d’une peur animale qui lui assèche la bouche ». Cette même peur dans laquelle Camus voyait un signe des temps modernes.
Le cercle vicieux où est enfermé Erasmo est justement cette panique qui lui fait se bourrer d’antidépresseurs, dont l’effet nocif à rebours est potentialisé par l’alcool. Alors, malgré la meilleure volonté du monde, Josefin, la belle âme secourable qui l’a sauvé de la folie et de l’asile, finit par céder à son dégoût et sa détestation. À travers elle, l’auteur entend illustrer le drame intime des aidants qui, un jour ou l’autre, n’en peuvent plus de soutenir l’incurable aliéné. Le protagoniste, avec un reste de lucidité, ne peut éluder cette déroute : « Si elle était fatiguée de lui, elle le lui dirait directement, elle n‘est pas du genre à louvoyer. Mais, si elle a pitié de lui, et que sa conscience de femme politiquement correcte l’empêche de le mettre à la rue, de lui dire qu’elle en a marre, plus que ras le bol de lui ? »
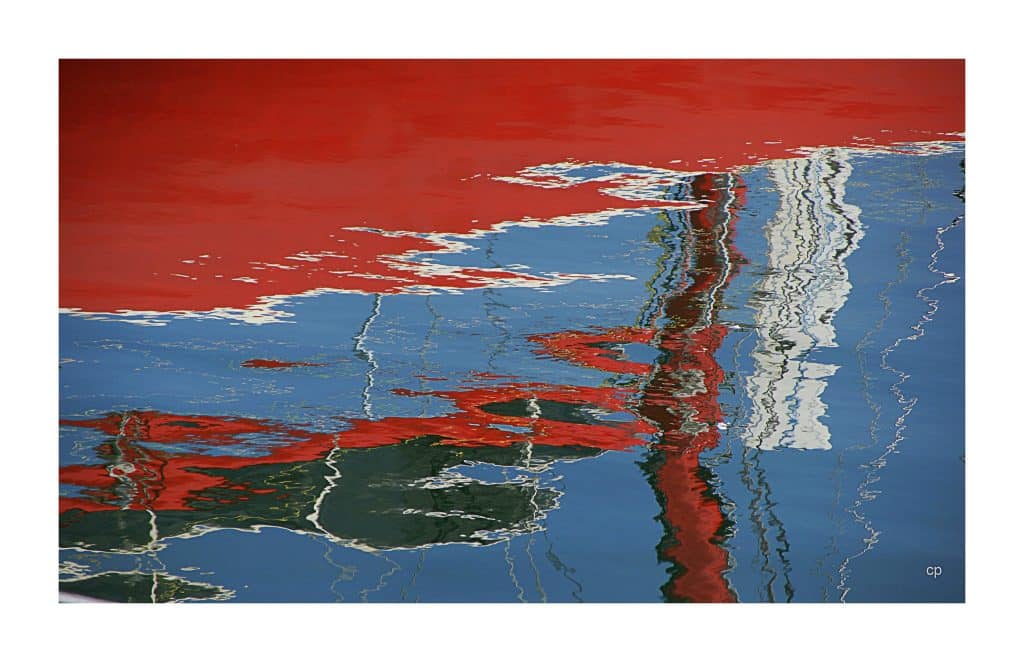
Ce récit ne peut que résonner dans un pays comme la France qui détient le triste record de la consommation d’anxiolytiques et d’antidépresseurs – comme l’a prouvé, récemment, le rapport Zarifian sur l’utilisation des médicaments psychotropes. Et que voyons-nous au quotidien, par l’œil aigu d’Horacio Castellanos Moya ? À travers ce titre fallacieux qui veut faire croire à la neutralisation de la maladie – L’homme apprivoisé, El hombre amansado, dit le titre espagnol qui renvoie à ce taureau furieux qu’on entoure de bœufs mansos, apaisants et doux, pour l’adoucir et le domestiquer… avant de le conduire à l’arène –, l’inéluctable déroute de l’esprit dans le cercle infernal de la violence.
La lecture de ces deux récits pourrait servir de vade-mecum d’usage psychiatrique. On retiendra le diagnostic conclusif du second : « une lente et incessante torture ». Ainsi s’étalent le terrorisme, la violence, la peur et la déprime. Mais le roman n’est-il pas, comme le voulait Stendhal, « un miroir que l’on promène le long d’un chemin », et ici, dans cette dégradation de l’épopée théorisée par Bakhtine, un miroir à ras de terre ? Ainsi ces deux romanciers, si dissemblables par la voix et si appariés dans leur visée, nous forcent-ils à voir, à comprendre, à juger. Dans la plus angoissante actualité et un style qui met toujours dans le mille.












